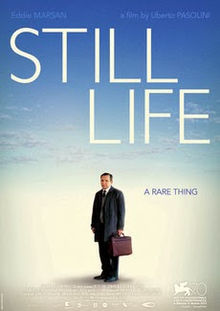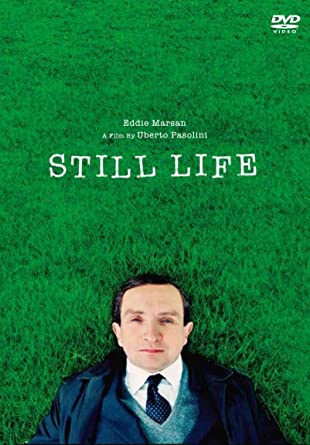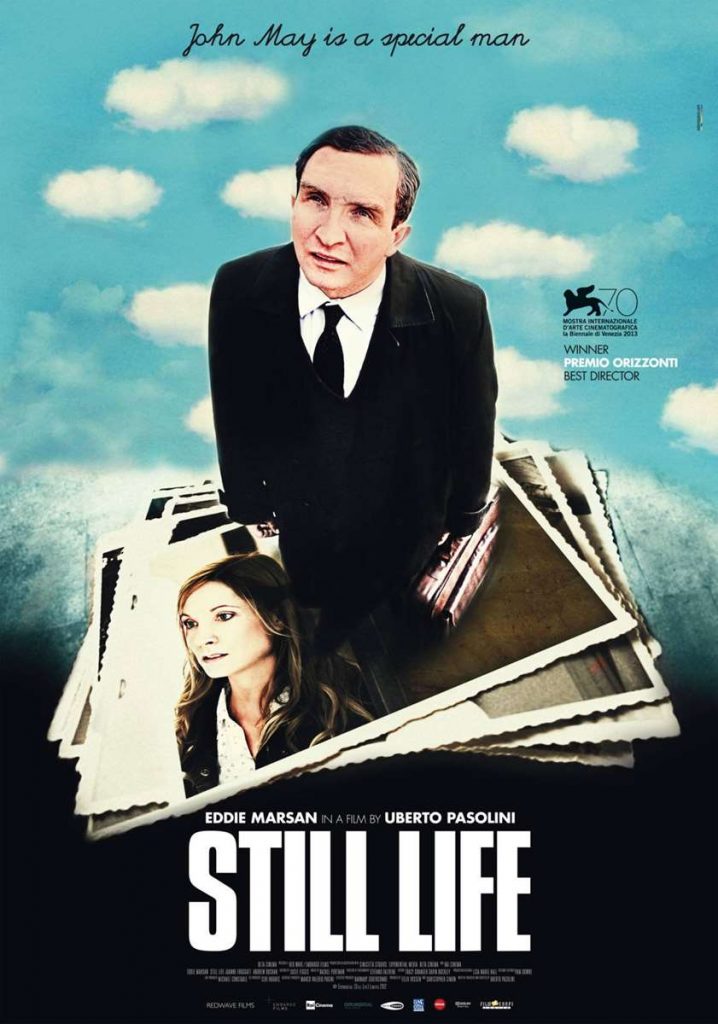Mon film invite à se demander ce que vaut cette logique qui laisse des gens disparaître, éloigne les membres d’une famille, pousse à ne plus connaître ses voisins. Pour ma part, je pense que c’est dans la curiosité des autres que la vie devient plus intéressante et qu’on a une chance de devenir une meilleure personne. Uberto Pasolini

Uberto Pasolini, né le 1er mai 1957 à Rome, est un réalisateur et producteur italien. Il vit et travaille au Royaume-Uni. Neveu de l’illustre Luchino Visconti. Enfant de l’aristocratie mais cinéphile dans sa jeunesse et banquier à Londres à 26 ans, il quitte la finances et part comme garçon à tout faire sur La Déchirure 84 et Mission 86 de Roland Joffé, remarqué par le grand producteur David Puttnam, pendant 10 ans il devient son assistant avant de fonder ensuite sa propre compagnie, et de toucher le jackpot avec le film Full Monty en 1997 avec plus de 250 millions de dollars de recettes dans le monde et de nombreuses récompenses et l’un des plus grands succès du cinéma anglais au box office mondial ce qui vous donne une certaine liberté…Auteur d’un premier film, une comédie en 2008 Sri Lanka National Handball Team il se révèle en brillant réalisateur avec son second long métrage Still Life ( Une belle fin) avec un talent fou pour capter des instants rendus avec grâce et sensibilité. Un troisième est à venir le 8 décembre prochain Un endroit comme un autre.
PROMENADE AVEC LA VIE ET LA MORT…
Ce film est une œuvre en porcelaine, fragile et délicat, tourné avec simplicité et humilité, mais qui pointe pourtant beaucoup de choses derrière son naturalisme bouleversant. Une tendre réflexion quasi-philosophique sur la société et sa façon de traiter les siens, sur la solitude, grand mal de notre époque, sur l’importance de la vie alors qu’ironiquement il parle de la mort, sur l’humanité, en laquelle le cinéaste croit si fortement, sur la possibilité de trouver une forme de bonheur dans la dévotion aux autres, sur la trace de notre passage sur Terre ou encore sur les rapports humains modernes. Profondément fataliste de prime abord avec son personnage empathique envers lequel on ne peut éprouver que tristesse et mélancolie, Une Belle Fin avance, lentement mais sûrement, en s’enveloppant progressivement d’une luminosité chaleureuse et émouvante, qui affectera tout le récit et son message plein d’intelligence dans sa faculté à ne jamais s’imposer en jouant des coudes, bien au contraire, privilégiant le ressenti personnel pour mieux laisser le spectateur façonner sa propre appréhension de cette belle histoire confectionnée avec finesse et raffinement. Au son d’un thème magnifique de douce nonchalance, sans doute la seule forme de langage cinématographique vraiment mise en avant et appuyée, Uberto Pasolini nous accompagne dans cette chronique dramatique épurée et naturaliste, dont la mise en scène discrète voire effacée, les couleurs ternes et la simplicité narrative, permettent de laisser le champ totalement libre à l’essentiel, son personnage sublime et fascinant, vecteur de sentiments profondément justes et subtils. Rien ne viendra parasiter ce centre du récit, interprété par un Eddie Marsan à qui l’on offre enfin un premier rôle permettant de mesurer l’ampleur de tout le talent qu’on lui savait déjà. Tendre, doux, d’une immense pudeur et délicatesse, en plus d’être traversé de moments de grâce époustouflants, Une Belle Fin appartient à cette catégorie de films cantonnés à la discrétion médiatique et pourtant dignes de toutes les attentions.
Un film plein d’humanisme, offert par un humble fils spirituel de Yasujirö Ozu.





ENTRETIEN AVEC UBERTO PASOLINI
Passer de «golden boy» de la City à cinéaste est un parcours un peu inhabituel…
C’est justement parce que tout me réussissait dans la finance que j’ai changé de cap. Je voulais essayer quelque chose où je ne devrais rien aux contacts de ma famille. J’ai donc lâché bureau et secrétaire pour me retrouver à servir le thé sur un tournage, et je ne l’ai jamais regretté ! De David Puttnam, que j’ai accompagné dix ans, j’ai retenu qu’un producteur pouvait aussi être créatif, le moteur des films qu’il produit.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l’aventure humaine qui vous a inspiré ?
C’était comme une vraie aventure…On démarre et on ne sait pas où on va arriver. Au départ, une interview d’une femme qui fait le travail de notre personnage principal, celui de s’occuper des gens morts dans la solitude. Elle parlait des milliers de funérailles chaque année en Angleterre où il n’y a absolument personne. Je suis allé la voir et j’ai passé 6/7 mois avec des gens qui font le même travail qu’elle, dans d’autres mairies. J’étais présent à des funérailles, des crémations, à des visites dans des maisons où les gens étaient morts. Ce sont des moments très forts parce que, dans le cadre de ces visites, on cherche dans les affaires des morts quelque chose, des indications de connections humaines. Dans la majorité des cas, on ne trouve rien, on trouve des numéros de téléphone qui n’existent plus, ou des noms de personnes qui sont déjà mortes, ou rien. Mais en même temps, dans cette maison, la présence humaine de la personne qui n’est pas là est plus forte encore que si la personne était encore vivante et était là, devant vous. Dans le même temps, je suis allé à plusieurs funérailles où j’étais la seule personne présente. Comme notre personnage principal, il y a des gens qui font ce travail avec la même humanité, le même sentiment de l’importance de la mémoire, de reconnaître le passage de quelqu’un sur la terre, mais il y a aussi des gens qui travaillent avec un esprit très bureaucratique, un esprit d’aujourd’hui, de rentabilité, qui se donnent deux semaines pour chaque situation, chaque client, et si dans les deux semaines, ils n’ont pas eu de réponse, ils ferment le dossier et organisent une crémation. Et souvent, ils n’assistent pas à l’enterrement. Alors je me suis trouvé parfois dans la situation suivante…Moi, le cercueil, le prêtre, et personne d’autre. Et c’est une situation très puissante. Vous entrez dans les derniers moments de quelqu’un qui ne vous connaît pas. Est-ce que vous avez le droit de faire ça ? Et en même temps, vous vous sentez représentant de cette famille qui n’est pas là, de cette société qui a oublié ces gens pendant les derniers temps de leur vie. Le film, que j’ai commencé comme une enquête, loin de ma situation hyper-privilégiée, est devenu une enquête sur mon esprit, sur mes sensations, mes sentiments vers l’autre. À cela, s’ajoute le fait qu’il y a 6 ans, j’ai divorcé, et, après 30 ans de vie commune, j’ai redécouvert la solitude. Il y a des jours où je rentre dans une maison vide…Pour moi c’était une nouvelle expérience. J’ai ressenti cette solitude. Donc j’ai mis beaucoup de moi-même, de mes pensées dans le film, sans forcer, c’était quelque chose de naturel. J’ai comme vomi mes sentiments dans l’histoire. Je ne sais pas si j’ai appris quelque chose, mais j’ai mis beaucoup de moi-même dans le film, surtout dans le personnage principal, qui est plus simple, plus drôle, à être très maniaque, très organisé…
Pourquoi alors être passé à la mise en scène ?
Après quelques expériences moins heureuses et un gros projet australien qui a capoté, j’ai découvert cette histoire extraordinaire d’une fausse équipe de handball sri-lankaise qui avait disparu dans la nature en Allemagne. Je me suis tellement impliqué, de l’enquête au scénario, qu’il m’a paru plus naturel de mener l’aventure jusqu’au bout. Mais j’ai aussi compris qu’exercer un contrôle sur un film écrit et réalisé par d’autres amoindrit sa «voix auteuriale». Tout dépend à quel point vous vous sentez proche du sujet. La même situation s’est représentée avec Still Life, qui est né d’une période de crise à la suite de mon divorce. Après avoir été frappé par l’interview d’une employée des pompes funèbres municipales de Westminster, je me suis lancé dans six mois de recherches intenses sur ce travail.
A y repenser, tous vos films ont un petit air de famille !
Parce que je reviens toujours au même genre d’histoire: des gens modestes confrontés à l’écart entre un rêve et la réalité. Les destins exceptionnels ne me parlent pas du tout. Ce qui m’intéresse, c’est trouver l’extraordinaire dans le quotidien. C’est trop facile de faire des films en poussant le volume à fond, l’action, le drame et la musique. Le spectateur sera secoué sur le moment mais n’en gardera pas grand-chose. En revanche, si vous baissez le volume, vous en perdrez bien sûr un bon nombre, mais vous aurez une chance de toucher vraiment certains. Le maître absolu dans ce style, c’est le Japonais Yasujiro Ozu. Sa grammaire est très simple. Résumés, ses films n’ont pas l’air très excitant. Et pourtant, il est difficile de trouver plus émouvant et universel. En toute modestie, Still Life lui doit beaucoup.
C’est la pensée d’Ozu…La vie est simple, et l’homme ne cesse de la compliquer en « agitant l’eau dormante ». Il y a un temps pour la vie, un temps pour la mort, un temps pour la mère, un temps pour la fille, mais les hommes les mélangent, les font surgir en désordre, les dressent en conflits.
Nos sociétés modernes, et le cinéma en particulier, se préoccupent rarement des morts…
Je pense qu’on doit d’abord faire un film pour soi-même, sans préjuger du public. Je suis donc allé à la rencontre de ce dont j’étais curieux à ce moment de ma vie. Ensuite, j’ai eu la chance de trouver des gens qui ont aimé le scénario, y ont cru et m’ont soutenu, m’épargnant le moindre compromis. En fait, j’ai réalisé un film qui, tout en parlant bien sûr de la mort, questionne surtout la vie. Qu’est-ce qui lui donne sa valeur? Je ne pense donc pas qu’il soit déprimant, et son petit succès jusqu’à présent me conforte dans cette idée. Nous l’avons vendu dans le monde entier et depuis il a fait son chemin sans grande publicité, grâce à la critique et au bouche-à-oreille.
La réussite vient d’un savant équilibre entre réalisme et fable ?
C’est venu comme ça. J’ai peu d’imagination et j’aime donc partir du réel. Le personnage de John May s’inspire de personnes que j’ai rencontrées, mais son investissement pour les morts solitaires va bien sûr plus loin, pour éclairer ce problème. Quand on en arrive à jeter les cendres de quelqu’un comme on le voit dans le film, cela en dit long sur la manière dont une société traite les plus faibles. En Angleterre, la fameuse prise de position de Margaret Thatcher qui disait ne pas croire en la société mais seulement en l’individu responsable et en la famille, a fait des ravages. Depuis, le welfare state est devenu l’anathème et tout le discours politique tend à considérer les personnes à charge comme des profiteurs…
Comment avez-vous travaillé les couleurs qui changent et qui passent du gris à une très belle luminosité à la fin du film ?
Une des premières choses que nous avons du étudié était quelle langue, quelle grammaire allons-nous utiliser pour raconter notre histoire ? Je décidai tout de suite que nous devions utiliser une grammaire très délicate. Un volume très bas, très silencieux. Et on a fait ça avec tous les ingrédients du film avec la caméra, qui ne bouge presque jamais, se met à bouger un petit peu, au fur et à mesure de la vie de John May, lorsqu’il découvre de nouvelles expériences. Et pour la couleur, on a fait la même chose, on a commencé le film presque en noir et blanc, avec des couleurs très pâles, très froides, et puis on a commencé à ajouter, dans le décor ou dans l’image, de la couleur. On a fait la même chose avec la musique, pas beaucoup au début, un peu plus à la fin. Mais la chose la plus importante était d’avoir quelqu’un qui restait toujours vrai, qui pouvait communiquer son humanité sans jouer un rôle, sans grands moments d’action, de générosité, de jeu d’acteur. Et s’il y a quelque chose de bon dans le film, je crois que c’est le travail d’Eddie Marsan, qui est un acteur très doué et généreux. Pour lui, travailler dans un film c’est servir l’histoire, ce n’est pas une occasion pour montrer son talent. Il est génial. Il est connu dans le monde du cinéma et est surtout utilisé pour des rôles forts, soit dans la comédie, soit dans le drame. Je savais qu’il était capable de jouer avec le silence…Pour moi c’était très important d’entrer dans la tête du personnage principal sans une série de dialogues entre le personnage principal et les autres qui nous expliquent ce qui se passe dans sa tête. Non, je voulais un contact direct entre le personnage et le spectateur, c’est-à-dire moi-même, car le film est avant tout pour moi-même, avant d’être pour les spectateurs. Je ne voulais pas de barrière. Cela devait être direct, sans dialogue et en même temps extrêmement communicatif. Et je crois qu’il est arrivé à faire cela d’une façon très forte.





Comment l’avez-vous dirigé ? L’avez-vous laissé un peu libre ?
La première chose que l’on a fait c’est d’essayer de reconstruire le ton, la façon d’être, que j’avais dans ma tête depuis l’écriture. Ça, c’était simple, car Eddie, entre talent et technique, arrive immédiatement à vous comprendre. C’était comme travailler avec un instrument de précision, on lui dit « hum », et c’est tout. Mais vraiment, seulement ça, c’était tout ce qu’on avait à lui dire, comme en général, on lui dit de faire « HUM », là c’était plus intéressant. Bien sûr, ce que l’on ne peut pas gérer, et même si j’étais capable d’avoir avec lui le même ton que celui que j’avais dans la tête, il y a une réalité humaine du personnage qui vient complètement d’Eddie. J’avais créé un personnage, Eddie nous donne une personne. Génial.
John May est un prénom très ordinaire, assez commun. Pour l’interpréter, vous avez choisi Eddie Marsan, un comédien hors du commun, au physique singulier. Comment l’avez-vous convaincu de prendre part à ce projet ?
J’ai voulu donner à mon personnage un prénom très commun, le plus basique possible. Et comme vous avez pu le voir, j’ai choisi de faire mon film avec un grammaire très simple réalisé en caméra fixe. J’avais besoin de quelqu’un qui soit capable de communiquer énormément sans trop en faire. J’avais travaillé avec Eddie il y a quelques années, je savais qu’il pouvait s’impliquer énormément sans parler, sans faire l’acteur qui cherche à trop « jouer le personnage ». J’ai écrit ce personnage avec une photo d’Eddie devant moi. C’est un acteur assez connu en Angleterre, par le théâtre ou quelques seconds rôles marquants au cinéma. Les gens ne retiennent pas forcément son nom, mais il a un talent extraordinaire, une technique impressionnante et c’est un acteur généreux. Il ne les utilise que pour servir son personnage, pour le créer en fonction de ce qu’a écrit le réalisateur.
Je ne voulais surtout pas d’une star, pour qu’on puisse vraiment croire à la réalité de ce personnage, à son job, à sa générosité, à son inconscience de sa propre solitude. Eddie a joué dans beaucoup de films, mais en général des seconds rôles plutôt outrés, y compris chez Mike Leigh. Je l’avais repéré en valet de Napoléon dans The Emperor’s New Clothes, mais il a dépassé toutes mes attentes. C’est un comédien fabuleux qui ne donne même pas l’impression de travailler. La vérité du personnage lui doit énormément. S’il ne fallait retenir qu’un point positif de mon film, ce serait le travail d’Eddie Marsan dans la peau de John May. Il est fantastique.
Est-ce qu’il y a une morale du film par rapport à la société actuelle ?
Non. C’est-à-dire que, comme ce film est un voyage tout à fait personnel, je ne suis pas dans la position d’expliquer au monde comment il faut vivre. Il n’y pas de message, pas de leçon, je suis la dernière personne qui puisse donner des leçons à quiconque. Juste, peut-être, de s’ouvrir un peu plus. La chose la plus présente dans mes pensées, c’est mon incapacité à m’ouvrir aux autres. Je suis une personne très curieuse et je suis intéressée par votre vie, par exemple. J’aimerais savoir ce qui se passe dans votre vie, avec vos amis, dans votre travail, et je pourrais passer trois heures à parler de vous. Mais si vous me posez une question sur moi, j’ai tendance à fermer la porte. Je me suis rendu compte que c’était bien plus simple d’être curieux que d’être généreux. Si je peux espérer quelque chose, ce serait que, sur les milliers de gens qui iront voir le film, il y aura au moins un spectateur qui ira frapper à la porte du voisin en rentrant chez lui. Ou mieux, que si quelqu’un frappe à sa porte, qu’il la lui ouvre. C’est ça la générosité, c’est quelque chose que je n’ai pas mais je la comprends.
La préparation du film s’est transformée en une expérience de vie…
Enfin, j’ai voulu parler de la solitude. Après trente ans de vie commune, j’ai redécouvert ce qu’était la solitude. Même si je vois mes filles régulièrement, certains jours je rentre chez moi dans une maison vide. Je sais que tout cela est très commun mais c’était presque une expérience nouvelle pour moi, rentrer chez soi, dans une maison vide et ouvrir les rideaux pour faire rentrer la lumière, allumer la télévision ou la radio pour avoir un peu de présence humaine. Cela m’a vraiment frappé. Finalement, la préparation du film a commencé comme une enquête sociale et s’est transformée en une expérience de vie en quelque sorte. Depuis, j’ai eu envie de faire connaissance avec mes voisins. Je me suis présenté à leur porte un soir, avec une bouteille de vin, pour me présenter. Ils ont sûrement du se demander à qui ils avaient à faire en me voyant comme ça…
Le titre original du film est « Still Life », dont le mot « life » ressort particulièrement. Parler de la mort pour mieux parler de la vie, était-ce là votre démarche avec Une belle fin ?
Pour moi, c’est un film sur la vie, pas un film sur la mort. C’est très important. Pourquoi est-ce un film sur la vie ? Car c’est un film sur les relations humaines, celles des gens qui sont en vie. Il n’est pas question de ce qui se passe après la mort mais plutôt de ce qui se passe avant, de comment on gère notre vie et notre lien avec les autres. Pour moi, c’était très important que le titre n’ait pas de lien avec la mort. « Still life » en anglais, c’est l’expression que l’on utilise pour dire « nature morte ». Mais cela veut aussi dire « une vie immobile » mais aussi « toujours en vie » (« Still alive ») et enfin « still » renvoie aux photos, aux souvenirs qu’on immortalise. J’ai insisté auprès des distributeurs pour que cette dimension ressorte dans les titres en Allemagne, en Italie ou en France où ils ont trouvé le titre « Une belle fin ».
Un titre polysémique également…
Je l’aime aussi, car on peut le lire de plusieurs façons. Une belle fin, c’est ce qu’il essaie de donner à ses clients. Une belle fin, parce que le film a une belle fin. Et puis le mot « fin » peut être un synonyme de « but » à atteindre. J’aime ce titre également. Les allemands, eux, ont choisi un titre très long…Monsieur May et le souffle de l’universel...On change souvent les titres d’une façon très étrange…
Une belle fin est un film très réaliste et cette fin se distingue…
J’espère que vous n’allez pas raconter la fin à vos lecteurs ! Mais je vais vous répondre malgré tout…C’est une image que j’avais en tête dès le départ, avant même de commencer mes recherches pour le film. J’avais cette vision d’un homme, solitaire, dont la vie se termine de la même façon que la vie de ces milliers de gens dont il s’est occupé. Votre question porte sur les dernières vingt secondes du film…C’est exactement ce que j’avais en tête. C’était une décision émotive, instinctive. Pas intellectuelle. Et je l’ai compris plus tard. J’ai compris que j’avais besoin de terminer le film d’une façon à ne pas nous faire oublier la valeur de cet homme, la générosité de celui-ci dans son travail. Je voulais signifier que toute cette dévotion dont il fait preuve n’était pas vaine. C’était aussi une façon de renvoyer à cette scène où son supérieur lui dit que « les funérailles sont pour les vivants, pas pour les morts » et que lorsqu’il n’y a personne pour y assister, cela n’a aucun intérêt. D’une certaine façon, il a raison. Mais Alors là où il se trompe, c’est que ces funérailles sont aussi pour tout le monde, pour la société. La façon dont on gère les cendres de ces personnes disparues caractérise aussi la manière dont on gère, avec sensibilité ou pas, toutes les situations impliquant les plus défavorisés, les orphelins, les toxicomanes…Dès lors que l’on traite ces cas-là avec un manque de considération et une vision de rentabilité, on oublie la question de l’humanité. C’est tragique. Pour moi, c’était donc très important de terminer le film de cette façon. La fin du film devait avoir une signification pour moi-même. Et si cette fin parle aussi aux spectateurs, tant mieux.
On me demande pourquoi j’ai réservé un tel sort à mon personnage…Je ne voulais pas que le spectateur ait à se projeter sur la belle vie qu’il pourrait avoir par la suite. Je veux qu’il se dise que la vie qu’il a eu jusqu’à maintenait était une belle vie. Une vie faite de générosité, remplie de la vie des autres. Je ne voulais pas sortir de cette expérience en oubliant la dévotion dont cet homme avait fait preuve. J’espère que si les gens sortent du film avec quelques larmes, ce seront des larmes positives, une belle émotion plutôt que de la tristesse.
Pensez-vous que les réseaux sociaux peuvent contribuer à créer du lien ?
Oui et non. J’ai un peu peur qu’internet donne l’impression aux gens d’être mis en lien avec le monde, avec les autres. Je crains que la majorité de ces relations soient faussées. Pourquoi ? Parce que pour moi, le contrôle d’une relation appartient aux deux personnes. Dès lors que vous pouvez interrompre un échange en appuyant simplement sur une touche, alors ce n’est pas une vraie relation. Une vraie amitié se construit ensemble, un compromis entre deux personnes. Bien sûr, internet permet de rencontrer des gens, mais l’important est de donner suite à cette connexion virtuelle à une relation physique. J’ai peur que certaines personnes se construisent une identité sur internet, se construisent une personnalité qui n’est pas la leur. Il y a vingt ou trente ans, les gens timides étaient obligés de sortir pour trouver un contact humain. Bien sûr, certains ne sortaient jamais. De nos jours, ils n’ont même plus l’obligation de sortir car ils pensent qu’ils peuvent trouver ce contact par le biais d’une machine. Bien sûr, internet a d’énormes avantages. On peut faire beaucoup de choses, établir des contacts, créer des situations…Cela facilite la vie. Mais l’autre soucis avec internet est que c’est très chronophage. On rentre le soir, on perd son temps sur Youtube, à s’occuper l’esprit avec des vidéos stupides pour se vider la tête…Ce temps là est gaspillé…On aurait pu l’utiliser pour créer du lien avec son voisin.
J’aimerais terminer cet entretien par un trait d’humour en lien avec votre film…Vous qui avez eu une vie remplie, personnellement et professionnellement, qu’aimeriez-vous que l’on dise au moment de votre éloge funéraire ?
J’ai une réponse simple à vous donner. Comme le dit le patron de John May dans le film, je ne serai pas là. Mes filles seront là, ma famille aussi. La seule chose que je puisse souhaiter est que ce moment-là soit davantage un moment de joie que de tristesse pour mes filles. J’aimerais qu’elles voient mes amis autour d’elles, qu’elles voient les connexions humaines que leur père a su créer, afin qu’elles puissent gérer ce moment avec un certain bonheur en voyant la vie que j’ai eu.








INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
par Adrien Mitterrand
Le métier de John May consiste à enquêter sur la vie de personnes isolées qui viennent de mourir, afin d’écrire le discours de funérailles auxquelles il sera seul à assister. Ses recherches devraient en fait se limiter à contacter leurs éventuelles familles le temps de préparer l’incinération des corps, mais ce fonctionnaire méticuleux s’évertue à transformer chacune de ses enquêtes en une affaire personnelle. Ceux que le cinéma de maîtrise rebute risquent de rester insensibles devant cette précision d’horloger partagé avec son personnage. Aussi soigneux l’un que l’autre, tous deux poursuivent en fait le même but, révéler par la fiction la présence de ceux qui restent habituellement hors champ.
Au début, une succession de plans fixes nous laisse explorer les vestiges d’un quotidien. Nous reconstituons avec le protagoniste les gestes de celle qui investissait les lieux avant sa dernière heure. Le passé s’empare des décors immobiles, pour donner le temps de parcourir des yeux ce qui s’apparente à un portrait en creux. En se concentrant sur une photo, une lettre, une bouteille de lait, ou encore un lit défait, John May interprète, imagine, et écrit sur la personne qui a imprimé sa présence sur les lieux. Dans ce monde découpé dans des cadres irrémédiablement fixes, naît alors la projection d’un mouvement disparu. Uberto Pasolini prépare en fait le spectateur à regarder son protagoniste de la même manière. Chaque cadrage, tout autant que chaque point de raccord, révèle un trait de caractère, une habitude, qui resteraient invisibles sans leur révélation par les procédés du cinéma. L’imagination investit jusqu’au moindre détail, et s’insinue dans ce qui est d’abord perçu comme une simple toile de fond. La fenêtre d’une façade d’immeuble que nous pouvons désormais relier au logement d’un personnage ouvre à elle seule la possibilité d’entrevoir ce que cachent toutes les autres. L’insignifiant devient signifiant, dans un procédé qui a cette subtilité d’encourager l’envie d’explorer chaque recoin de l’image, plus que de ne forcer le regard vers un élément en particulier. Point de fuite de ce travail patient de composition, l’acteur Eddie Marsan irradie chaque scène tantôt d’une mélancolie bienveillante, tantôt d’un humour irrésistible.
Dans une dernière enquête qui occupe la majorité du film, John May va devoir s’intéresser à un certain Billy Stoke. Assumant leurs obsessions de la maîtrise, Uberto Pasolini et son personnage esquissent méthodiquement les contours d’une vie chaotique qui se révèle au fil des traces qu’elle a laissées. Progressivement, le film se laisse aller au mouvement, en même temps qu’il se peuple de personnages secondaires. L’histoire déjà achevée de Billy Stoke révèle sa sortie progressive des cadres, payée au prix fort de ne plus pouvoir en intégrer aucun. La séparation entre le champ et le hors champ change alors de statut. Elle ne s’interpose pas entre les vivants et les morts, elle est la clôture qui exclue ceux qui se situent au delà des images par lequel le monde se représente. Et dans une dernière scène qui laisse d’abord croire à un dénouement tristement convenu, cette frontière entre visibles et invisibles s’efface finalement au moyen d’un ancestral effet de cinéma. Il n’en fallait pas plus pour que la rigueur sans faille du film se révèle être l’expression d’une émouvante modestie.