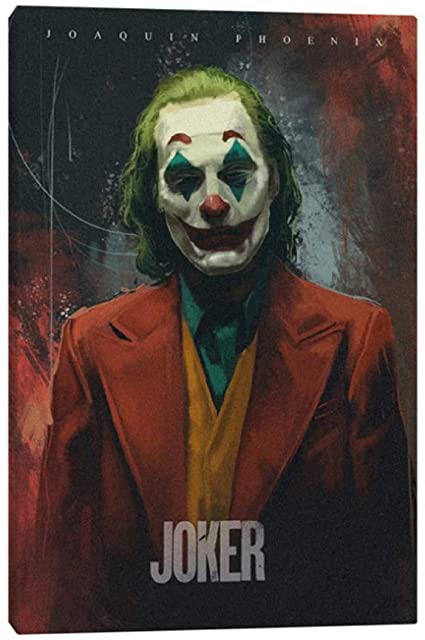Todd Phillips a raconté qu’il avait dû supplier Joaquin Phoenix d’accepter le rôle, se rendant chez lui tous les jours jusqu’à ce qu’il lui donne une réponse…Je dis toujours qu’il n’a jamais vraiment signé pour le film. Un jour, il est simplement venu à un essai de costumes. La relation est très forte entre les deux hommes, qui se parlaient et s’envoyaient des SMS tous les jours après le tournage pour discuter des possibilités et des idées qu’ils avaient sur l’histoire et le personnage…Je ferais n’importe quoi avec Joaquin. C’est l’un des meilleurs acteurs, mais c’est aussi l’une des meilleures personnes que j’aie jamais rencontrées. Réalisateur, c’est un travail très difficile, et c’est tout aussi difficile de faire un mauvais film que d’en faire un bon…Les réalisateurs ont tendance à être plus sous-estimés que surestimés parce que c’est un travail caché et que les gens ne le comprennent pas vraiment. Bien que le lieu de résidence de Batman et de ses ennemis soit la ville fictive de Gotham, elle a été inspirée par New York, et elles ont toujours été liées. Malgré cela, Joker est le premier film de l’univers de Batman à avoir été tourné presque exclusivement à New York et dans les environs.
Je prends la musique très au sérieux. Je pense que c’est l’un des outils dont dispose un réalisateur pour peindre une scène. La scène où l’on voit Arthur Fleck danser dans la salle de bains. il dit l’avoir modifiée après un échange avec Joaquin Phoenix de ce que son personnage ferait à ce moment précis de l’intrigue, à commencer par la pièce musicale que l’on entend en arrière-plan. Phillips s’est montré ouvert aux opinions et aux suggestions de son acteur.

Filmographie
2000 – Road Trip
2003 – Retour à la fac
2004 – Starsky et Hutch
2006 – L’École des dragueurs
2009/2011/2013 – Very Bad Trip
2010 – Date limite
2016 – War Dogs
AVERTISSEMENT. Face à la richesse du sujet et les nombreux films qui s’intéressent depuis quelques années au personnage du Joker vous trouverez quatre approches différentes et parfois contraires pour parler du film et ce qu’il représente dans la société d’aujourd’hui. A lire également un très cour entretien avec Joachim Phoenix qui parle de son travail sur le Joker. JP






JOKER par Mickaël Lanoye
La campagne promo de Joker a commencé sur les chapeaux de roues en septembre 2019, alors que le film de Todd Phillips remportait le très prestigieux « Lion d’Or » à Venise. Ça y est, se disait-on alors, les critiques ont enfin compris que le cinéma de genre pouvait contenir en son sein des qualités bien réelles, et l’on se réjouissait qu’un film affilié à une tradition du film de super-héros se voit distingué d’aussi remarquable manière. Ce fut la déferlante sur les réseaux, le film était unanimement décrit comme un chef d’œuvre absolu, Todd Phillips se voyait comparé à Martin Scorsese, le génie de Joaquin Phoenix était loué de toutes parts. Le film a cassé la baraque au box-office et premier film classé Rated-R de l’histoire à dépasser la barre du milliard, avec 6 millions de français dans les salles. Pour autant, pour nombre d’observateurs un peu plus éloignés, la bande-annonce du film ne laissait aucunement présager une telle unanimité, qui pouvait même paraître un peu douteuse, voire suspecte car Joker affichait en effet, à priori, tous les atours traditionnels de l’origin story la plus classique qui soit, revenant sur les traumatismes du personnage qui allaient le changer en psychopathe ou en « super-méchant » si vous préférez. Ainsi, sans l’avoir même encore découvert, on pouvait avoir l’impression d’avoir déjà vu cent fois auparavant le film de Todd Phillips. Étrange impression qui se confirmera en partie à la découverte du film. Mais en partie seulement…
Une vraie claque visuelle
Car si le scénario n’apporte rien de neuf au genre de récit qu’il aborde, si on ne sera jamais réellement ni surpris ni saisi par le déroulement des événements qui nous sont relatés si secs soient-ils, les éclairs de violence sont tout à fait prévisibles on admettra en revanche que l’on ne s’attendait pas à de tels partis pris esthétiques. On passera rapidement sur les évidentes références au cinéma de Martin Scorsese, qui ont été évoqués en long, en large et en travers depuis la sortie du film, l’ambiance délétère du métrage évoquera forcément au cinéphile le souvenir de films tels que Taxi driver et La valse des pantins, impression encore renforcée par la présence au casting de Robert De Niro. Plongeant le spectateur dans une ambiance furieusement 70’s même le logo Warner se la joue rétro, Joker évoquera également forcément les grands polars urbains de cette décennie-là, les films de Friedkin à la French Connection avec les escaliers d’Anderson Avenue évoquent ceux de L’exorciste, même si ces derniers se situent à Georgetown et bien sûr Un justicier dans la ville pour la scène du métro impossible de ne pas y penser. Pour autant, le film parvient à se créer une esthétique, sous influence certes, mais qui lui est propre. Le tout est d’ailleurs magnifié par des plans steadicamés amples, impressionnants, et par la photo de Lawrence Sher, tout simplement sublime, en plus de s’avérer extrêmement iconique dans le dernier acte du film, quand le « méchant » se révèle. Bien sûr, parmi les points forts, il y a l’interprétation de Joaquin Phoenix, qui semble parfois certes un peu en roue libre, mais qui s’avère comme toujours vraiment très habité par son rôle, et confère au personnage une humanité telle qu’il suscitera au final bien d’avantage la pitié que la peur cela pourrait se révéler un problème mais dans le fond, la façon dont Todd Phillips et son co-scénariste Scott Silver intègrent le personnage dans la « timeline » de l’univers de Batman tendrait à suggérer qu’Arthur Fleck n’est qu’une première incarnation du Joker, et que d’autres criminels suivront ses pas par la suite, reprenant sa tenue et sa façon de se grimer. En effet, si l’on se base sur les faits relatés dans le film, Fleck aurait probablement dans les 70 ans s’il était amené à s’opposer par la suite à une version adulte de Batman.

Nez rouge et gilet jaune…
Ce qui fera le prix de Joker réside dans la façon subtile dont le film capte l’air du temps et intègre une toile de fond assez subversive à un récit prenant place dans un univers diégétique beaucoup plus éloigné du notre. Ici, Gotham, c’est New York, et inversement « Is it just me, or is it getting crazier out there ? » demande d’entrée de jeu le personnage d’Arthur Fleck à sa thérapeute. Et il est vrai que le monde tel que nous le montre ici Todd Phillips semble de plus en plus inégalitaire, avec d’un côté le peuple obligé de vivre dans des taudis, sans un rond ni accès aux soins, tandis que de leur côté, bien à l’abri derrière des barricades de police, les riches et les puissants de ce monde prennent du bon temps en regardant, dans le luxe et l’opulence les plus démonstratives, Les temps modernes de Charlie Chaplin. Sans un regard pour le reste du monde. Pire encore, le magnat de l’industrie Thomas Wayne fait preuve d’un mépris caractérisé pour la classe ouvrière, qualifiant les pauvres de « clowns ». Cette dichotomie est montrée sans la moindre nuance par Phillips au cœur du film, mais elle a le mérite d’être aussi explicite qu’efficace. Dans les bas-fonds, la colère gronde, et il n’en fallait pas plus pour que le peuple prenne le parti d’un meurtrier, quitte à s’armer pour aller casser du flic et du riche le tout dans une optique d’insurrection, de façon à redistribuer les richesses de façon un peu plus équitable.
Sous l’effet d’un impitoyable climat de violence sociale, qui broie littéralement les individus pour les recracher sans la moindre lueur d’espoir concernant l’avenir, la folie du Joker devient donc idéologique, et le film de nous emmener, durant son dernier acte, là où on ne l’attendait pas forcément. Alors qu’il surplombe la foule, le personnage ouvre grand les bras, réitérant le geste qu’il avait déjà fait lors de son passage sur la scène du Pogo’s « No one’s laughing now ». En effet, plus personne ne rit, il a ouvert une voie, est devenu un guide une lueur née du chaos et destinée à guider les autres à travers ce chaos. Comme le dit la chanson de Sinatra lors du générique final « Send in the clowns » faites entrer les clowns, il n’est que le premier, mais d’autres suivront…






VERY MAD TRIP par Luc Chessel
Joker est un déchaînement. S’il se déchaîne sur nous, il déchaîne aussi quelque chose de nous, ce «nous» dont il met d’ailleurs en question l’existence, ou dont il montre à quel point l’existence est par ailleurs remise en question. Il le fait non pas avec «une rare violence», selon l’expression consacrée, mais avec toute la violence actuelle, abondante, en circulation autour de lui, aux États-Unis et ailleurs. L’histoire en cours de sa réception déchaînée vaut d’ores et déjà comme une bonne capsule de notre époque. Et si ce qu’il déchaîne est avant tout de l’ordre de l’opinion, et des flottements de celle-ci, c’est aussi parce qu’il l’enchaîne ou le ré-enchaîne en permanence à ses interprétations possibles, multiples, plus périlleuses et inconfortables les unes que les autres, toutes violentes, et insuffisantes, mises en tension à l’intérieur du film. Toujours est-il que Joker transforme, en sachant qu’il le fait et en sachant ce qu’il fait, une violence environnante sociale en violence de cinéma. Il le fait avec colère et avec méchanceté, deux grandes vertus d’Hollywood qui d’habitude, ne se vante pas ouvertement, préférant les distiller en douce plutôt que de nous les lancer, comme ici, en plein visage. Il fallait peut-être un Todd Phillips. Qui est Todd Phillips ? Personne, un réalisateur…Starsky et Hutch + trois fois Very Bad Trip ou un clown de réalisateur. Un type très louche. Il fallait Joaquin Phoenix. Qui est Joaquin Phoenix ? Un acteur, et il fallait un acteur, qui jouerait le clown d’un acteur, ou le clown d’un clown, c’est-à-dire quelque chose d’exagérément ridicule et inquiétant. Avec colère et avec méchanceté, Phillips et Phoenix disloquent et réinventent de toutes pièces le Joker, célèbre méchant de Batman, pour porter un coup fatal à l’ère Marvel Studios, en faisant l’inverse d’un film de comics ou de super-héros convenable, tout en en singeant la mécanique héroïque mais en prenant sans réserve le parti du mal, sous son plus mauvais jour possible, sans le présenter comme le parti du bien, donc sans rien renverser des valeurs en circulation, laissées telles quelles à leur point de confusion maximal, et sans lui chercher d’excuses avec tout au plus quelques explications biographiques incertaines.
Arthur Fleck, souffre-douleur absolu, clown à la petite semaine, humoriste raté, psychotique bientôt psychopathe, vit avec sa mère dans les marges d’un Gotham City qui réplique en tout point le New York du début des années 80 et de l’ère Reagan, ère pré-Trump, époque Trump Tower. Un concours de circonstances combinant l’aggravation de son état mental suite à la fermeture du service qui le suivait, le durcissement de l’atmosphère politique et médiatique, des inégalités et de la précarité urbaine, et une série de révélations brutales sur ses origines le pousse à des passages à l’acte de plus en plus incontrôlables et meurtriers, déchaînant bientôt le chaos et la révolte dans les rues de Gotham, et donnant naissance au personnage du Joker tel que la tradition le connaissait jusqu’ici, mais rendu bien plus angoissant d’être passé, sous nos yeux et en deux heures, du coin de la rue à la légende. Or c’est le coin de la rue qui part ici en flammes avant la légende, et tout ce que le spectateur de Joker croira y reconnaître du monde où il vit le plongera dans un malaise et dans une tension dont le film joue, bien décidé, comme son personnage, à tous nous niquer la tête. Plutôt que de passer le temps du film à se demander si son «discours», peut-être introuvable, penche du côté de Trump ou de son contraire…anti, mais anti-quoi ? antidote ou antifa, peut-être anticapitaliste, plus sûrement anti-tout, partagé entre deux négativités, entre une violence et son opposé, encore indistinct, avec des arguments solides dans chaque direction de l’interprétation, on a tout intérêt à s’abandonner à cette tension dont le film propose de jouir tout en présentant cette jouissance comme impossible.

Joker est un déchaînement d’ambiguïté, c’est sa manière de décrire l’Amérique présente sans s’en excepter, de la mettre en scène avec les moyens qu’elle offre, et selon ses coordonnées de tous bords. Voici donc «film populisme», film-maintenant, mais filmé, pour en rajouter une couche, dans les formes de l’époque qu’il reconstitue et exagère, soit le cinéma new-yorkais de la fin des années 70 début des 80, Joker étant un remake de la Valse des pantins de Scorsese, qui donne ici à De Niro le rôle dans lequel Jerry Lewis lui faisait face, et imitant ailleurs Taxi Driver. Le film rejoue le conflit formel et idéologique, daté et datant d’alors, du cinéma et de la télévision, comme pour évoquer et écarter ce qui nous reste à penser de l’emprise plus contemporaine d’autres médiums sur le cinéma et sur la politique. Mais tous ces éléments, réactionnaires ou progressistes pour les formuler avec les mots d’un dualisme américain que Joker cherche à faire exploser, en demandant aussi en creux à qui cet effacement profite, dans le contenu comme dans la forme, ne reposent en définitive que sur les épaules décharnées de l’acteur. Joaquin Phoenix joue en Arthur Fleck l’anti-comique qui espère tant accéder à la célébrité par un art du stand-up dont il est profondément incapable, moins la folie de Joker celle, anticomics, qui nous dit que le capitalisme rend fou que la folie de l’acteur en général, son désir d’être vu, et pas seulement d’être vu mais regardé, et moins d’être regardé que d’être aimé, et plus encore qu’aimé, d’être compris. Folie par quoi le cinéma américain existe, ici bizarrement avouée et déconstruite par un jeu entièrement en force, un surjeu, mais qui ne joue que son impuissance et sa faiblesse à être quelque chose en vérité. Un post-jeu.
Si on se souvient que Walter Benjamin, en 1939, mettait en parallèle la vedette et le dictateur, la star et le Führer, leur nouvelle stature commune modifiée par l’invention du cinéma et de la radio, par la «sélection devant l’appareil», on comprend peut-être pourquoi le seul film cité directement par Joker est un film de Chaplin pas le Dictateur mais les Temps modernes, et un peu mieux ce que le film fait en réinventant pareil clown triste, et la contagion de ce clown, son extension, sous forme de masques, à tout Gotham qui brûle. C’est tout le cinéma que Joker brûle, et il fait mouche. Or un film ne fait pas mouche par les éléments qu’il prélève directement sur le social avec la colère populaire, brutalisation du monde, grimaces d’un pouvoir à double face, Joker-Wayne, mais pas non plus par les solutions de figuration qu’il leur trouve, plutôt par celles qu’il ne leur trouve pas, les problèmes de représentation qu’il se pose et qui restent insolubles le temps d’un film, comme ils le restent en dehors de lui dans la société. Le génie de Joaquin Phoenix est de ne pas trouver, devant nous, comment jouer ou interpréter Joker, mais d’exposer seulement le désir et l’urgence de le faire. Il met le spectateur dans la situation identique d’une interprétation politique urgente, mais qui se dérobe sans cesse sous la gesticulation, affolée et nymphomane, des images du pouvoir et du pouvoir des images.






LE MONDE EN SPECTACLE…
Une parenthèse sombre dans un monde de paillettes Joker était annoncé comme tel, la descente aux Enfers d’un homme trahi et détruit par la société et par le monde qui l’entoure. C’est d’ailleurs ce qui l’avait fait réévaluer mon attente vis-à-vis du film, espérant voir ainsi une histoire à part entière, capable de s’affranchir le plus possible de toute la mythologie qui l’entoure. Les films de super-héros et consorts dominent les débats depuis une bonne dizaine d’années, trustant les cimes du box office, attirant un public très large, pour imposer des standards dans lesquels ils finissent fatalement par s’embourber eux-mêmes. Joker restant indissociable de Batman, il était difficile de réellement s’éloigner de ce cadre. C’était le cas de la trilogie du Dark Knight de Nolan, qui avait pour avantage d’être sortie avant cette hégémonie super-héroïque pour suivre ses propres codes. Mais c’est aussi le cas de Joker, qui vient offrir une parenthèse sombre dans un cinéma hollywoodien bien trop souvent renfermé dans son monde de paillettes. Joker est un film négatif, dans le sens où l’espoir y est quasiment absent, et que chaque petite lueur est rapidement éteinte. Le personnage d’Arthur Fleck, à peine relevé de la dernière épreuve, est aussitôt remis à terre, pour montrer sa fragilité, mais pour aussi montrer toute l’horreur et la cruauté du monde qui l’entoure. Fleck est le réceptacle de tous ces maux et de toutes ces souffrances, catalysant celles du spectateur pour solliciter son empathie et réveiller son indignation. Arthur Fleck n’est qu’un homme parmi tant d’autres qui cherche à réussir dans la vie, à trouver le succès dans ce qui lui plaît, et à obtenir la reconnaissance de ses pairs, qui ne le lui ont encore jamais accordée. Son créneau, c’est l’humour. Il rêve d’écrire son propre stand-up pour se produire devant le public, tout en passant ses soirées à regarder les émissions de son idole Murray Franklin. Le rire, maladif chez lui, doit aussi être un exutoire, un moyen de communiquer avec cette foule qui l’ignore, voire qui le méprise. Mais cette communication est impossible, comme en témoigne la scène du stand-up.
Joker s’annonce comme un film à spectacle de par son statut de film hollywoodien à gros budget, mais il n’hésite pas à dénoncer cette même culture du spectacle, et ses effets destructeurs. Il se donne en spectacle, pour et malgré lui. Il est pointé du doigt, frappé, moqué, humilié. Le spectacle, la célébrité et la reconnaissance font rêver et, pourtant, la route qui mène à tous ces objectifs est semée d’embûches. Le rôle du personnage de Murray Franklin et son influence sur le public sont d’ailleurs des éléments centraux de cet axe de réflexion proposé par Joker. Le public veut du spectacle, il s’en abreuve, pour s’extirper de son propre quotidien et de ses problèmes. Fleck fait partie de ceux qui apprécient ce spectacle offert par Franklin, ces jeux de rôles et d’apparence, mais sa naïveté ne lui font pas aborder les choses de la même manière que les autres. Et c’est ici que Joker réussit à être intéressant, dans la mesure où il s’annonce comme un film à spectacle de par son statut de film hollywoodien à gros budget, mais il n’hésite pas à dénoncer cette même culture du spectacle, et ses effets destructeurs. Joker ne parle pas que du monde du spectacle et de la place de ce dernier dans la société, il offre une vision plus globale de la société, à travers le prisme du spectacle, mais aussi de l’humour, et de la violence latente qui l’habite. Arthur Fleck est prisonnier de ses troubles mentaux qui l’empêchent d’interagir normalement avec une société qui le rejette pour ses différences, les moyens de se faire entendre et, surtout, écouter, sont bien peu nombreux. A force de brimades et d’incompréhension, Fleck n’a plus qu’un recours la violence…Le film fait de Fleck la victime de cette violence, pour qu’il finisse par se l’approprier, et en devenir lui-même l’incarnation. Cette violence, physique et psychologique, est omniprésente dans Joker. Le film fait de Fleck la victime de cette violence, pour qu’il finisse par se l’approprier, et en devenir lui-même l’incarnation. La scène du métro représente le tournant de ce processus qui scelle la transformation d’Arthur Fleck en Joker. Elle fait de lui un symbole, une figure que s’approprie le mouvement de contestation qui grandit à Gotham, qui s’apprête à se transformer en véritable mouvement populaire. A l’image des gangsters dans les années 20 et 30, le Joker devient une source de fascination, un personnage dangereux servant cependant d’icône pour ceux qui veulent renverser le système. Dans toute cette cacophonie, et avec tant de tension, la violence devient le seul moyen d’expression qui reste, comme une sorte de retour aux origines.

Joker a le mérite d’être dans son époque, à traiter de sujets d’actualité, à cerner des choses intéressantes sur la psychologie humaine, il n’est pas non plus le grand film, voire le chef d’oeuvre que certains décrivent. En étant parfois trop explicite, peu subtil par moments, il n’esquive pas les écueils de ces films « grand public » qui semblent sous-estimer la capacité des spectateurs à comprendre par eux-même. J’ai lu quelqu’un qui disait qu’il aurait adoré ce film s’il était adolescent. C’est un film énervé, en colère, qui évacue et assouvit nos propres pulsions, mais qui se retrouve quelque part emprisonné par elles. On pourrait le mettre dans la lignée d’un Fight Club, mais ce dernier reste plus subtil et plus profond. Néanmoins, il est intéressant de voir un tel film obtenir un tel rayonnement et bénéficier de tels moyens, même s’il y a fort à parier que, sans l’image du Joker, cela aurait été une toute autre histoire. Un petit coup de pied dans la fourmilière qui fait du bien, qui ne prend pas ses spectateurs pour des idiots, et qui, contrairement à beaucoup de ses pairs, va pouvoir continuer à évoluer dans la conscience commune.
Le « Joker » est celui qui fait rire, et c’est pour cette raison que l’humour tient une place très importante dans le film. Dans le sens où il propose une certaine réflexion sur la place de l’humour dans la société. C’est ce qui a valu à ce Joker d’être considéré comme assez réactionnaire, notamment suite à certains propos tenus par Todd Phillips sur le fait que l’on ne peut plus rire comme on veut de ce qu’on veut, car certains ont décidé que c’était désormais interdit. C’est d’ailleurs un message relayé de manière assez explicite dans le film…Certains détails, certaines situations, certains éléments de récit, visent à nous confronter à notre propre considération des choses, et à faire l’expérience directe de notre rapport aux messages véhiculés par le film. Ce qui est intéressant sur l’humour, c’est dans sa capacité à jouer avec le spectateur. Certains détails, certaines situations, certains éléments de récit, visent à nous confronter à notre propre considération des choses, et à faire l’expérience directe de notre rapport aux messages véhiculés par le film…Dans la scène où les anciens collègues de Fleck lui rendent visite, ce dernier se venge sur l’un d’entre eux en le tuant. L’autre, atteint de nanisme, est épargné par Fleck qui le terrorise. La situation a un côté certes grotesque, mais crée un véritable moment de tension. Or, lors de cette scène, le public s’est mis à rire alors que la situation n’est pas drôle. Ces rires trouvent un écho, plus tard, dans ceux que l’on entend lors de l’émission en direct de Murray Franklin, où le public rit alors qu’il ne devrait pas rire. C’est donc là le film nous questionne, à savoir comment se comporter et agir dans une société qui cherche toujours à nous dire qui aimer, qui détester, à quoi peut-on rire, à quoi ne peut-on pas rire… Alors on rit quand même, mais est-ce drôle ?
Joker a des qualités, c’est indéniable. On ne peut lui faire beaucoup de reproches en matières de mise en scène, et encore moins sur la performance de Joaquin Phoenix. C’est un film qui a pour principal intérêt d’être capable d’être grand public tout en restant grave et sombre, ce qui est trop peu commun de nous jours, où les producteurs considèrent qu’il faut systématiquement un happy ending pour que le public soit satisfait. Or, ce n’est pas le cas, et on le sait d’emblée en allant voir le Joker. Les foules qui se pressent pour aller le voir, présageant un beau carton au box-office, le prouvent en partie. Le « en partie » fait bien entendu référence au fait que le film partait gagnant d’emblée grâce au fait qu’il parle d’un personnage déjà très célèbre et très apprécié du grand public, ce qui fait que l’on peut garder quelques réserves quant au succès de tels films sans la présence d’un tel personnage.




Dans la peau du Joker,
j’ai vécu le meilleur moment de ma vie !
par Renaud Baronian
Ce n’est pas sans appréhension que nous pénétrons dans la chambre d’un palace parisien où Joaquin Phoenix, 44 ans, comédien à la filmographie impressionnante « The Yards », « Walk the Line », « Les Frères Sisters » nous attend. Réputé difficile, il a souvent interrompu brutalement des interviews. Mais il nous rassure d’emblée…J’aime bien avoir des conversations seul à seul avec des journalistes de presse écrite, ce que je n’apprécie pas ce sont les interviews télé en cinq minutes, on répète les mêmes choses infiniment. Rencontre avec celui qui livre ici la performance de sa vie.
Est-il vrai qu’avant le tournage, vous avez eu de longues conversations durant trois mois avec Todd Philipps ?
C’est vrai que j’avais plein de questions. Quand je m’attaque à un personnage, j’aime essayer de le cerner le plus possible en amont. Todd m’avait montré un documentaire qui évoquait les effets secondaires très lourds de certains médicaments contre la dépression, et qui pouvaient induire des comportements criminels. Je voulais en savoir plus sur la corrélation entre ces médicaments et les « pensées négatives » qu’ils peuvent provoquer. Nous avons beaucoup parlé de ce cas, et c’est devenu une composante essentielle du personnage.
Quoi d’autre est sorti de ces conversations ?
On a découvert que parmi les effets secondaires, ces médicaments pouvaient provoquer une importante perte de poids. On a rapidement décidé que le Joker devrait paraître très maigre, et j’ai donc perdu 15 kg…Tout le personnage s’est construit ainsi, j’avais le scénario en main, je demandais à Todd « doit-il être gros ou très maigre ? » « Pourquoi est-ce qu’il fait telle ou telle réflexion ? »
Est-elle l’histoire d’un individu isolé ou l’illustration du mal-être très présent dans nos sociétés modernes ?
D’une manière ou d’une autre, je pense que tout le monde est isolé, économiquement, socialement. On voit dans le film que quelle que soit la situation, que l’on soit le Joker, le jeune Bruce Wayne le futur Batman ou une femme anonyme dans un bus, tout le monde doit composer avec ces « pensées négatives », tout le monde se sent dépassé, écrasé, chacun porte beaucoup de tristesse et de vulnérabilité.
Comment avez-vous trouvé le terrifiant rire du Joker ?
En travaillant sur des formes de maladies psychologiques, dont certaines induisent des crises de rire incontrôlées. Mais avec Todd, nous en avons fait la signature du Joker. Sa tactique, c’est de déclencher ce rire pour mettre ses interlocuteurs dans une position inconfortable.
Êtes-vous le type d’acteur à « vivre » durant des mois avec votre personnage ?
En fait, non. Je « suis » le personnage ! Durant le tournage, l’idée, pour moi, de séparer l’identité du personnage de la mienne est inconcevable. Sur le tournage, tout ce que je faisais était en relation avec « Joker », quelle que soit l’heure. Je n’avais aucune vie sociale, je ne dînais avec personne, je rentrais chez moi chaque soir dans la peau du Joker que je conservais jusqu’au matin, et ainsi de suite. Ma seule relation sociale, c’était Todd Phillips.
Et ça fait quoi de vivre dans un tel personnage ?
Honnêtement ? J’ai vécu le meilleur moment de ma vie ! Je peux m’ennuyer rapidement, et là, je ne me suis jamais ennuyé, jamais ! Chaque jour, je me réveillais avec l’idée de trouver quelque chose de nouveau, j’essayais de me surprendre moi-même, il y avait tant à penser en étant le Joker. Et puis sur le tournage, quand tout contribue à vous aider, les caméras, le réalisateur, la musique, quel pied ! Travailler avec Todd Phillips, ce réalisateur si sensible, si précis, qui n’a rien de conventionnel et qui fait preuve d’un tel sens de l’humour, c’était extraordinaire.
Vous étiez très ami avec Heath Ledger, décédé en 2008, qui a incarné un Joker si marquant dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Aviez-vous discuté du rôle avec lui à l’époque ?
Non. Mais j’ai une anecdote étonnante, pendant qu’il travaillait sur son film, moi je tournais également et parfois on se plaignait tous les deux de nos difficultés. Un soir, il me dit « Tu sais quoi ? On devrait échanger, tu jouerais mon personnage et moi le tien ! » Heath a fait un travail exceptionnel avec le Joker, et j’ai essayé de l’oublier durant toute ma préparation et le tournage. Je n’ai revu le film que récemment, et j’ai réalisé que j’en avais tout oublié, du coup je suis certain qu’il n’a pas influencé mon interprétation.






N’EST PAS FOU QUI VEUT par Matthieu Santelli
Parmi tous les maux qui accablent Arthur Fleck, le plus tragique que lui réserve sa triste existence est un manque total d’humour. Ce fardeau est d’autant plus lourd à porter qu’Arthur souffre de lésions cérébrales qui affectent son système nerveux et provoquent chez lui des crises de fous rires incontrôlés dans les moments les plus inopportuns. Mais l’ironie ne s’arrête pas là puisqu’il rêve de devenir une vedette de stand-up alors que la notion même de trait d’esprit lui échappe complètement. À la place, il deviendra le Joker, l’un des vilains les plus iconiques de la pop culture…Ce qui frappe tout d’abord, c’est à quel point ce Joker-ci est à l’opposé de celui qu’interprétait Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan, qui était caractérisé par sa compréhension pleine et ironique du monde. L’humour du Joker-Ledger consistait à prendre l’ordre social pour ce qu’il est…Une vaste blague, et le mettre au défi, le provoquer pour qu’il révèle son vrai visage. Il rejoignait en cela la définition d’Einstein qui qualifiait l’humour de « mode des certitudes risquées ». Or, si Arthur Fleck se révèle quant à lui dénué d’humour, c’est précisément parce qu’il ne pige pas grand-chose au monde qui l’entoure et qu’il le subit plus que n’importe qui. Lorsqu’il assiste au show d’un humoriste de cabaret, son rire est en décalage avec celui du public. Le rire, qu’il soit volontaire ou dû à ses crises, lui échappera toujours. Il y voit pourtant un moyen de se raccorder au monde, pensant qu’en faisant rire les autres il pourra s’accomplir et appartenir à une société qui le rejette en permanence. Ce postulat est loin d’être inintéressant, mais il ne dépassera hélas jamais le stade de la velléité.
C’est un film curieux, dont le principal souci est de confondre son départ avec sa conclusion. Il n’avance que par à-coups et, pour chaque piste qu’il ouvre, s’en dégage pour en suivre une autre, multipliant les directions au point de faire du sur-place tel un chien courant après sa propre queue. Il faut voir la montagne de casseroles que traîne le pauvre Arthur, tout à la fois miséreux, handicapé, loser, malade mental, puceau, bâtard, souffre-douleur et sociopathe sans que jamais vraiment l’une ne fasse résonner l’autre. La limite du cinéma de Todd Phillips, c’est qu’il estime qu’une vie ne se réduit qu’à la somme de tous ses événements, ce qui est grotesque. Le film ne s’articule alors qu’autour de péripéties qui doivent mener inexorablement Fleck vers ce que les scénaristes l’ont programmé à devenir, quitte à charger la mule en se perdant dans des circonvolutions socio-psychologisantes comme le discours politique boursouflé et douteux du film, à base de lutte des classes revancharde. Arthur est tellement voué à incarner ce personnage-mythe sans alternative possible que cela en devient désespérément non-surprenant.





Devant le film de Phillips, on réalise à quel point il est important qu’un film, pour exister un peu, se remette en question, se contredise et laisse aux destinées qu’il trace leur part de mystère et d’absurdité. Joker s’engouffre dans le mode des certitudes sans risque, celles qui théorisent l’immuabilité des parcours contrariés et affirment péremptoirement que la misère conduit logiquement à la violence, la violence à la folie, la folie au meurtre et le meurtre à l’anarchie. Tout le travail de la narration consiste alors à relier artificiellement les pointillés du récit à coup de poudre de perlimpinpin pour donner un semblant de cohérence à ce qui se voudrait être un enchaînement de conjoncture vertigineux, mais qui n’est en réalité qu’une liste d’événements sordides déconnectés les uns des autres. Rien alors n’octroiera à Arthur une glauquerie moins nunuche que celle à laquelle le condamne le misérabilisme de sa condition, jamais il ne gagnera un peu de grandeur dans sa déchéance, bien au contraire. Ce Joker « dé-sublimé » est condamné à une double peine avec la folie et la représentation qu’il donne de cette dernière. Or, la folie n’est pas un très bon sujet de cinéma puisqu’elle ne se donne pas en spectacle et s’est affranchie de tous codes, dont ceux de la représentation. Elle n’aboutit souvent qu’à des lieux communs car la mettre en scène implique fatalement de l’édulcorer, de la romancer et de l’idéaliser. C’est pourquoi les pas de danse qu’exécute Arthur après chacun de ses meurtres pour exprimer son émancipation sociale et morale sonnent plutôt faux, ils sont l’artifice qui vient sur-signifier la démence en la rendant ciné génique, les inscrivant dans le code esthétique qu’ils sont censés ignorer.
Paradoxalement, ces procédés artificiels sont aussi ce qui rend Joker moins désagréable que ce qu’il aurait pu être, le découpage tenu de Phillips et la performance convaincante de Phoenix parviennent à lui donner un peu de corps et de caractère. Certaines scènes charrient même leur lot de troubles, et la tension est parfois palpable. Ce qui au fond trahit le film, c’est son manque de hauteur de vue qui se révèle lors de la confrontation entre Phoenix et De Niro parfait en animateur de talk-show cynique. On comprend soudainement que pour Arthur, exister signifie exister à l’écran et dans le regard des autres, accaparer l’attention et tirer la couverture à soi tout en accomplissant, tardivement, son Œdipe. Bref, s’inscrire lui aussi dans le code. Quand le monstre se révèle enfin, on découvre que ces aspirations sont enfantines et somme toute ordinaires.
La naissance du Mal accouche d’un désir bien normatif. Comme le rappelait Jacques Lacan…
Ne devient pas fou qui veut…

40 ans de carrière et 50 films
Filmographie Très sélective
2000 – Gladiator de Ridley Scott
2000 – The Yards de James Gray
2005 – Walk the Line de James Mangold
2007 – La nuit nous appartient de James Gray
2013 – Her de Spike Jonze
2015 – L’Homme irrationnel de Woody Allen
2018 – Sisters Brothers de Jacques Audiard
2017 – A Beautiful Day de Lynne Ramsay
Cannes 2017 : Prix d’interprétation masculine
2019 – Joker de Todd Phillips Oscar 2019 Meilleur acteur
2021 – Nos âmes d’enfants de Mike Mills
2023 – Beau is Afraid de Ari Aster
2023 – Napoléon de Ridley Scott
2024 – Joker : Folie à deux de Todd Phillips
2024 – Polaris de Lynn Ramsay