C’est son deuxième film…2021, il en a réalisé dix…1994, à Cannes il va frapper un grand coup en remportant la palme d’or avec PULP FICTION…Retour sur images en reprenant toute sa filmographie par ordre de ma préférence en commençant par le meilleur sa plus forte signature cinématographique et véritable résurrection pour un acteur que personne ne voulait…John Travolta. Mais commençons par le commencement…
Après Reservoir Dogs, le premier film du jeune Quentin Tarantino, diffusé en séance de minuit. Un polar inclassable, hybride, mélange de série B ultra violente et d’humour godardien devient culte en quelques heures. Quatrième Palme d’or pour le cinéma américain en six ans après Sexe, mensonge et vidéo, de Soderbergh en 1989, Sailor et Lula, de Lynch en 1990, et Barton Fink, des frères Coen en 1991, Pulp Fiction fit un tabac au box-office, devenant le premier film indépendant avec 215 millions de dollars de recettes. Pour un film qui a coûté 8,5 millions, on peut parler de l’affaire du siècle.


Comment Quentin Tarantino, a-t-il changé la face du cinéma moderne ?
Avec un film tel un shoot d’adrénaline dans le cœur de Hollywood.
Quentin débarque à Cannes dès le deuxième jour du festival. Il va voir deux à trois films par jour et assure que la Palme sera pour Rouge de Kieslowski. Pourtant, une fois Pulp Fiction projeté, on sent quelque chose dans l’air, symbolisé par l’affluence record lors de la conférence de presse. Après la projection, Quentin avait expliqué que pour ne pas gâcher son festival, il n’assisterait pas à la cérémonie de clôture sans la certitude que Pulp Fiction reçoive un prix. Gilles Jacob le délégué général du festival dit qu’il compte sur la présence de tous les acteurs. On en conclut donc qu’ils ont imaginé un prix d’interprétation global. On en est si convaincus que même voir Frances Fisher, la compagne d’Eastwood [le président du jury] sauter au cou de Quentin et lui dire qu’elle a adoré son film n’alerte personne…La cérémonie commence. Rien pour les comédiens. Rien pour la mise en scène. Pas de Grand Prix. Il ne reste plus que Rouge et Pulp Fiction. Pour Tarantino, c’est plié. Puis, Eastwood se lève pour annoncer la Palme. Il se tourne dans sa direction…qui est aussi celle de Kieslowski, placé derrière et annonce Pulp Fiction, toute l’équipe saute comme des enfants. C’est une surprise absolue ! La soirée fut joyeuse et jusqu’au bout de la nuit. Dans la salle ce soir là…Bronca, applaudissements déchaînés contre vociférations féroces. L’ogre Weinstein, le producteur du film, a bondi de son siège avec la facilité d’un poids plume tandis qu’un Tarantino hilare tape dans les mains de ses acteurs, John Travolta, Uma Thurman, Maria de Medeiros, Samuel L. Jackson, Bruce Willis. Pur produit de la culture yankee, le jeune outsider a vaincu le vieux lion russe. Dans la salle, une fan de Nikita Mikhalkov dont le Soleil trompeur, Grand Prix du jury ex aequo avec Vivre de Zhang Yimou, semblait bien placé pour la récompense suprême ne le supporte pas…Quelle daube ! Non mais quelle daube ! hurle-t-elle tandis que Quentin et sa bande, crâneurs et euphoriques, envahissent la scène. Palme en main, le cinéaste finit par se fendre d’un doigt d’honneur décontracté en direction de la groupie de Mikhalkov. Avant de prendre la parole…Je ne m’attends jamais à recevoir de récompenses dans les festivals car je ne fais pas de cinéma pour rassembler les gens. Mes films à moi divisent…
Entre la Russie impériale aux parfums nostalgiques et l’art du feuilleton populaire à la violence speedée, Clint avait parié sur l’avenir et pesé de tout son poids en faveur du feuilleton, résumera plus tard Gilles Jacob. Présenté l’avant-dernier jour de la compétition, Pulp Fiction, le deuxième film d’un réalisateur tout juste trentenaire, aura donc tout emporté sur son passage… Soleil de Mikhalkov mais aussi Rouge de Krzysztof Kieslowski, Patrice Chéreau et sa Reine Margot ou Nanni Moretti et son Journal intime. Cette année-là, pourtant, une autre reine, la vice-présidente Catherine Deneuve, avait plaidé la cause de Nanni, son favori. En vain. Le président, discret mais intraitable, n’a rien voulu entendre….Catherine Deneuve treize ans plus tard…On ne se voyait pas assez, et nous avons sans doute délibéré trop vite. Que voulez-vous répondre à des Anglo-Saxons que Journal intime ennuie profondément ? Que le palmarès se soit ou non établi dans la douleur, une chose est sûre il a fait polémique. Certains saluent une « palme qui tue » quand Le Monde, déplore que…Ce film à la désinvolture quelque peu arrogante, faite d’une accumulation de bons mots, de vedettes et de scènes chocs passe pour le fin du fin de la mise en scène.
Filmographie par ordre de préférence…
« Pulp Fiction » Number One !
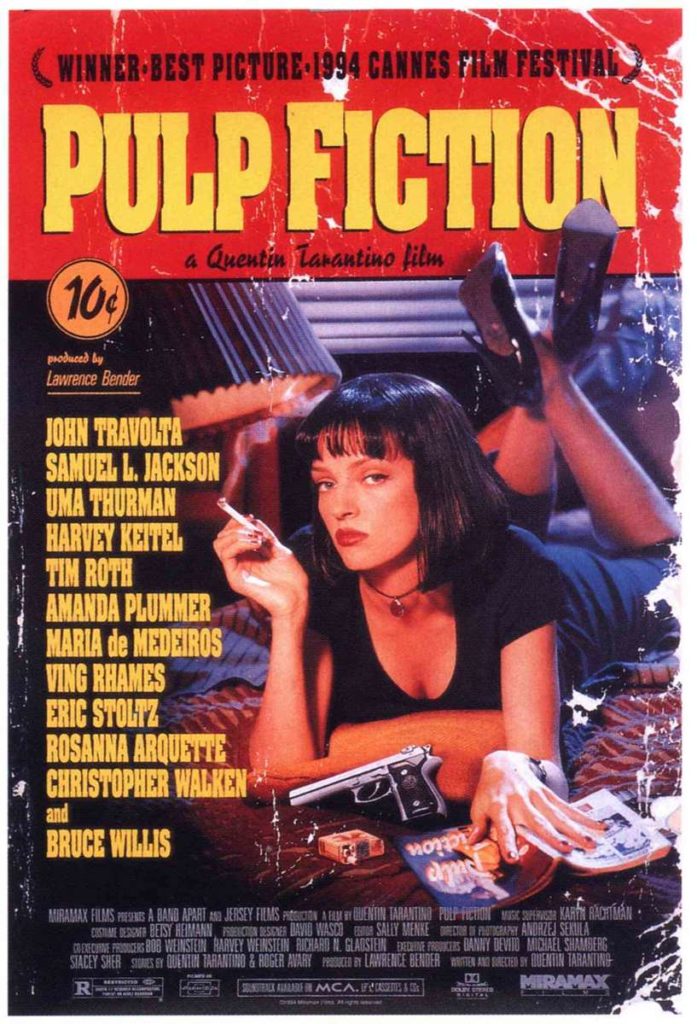

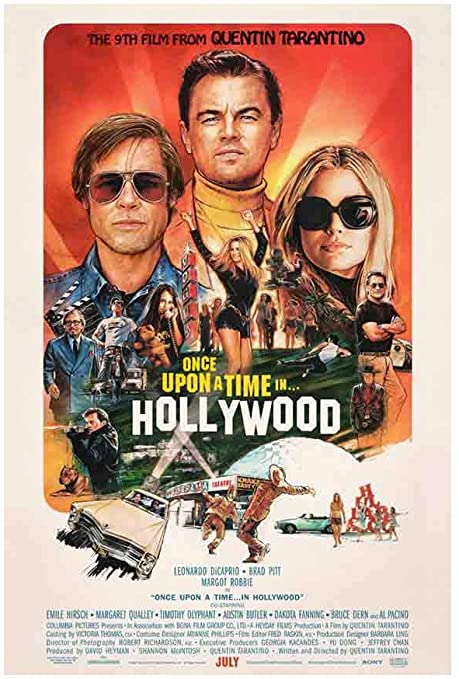
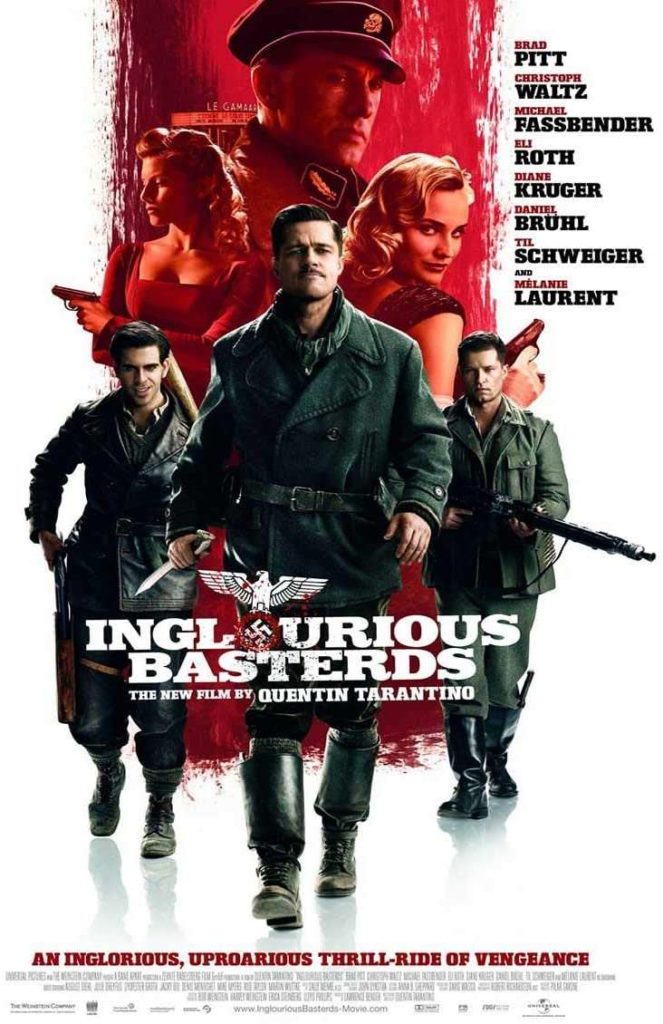







01/ Festival de Cannes…
En 1994, le festival de Cannes offrait sa plus haute distinction à un film devenu instantanément culte qui raconte l’Odyssée sanglante et absurde de deux malfrats dans la cité des anges. Aux manettes, le jeune Quentin Tarantino, un ex-employé de vidéo club propulsé sur le devant de la scène deux ans plus tôt grâce à Reservoir Dogs, une sorte de huis clos narrant l’échec d’un braquage par une bande de gangsters. De manière inespérée, l’incroyable Pulp Fiction rafle la Palme d’or à Cannes. Le cinéaste a écrit les premiers jets de son Pulp Fiction bien avant d’avoir rédigé les scripts de Reservoir Dogs. Le projet s’orientait au départ vers trois courts métrages étroitement liés, sous le nom de The Black Mask. Un hommage à la revue policière du même nom, le magazine de « pulp » le plus connu. C’est après avoir réalisé Reservoir Dogs que Tarantino reprend le projet. Il finit par en faire un long métrage en trois parties. Après cinq mois d’écriture dans la capitale des Pays-Bas, l’histoire est présentée à plusieurs sociétés de production qui le refusent toutes. Finalement, Miramax, co-présidée par un certain Harvey Weinstein et son frère Bob, immédiatement séduit par le script, rachète les droits. Les choses sont prises en main, le film est doté d’un budget de 8 millions de dollars. Huit millions qui seront rentabilisés lors du premier week-end d’exploitation en salles.




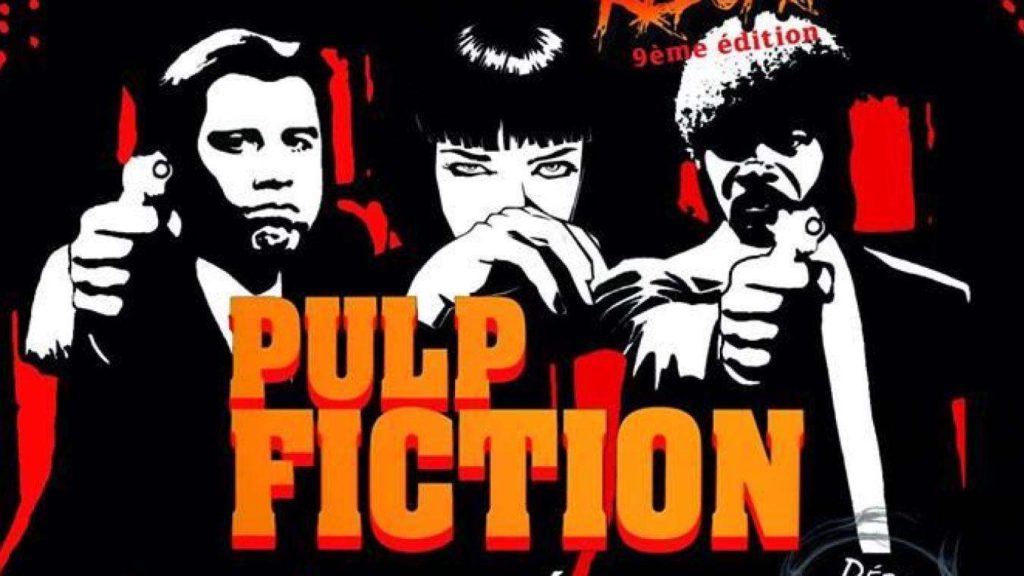
Une fois le budget établi, il est temps pour Tarantino de sérieusement se pencher sur le casting. Et les choses se corsent. Car Harvey Weinstein ne voulait pas donner le rôle de Vincent Vega à John Travolta…John Travolta, à l’époque, c’était plus mort que mort. Il était un moins que rien…Si Tarantino n’avait pas eu le dernier mot, on aurait pu passer à côté de l’incroyable performance de l’acteur de Grease. Tarantino refuse également de se plier aux diktats des producteurs concernant l’actrice qui interprétera la sulfureuse Mia Wallace. Si Miramax Films souhaite engager Holly Hunter ou Meg Ryan, le cinéaste insiste pour avoir Uma Thurman. Dans sa tête de réal…Qu’elle porte une perruque brune coupée au carré en hommage à Anna Karina, une des comédiennes fétiches de Jean-Luc Godard. Mais du côté de l’actrice, accepter un tel rôle n’était pas une évidence. Uma Thurman a 23 ans, est originaire d’une petite ville du Massachussets et s’est faite connaître dans Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears. Tarantino doit user de toutes ses armes pour la convaincre, d’après Uma Thurman…Il n’était pas ce demi-Dieu vénéré qu’il est aujourd’hui. Je n’étais pas certaine de vouloir le faire parce que je m’inquiétais à propos de Gimp [le personnage-objet-sexuel habillé de cuir sortant d’une cage, ndlr]. Nous avons eu de longues discussions mémorables où nous avons comparé le viol d’un homme à celui d’une femme. Personne ne croirait que j’ai hésité une seule seconde. Je ne peux même pas le croire moi-même, en fait. Le personnage de Jules Winnfield a quant à lui été écrit par Tarantino spécifiquement pour Samuel L. Jackson. Cependant, l’acteur manque de se faire voler son personnage après une première audition décevante. Mais cette fois, c’est Harvey Weinstein qui y croit et le convoque pour une audition de la dernière chance…Sam est venu avec un hamburger dans une main et une boisson dans l’autre et il puait la junk food. Il est entré en buvant et en mangeant son hamburger tout en nous regardant. J’ai eu peur. J’ai cru qu’il allait nous tirer une balle dans la tête. Ses yeux sortaient de sa tête. Enfin, Bruce Willis, véritable vedette de l’époque, manifeste son intérêt pour Pulp Fiction après avoir été approché par Harvey Keitel. Comme les autres comédiens, il décide de baisser son cachet pour participer au film. Et puisque le rôle de Vincent Vega est déjà attribué, il hérite de celui de Butch, le boxer. Tarantino se remémore…Quand j’ai eu Bruce Willis, Harvey a eu sa vedette et nous étions partis.
Le tournage du film commence en septembre 1993 à Los Angeles. Et Tarantino voit grand. Malgré un budget limité à 8 millions de dollars, il souhaite que son long métrage ait l’air d’une super production…Je voulais qu’il ressemble à une épopée dans tous les domaines avec inventivité, ambition, dans la durée, le cadrage. Tout excepté le coût. Le film est bouclé en dix semaines, sur une pellicule 50 Asa, afin qu’il n’y ait pas de grain, pour une image la plus proche possible du procédé Technicolor des années 50. Et selon l’actrice Maria de Medeiros, qui joue Fabienne, la compagne de Bruce Willis dans le film, sur le tournage règne une ambiance « très décontractée »…Il y avait une ambiance de film d’amis et de film d’auteur. Tous les gens qui étaient là, et qui sont de grandes vedettes, étaient très conscients de faire un film, d’abord avec un budget dérisoire par rapport à ce à quoi ils étaient habitués, et ensuite de faire un film avec un grand artiste. Il y avait cette ambiance-là, de film indépendant. Ça les amusait. Tout le monde était très décontracté.




Pulp Fiction est bourré de références et s’inspire de plusieurs genres cinématographiques. Tarantino arrive à conjuguer comme personne ses influences de série B et celles de la Nouvelle Vague. Hormis la coupe à la Karina de Thurman, la séquence culte de danse s’inspire d’une scène de Bande à Part de Godard, que le réalisateur a montrée aux acteurs pendant le tournage. Uma Thurman raconte que parmi toutes les scènes stressantes du film, c’est pourtant celle où elle twiste avec John Travolta qui l’a le plus intimidée. Elle explique qu’elle se sentait « maladroite, embarrassée et timide ». On retrouve également une autre référence à la Nouvelle Vague dans l’association des prénoms portés par les personnages Jules et Jimmy, en hommage au film Jules et Jim de Truffaut. Tarantino, qui a longtemps rêvé de devenir acteur, décide pendant le tournage de se glisser lui même dans la peau du très nerveux Jimmy. Résultat, une séquence d’anthologie. La scène la plus difficile à tourner selon le réalisateur a été celle de l’injection de l’adrénaline. Elle a nécessité de nombreuses prises et a en réalité été filmée à l’envers, John Travolta retirant la seringue de la poitrine d’Uma Thurman, avant d’être inversée au montage. Comme pour tous ses films, Tarantino a apporté un grand soin à sa bande-originale. un mélange de rock américain, de surf music, de pop et de soul. Outre l’utilisation du titre « You Can Never Tell » de Chuck Berry dans la scène de twist, on retient notamment l’interprétation de « Misirlou » par Dick Dale, que l’on peut entendre lors du générique de début. Pour Tarantino, musique et images ont toujours été liées pendant l’élaboration d’un projet, comme il l’explique dans une interview accordée au New York Times…
J’ai une énorme collection de disques que je range dans une pièce spéciale à côté de ma chambre. Cela ressemble à la boutique d’un disquaire d’occasions, avec des posters et des bacs répartis par genres. Quand je suis prêt à écrire un nouveau film, ou que je pense à une histoire et que je pars de zéro, je vais dans cette pièce et essaye de trouver de la musique pour le film et d’autres BO, des chansons, peu importe. Lorsque je trouve quelques morceaux, je me rapproche un peu plus de la concrétisation du film. Qui sait si ces deux ou trois chansons finiront dans le film? Mais cela me permet d’avancer. Pulp Fiction fait partie des trop rares œuvres qui réconcilient le public et la critique. Cette aventure délirante et grandiose parsemée de répliques inoubliables et de séquences cultes est construite à travers des récits déstructurés. La narration éclatée sous la forme de films à sketchs nous plonge dans un microcosme qui mêle avec brio ultra-violence, humour noir, ironie et situations décalées. L’une des plus grandes forces du film réside dans la galerie de personnages, dans laquelle les gangsters et les truands sont aussi typés que dans les Pulp magazines dont Tarantino s’est directement inspiré pour l’affiche et le titre de son chef-d’œuvre. En mettant en scène ses chers « bad boys » au cœur de situations du quotidien, le cinéaste les humanise…Quoi de plus jouissif que d’entendre des malfrats sanguinaires discuter passionnément de…Big Mac ? Dans Pulp Fiction, il parvient à nous faire rire avec des sujets noirs et glauques comme des meurtres, overdose, viols…Et montre l’étendu de sa virtuosité artistique. L’apanage d’un grand réalisateur.



Il aime le cinéma, passionnément.
Pulp Fiction a, avec le temps, rejoint le rang des films « cultes ». Sa musique, son affiche, ses répliques et ses personnages sont devenus des éléments à part entière de la culture « pop » cinéma, ce qui fait de toute éventuelle découverte tardive du second long-métrage de Tarantino la confrontation avec ce que l’on qualifierait comme un étant un immanquable, une étape obligatoire dans la vie de tout amateur de cinéma comme il se doit. Presque comme le véritable point de départ de la carrière de Tarantino, après un Reservoir Dogs déjà convaincant mais souvent dans l’ombre de son successeur, c’est aussi l’un des éléments les plus difficiles à appréhender et à cerner dans la filmographie du cinéaste. Car c’est, ici, toute l’essence de son cinéma qui s’exprime, de la manière la plus brute et la plus étonnante qui soit. Depuis bien longtemps déjà, il regarde de nombreux films et s’en imprègne pour, à son tour, parvenir à en réaliser. Les hommages ont toujours fait partie de ses films, à différentes échelles, et de différentes manières. Ceux-ci ne manqueront pas dans Pulp Fiction, qui offre une version très originale du film de gangsters, complètement revisité par le cinéaste. Dans Reservoir Dogs, nous évoluions dans un espace clos, qui permettait la mise en place d’un vrai exercice de style, mais, ici, il n’y a plus aucune limite. Quentin Tarantino utilise tout un arsenal cinématographique varié et affûté pour proposer ce qui constitue la véritable base de son cinéma. Dialogues, musiques, maîtrise du temps, tout est bon pour construire un objet cinématographique singulier où Tarantino fait ce qu’il fait le mieux…
S’amuser !




Le cinéma, ce n’est pas juste filmer des plans et les faire s’enchaîner grâce au montage, pour raconter une histoire allant d’un point A vers un point B. Le cinéma permet de faire ce que l’on veut avec les images, les mots et, surtout, le temps, cette chose si impalpable, inflexible et incontrôlable. Ici, le temps est complètement distordu, les scènes s’enchaînent, mais jamais dans l’ordre dans lequel elles devraient s’enchaîner, selon toute logique. Cela n’empêche pourtant pas une lecture assez limpide du film, qui se lit comme un ensemble qui, malgré son côté désordonné en apparence, est tout à fait cohérent et lisible. Bien sûr, à cela, Tarantino ajoute d’autres éléments essentiels à son cinéma, les dialogues en premier. Si les films de Tarantino sont si bavards, ce n’est pas juste pour le plaisir de la réplique qui fait mouche, et on sait très bien que Pulp Fiction en est rempli, entre la discussion sur le « Royal Cheese », les citations de la Bible par Ezekiel, ou encore la fameuse histoire de la montre qui traverse les générations, et pas que. C’est surtout le moyen privilégié par Tarantino pour caractériser ses personnages et les faire vivre à l’écran. Pulp Fiction est un film qui s’apprécie autant comme un divertissement amusant et baroque, que comme une œuvre cinématographique dense et propice à de longues heures de dissertation et d’analyse. C’est, peut-être, ce qui fait aujourd’hui son universalité, et qu’il est si unanimement reconnu comme étant un grand film. Il faut, parfois, laisser le temps faire son œuvre pour l’apprécier dignement, ou se réconcilier avec, si la première rencontre n’a pas été aussi concluante qu’espérée. Toujours est-il que Pulp Fiction se présente comme étant le film matriciel de l’œuvre de Quentin Tarantino, celui qui offre une première apothéose tout en étant une base pour la suite, une œuvre de cinéphile pour encore plus apprécier la magie du cinéma.

02/ Un film indépendant américain…vole presque la vedette à la Palme d’or Les meilleures intentions de Bille August. Durant cette quinzaine, les critiques ne jurent en effet que par un polar au titre incompréhensible, présenté en séance spéciale. La rumeur fait le tour des festivaliers…Le film est violent, original dans sa structure narrative, parfaitement maîtrisé, et superbement servi par une brochette de gueules de cinéma. Reservoir Dogs conquiert ses premiers spectateurs français. Tarantino n’est plus un illustre inconnu se baladant de festival en festival avec ses bobines sous le bras…Le chemin fut long avant de parvenir à cette reconnaissance. Gérant d’un vidéoclub à Los Angeles, Tarantino visionne tout ce qui lui tombe sous les yeux. Sa grande cinéphilie lui permet d’imaginer un cinéma truffé de références…Dans Reservoir Dogs, le système d’appellation des truands par des couleurs est emprunté au Pirates du métro (1974) de Joseph Sargent. Toujours est-il que Tarantino se lance à cette époque dans l’écriture de scénario. Il en sortira de sa plume True Romance, Reservoir Dogs et Tueurs nés. Harvey Keitel, impressionné par la qualité du script, acceptera de miser sur lui et de produire son premier film. Six gangsters sont réunis par un commanditaire pour braquer une bijouterie. Ils ne se connaissent pas et portent des pseudonymes pour préserver leur anonymat. Mais le casse, transformé en guet-apens par la police, tourne au carnage. Les survivants, regroupés dans un hangar, tentent d’identifier parmi eux le flic infiltré… Quentin Tarantino avait déclaré vouloir uniquement faire des films qui résisteraient à l’épreuve du temps et c’est à ce critère que l’on reconnaît un chef-d’œuvre. Reservoir Dogs entre dans cette catégorie. Véritable coup de poing cinématographique, ce polar a conservé tout son impact. La recette semble simple…Musique inédite mais accrocheuse dès la première écoute, dialogues percutants…Tu as tué des gens ? Non que des flics ! et narration innovante.


Tarantino ne se soucie pas de renouveler son sujet, il préfère en révolutionner le traitement grâce à un scénario complètement déstructuré. Ce faux huis clos truffé de flash-back prend ainsi constamment le spectateur par surprise. En fonction de l’action, le spectateur est soit en avance par rapport aux personnages…Il connaît l’identité de la taupe, soit en retard donc pris à contre-pied. Tarantino livre un cinéma viscéral dans lequel il tranche à vif. Malin, il préfère filmer la violence à grand renfort de pointes d’humour afin de désamorcer une tension trop éprouvante. On peut d’ailleurs lui reprocher cet amalgame pervers qui ne tend qu’à banaliser cette violence graphique. Il aime leurs personnages et les acteurs qui les incarnent. Il les choie dans un cinémascope qui leur rend toute leur noblesse de salopards. Ici, presque tous ont un rôle à défendre, tous ont une scène et des dialogues ciselés qui leur permettent d’exprimer leur talent. Dès lors, en dépit de leurs actes répréhensibles, on en vient à apprécier ces truands, ces « tough guys » comme les qualifierait Norman Mailer. Concernant justement la distribution, la palme revient à la prestation de Tim Roth, hallucinant de souffrance dans sa lente agonie. Reservoir Dogs est la parfaite illustration du film culte. Voilà un film qui peut être visionné avec le même plaisir un nombre incalculable de fois. Brillant, prenant, hilarant par moments, il est un miraculeux condensé d’énergie issue du cinéma indépendant américain et de la maîtrise de fabrication du système hollywoodien.
La première séquence d’un film est la plus importante, parce qu’elle donne les intentions du réalisateur, le ton de l’œuvre et pose les bases de l’intrigue. Celle de Reservoir dogs égrène bien ces informations, mais subtilement et au compte-goutte. On apprend que les personnages ont un emploi commun, répondent à des pseudonymes et que l’un d’entre eux est leur chef. C’est un film de gangsters s’écrivant au masculin pluriel, le film débute dans un café, avec des sujets de conversation ordinaires mais inattendus, tels que la réelle signification de Like a Virgin de Madonna. La discussion et les plans s’étirent dans le temps, anormalement pour un film de braquage. En faisant disserter ses personnages sur la culture de masse, Quentin Tarantino casse l’image du gangster sombre et imposant pour le définir comme un être ordinaire, semblable au spectateur, avec lequel il partage forcément certaines connaissances musicales et/ou cinématographiques. Deuxième audace consécutive du film, le casse n’est pas montré, mais on sait qu’il a mal tourné et on retrouve les gangsters se rendant un par un au point de rendez-vous, un entrepôt désert. C’est à huis clos que va donc se jouer l’histoire, débutant là où un film fidèle au genre se terminerait. L’unité de lieu, le nombre réduit de personnages et l’impression de temps réel produite par la captation de l’action selon des plans séquences et/ou des plans d’ensemble renvoient au théâtre. Le changement de scène va jusqu’à se déterminer par l’irruption dans le champ/sur scène d’un nouveau personnage, mais Tarantino n’oublie jamais d’intégrer les particularités du cinéma…Variations de l’échelle des plans, changement d’axe ou flash-backs rappelant que le cinéma est un art du temps…Dès son premier film, sa mise en scène est d’une grande rigueur avec plongées et contre-plongées en champ contre-champ qui déterminent les rapports de force.



Tarantino conserve du théâtre essentiellement la place prépondérante accordée à l’acteur, dont le travail est continuellement mis en abyme dans le film, la question de l’identité étant au cœur de la relation entre ces gangsters ne connaissant chacun l’un de l’autre que le personnage qu’il incarne, identifié par une couleur. Le paradoxe du comédien devient la principale réflexion de Reservoir dogs lors du chapitre consacré à l’infiltré Mr. Orange, qui décrit la préparation de son rôle de taupe. Lors de ces répétitions, c’est le détail qui importe pour être convaincant et que l’illusion soit crédible. Dans le cinéma de Quentin Tarantino, la fausse note ou même l’approximation est fatale…Ce qui est vrai aujourd’hui dans Inglourious Basterds, où, dans une taverne, un Anglais se faisant passer pour un Allemand est démasqué suite à une erreur de geste, l’était déjà en 1991 avec Reservoir Dogs. C’est un détail qui perdra Mr. Orange, illusionné par l’interprétation de son collègue Mr. Blonde. Car si Blonde, avant son entrée en scène, est présenté comme un fou furieux et un psychopathe, et qu’il n’hésite pas à torturer un otage dans une célèbre scène de violence ironique, le second chapitre s’est focalisé sur son caractère incontrôlable mais fidèle et donne seulement au spectateur une information qui perdra Mr. Orange lors de son mensonge avant le règlement de compte final. Reservoir Dogs apporte ainsi la justification de sa structure, et pose les bases du cinéma de Quentin Tarantino, en affirmant son admiration pour la culture populaire, les personnages barrés et surtout l’importance qu’il accorde à la maîtrise de son œuvre dans les moindres détails.
Dans la première scène culte de la filmographie de Quentin Tarantino. Celle qui, à défaut de faire fuir une flopée de spectateurs lors de sa projection à Cannes et à Sundance en 1992, a installé le style si emblématique du réalisateur. Une scène empreinte de sadisme, totalement gratuite et pourtant si jubilatoire. On y retrouve l’iconique Mr. Blonde interprété par Michael Madsen. Pendant que Mr. Orange se vide de son sang, hors champ, Mr. Blonde s’amuse à torturer le pauvre Marvin Nash, un flic qu’il a embarqué dans le coffre de sa Cadillac après un holdup qui a mal tourné. Juste avant de lui trancher l’oreille à l’aide d’une lame de rasoir, l’acteur se déhanche, plus décontracté que jamais, sur « Stuck in the middle with you » des Stealers Wheel. Une chorégraphie depuis devenue culte. Si l’acteur semble tout à fait l’aise devant la caméra, il n’en était rien. Michael Madsen a révélé qu’il n’avait aucune idée de comment danser la scène avant que Tarantino ne dise « action »….Dans le scénario, on pouvait lire ‘Mr. Blonde danse frénétiquement’ . Et je me disais ‘Putain, mais qu’est ce que ça veut dire, ça ? Quentin a mis la chanson sur le plateau pour la première fois et je ne savais pas du tout quoi faire. Alors j’ai pensé ‘Et puis merde, il faut bien que je fasse quelque chose !’ Je me suis alors rappelé de ce truc que faisait Jimmy Cagney dans un film. Il faisait une petite danse folle qui a surgit dans ma tête au dernier moment, et c’est de là que vient ma danse dans le film. »






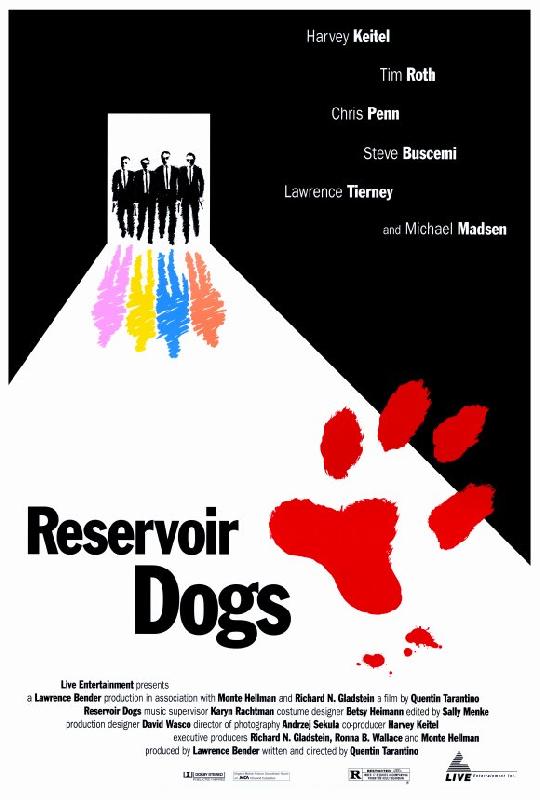

03/ HISTOIRE(S) DU CINÉMA par Josué Morel

Depuis Les Huit Salopards, quelque chose de nouveau semble à l’œuvre dans le style de Tarantino, qui gagne en profondeur et en complexité à mesure qu’il délaisse la part que l’on pouvait considérer encore comme un brin superficielle. Appelons ça, faute de mieux, une forme de maturité, qui passe par un dérèglement du système du cinéaste. Dans le cas de Once Upon a Time…in Hollywood, il faut probablement commencer par le plus évident avec les très nombreux pas de côté du montage ne sont plus véritablement gouvernés par un principe d’efficacité et détonnent par les ruptures rythmiques et la mélancolie qu’ils installent. À rebours par exemple de l’harmonie et de la fluidité que visait Kill Bill : Volume 1, l’irruption des pastiches se couple à un travail de sape sur les différentes figures qui peuplent le film.
La mise en scène déploie ici son goût habituel pour l’entrelacement de bouts de fictions hétérogènes tout en s’affranchissant de ce qui a parfois constitué la limite de ce syncrétisme, à savoir un penchant pour l’iconisation comme revers du regard amoureux posé sur les personnages. Elle paraît désormais au contraire embrasser une forme moins immédiatement séduisante car de fait le cinéma de Tarantino a longtemps cherché à séduire, mais autrement plus cohérente et précise dans ce qu’elle raconte. Depuis Les Huit Salopards, quelque chose de nouveau semble à l’œuvre dans le style de Tarantino, qui gagne en profondeur et en complexité à mesure qu’il délaisse la part que l’on pouvait considérer encore comme un brin superficielle. Appelons ça, faute de mieux, une forme de maturité, qui passe par un dérèglement du système du cinéaste. Dans le cas de Once Upon a Time…in Hollywood, il faut probablement commencer par le plus évident avec les très nombreux pas de côté du montage ne sont plus véritablement gouvernés par un principe d’efficacité et détonnent par les ruptures rythmiques et la mélancolie qu’ils installent. À rebours par exemple de l’harmonie et de la fluidité que visait Kill Bill : Volume 1, l’irruption des pastiches se couple à un travail de sape sur les différentes figures qui peuplent le film. La mise en scène de Tarantino déploie ici son goût habituel pour l’entrelacement de bouts de fictions hétérogènes tout en s’affranchissant de ce qui a parfois constitué la limite de ce syncrétisme, à savoir un penchant pour l’iconisation comme revers du regard amoureux posé sur les personnages. Elle paraît désormais au contraire embrasser une forme moins immédiatement séduisante car de fait le cinéma de Tarantino a longtemps cherché à séduire, mais autrement plus cohérente et précise dans ce qu’elle raconte.
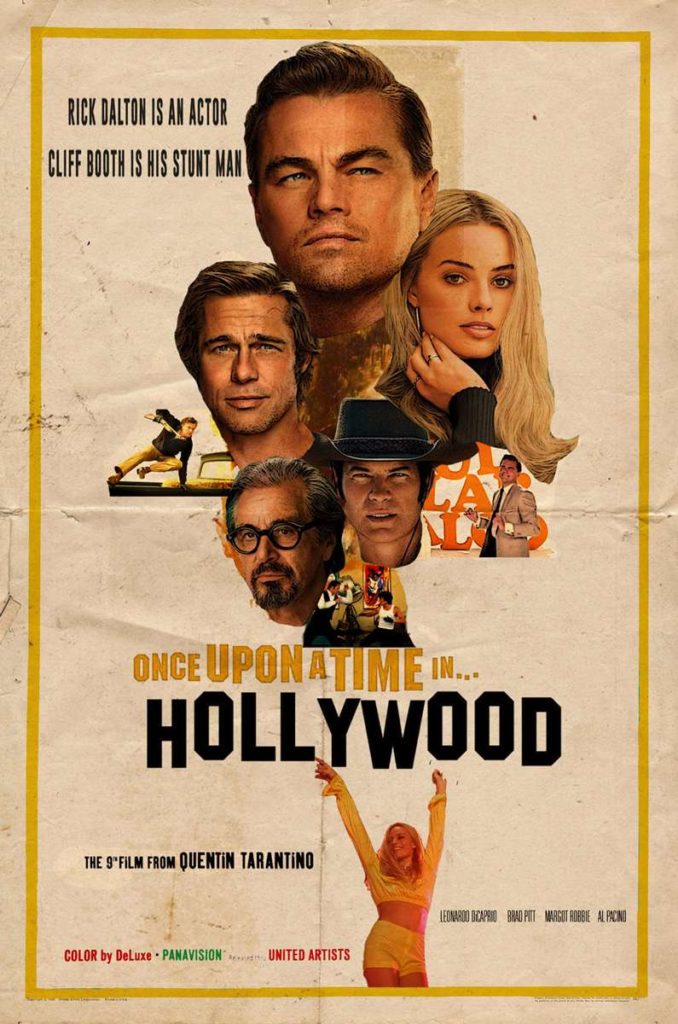
L’auréole…Evoquons une épiphanie discrète qui vient ponctuer une scène magnifique. Sharon Tate s’est glissée dans un cinéma pour assister à la projection de The Wrecking Crew où elle tient l’un des rôles principaux. Au milieu d’un public qui ignore sa présence, l’actrice s’émerveille à la fois de se voir et d’être vue, savoure les répliques qui font mouche, les rires des spectateurs et la victoire de son personnage au cours d’un combat. Son visage ravi se voit alors littéralement auréolé par la lumière du projecteur qui, par un effet de flare, dessine un halo autour d’elle. Ce miracle lumineux constitue un bon moyen d’approcher et de saisir la richesse du film, qui organise à plusieurs échelles par ses plans, ses séquences, puis le film compris comme un tout organique, un dialogue entre des pôles a priori opposés, mais qui se révèlent en fin de compte interdépendants. Plus qu’un détail gracieux, il vient parachever une rencontre, comme en témoigne la progression, assez retorse, de la séquence. Tate se contemple en train de jouer un personnage, de sorte que fiction et réel apparaissent d’emblée entrelacés et ne peuvent être retranchés l’un de l’autre. Ensuite, l’actrice occupe au sein de l’espace une fonction cristalline, tout en étant le réceptacle des réactions autour d’elle, elle se trouve au point de convergence des deux pôles lumineux de la salle, à savoir le projecteur et l’écran. Son rapport au film équivaut moins à accueillir passivement la lumière qu’à initier un dialogue avec elle, en répondant aux images qui lui sont montrées.
Lors de la scène de l’affrontement, elle mime ainsi les gestes de son personnage, tandis que s’intègre dans le montage une troisième temporalité, intermédiaire entre le réel et la fiction, celle de la répétition du combat chorégraphié en compagnie de Bruce Lee. Ces quelques plans font surgir des images autant manquantes que fantômes, celles de la fabrication du film, au fondement d’une conception du cinéma mettant au même niveau la fonction archivistique de l’image et le désir qu’elle produit. Surgit alors le petit éclat comme émanation du film contemplé, irradiant le visage de la spectatrice. C’est dès lors un véritable circuit de la propagation de la lumière que donne à voir la scène, du projecteur à l’écran, de l’écran au visage, du visage à l’écran, et, enfin, du projecteur au visage. La salle de cinéma, à l’instar du territoire plus ample qu’élit le film, Los Angeles, apparaît comme un décor où se télescopent des éléments exogènes pour former un ensemble régi par une même logique.
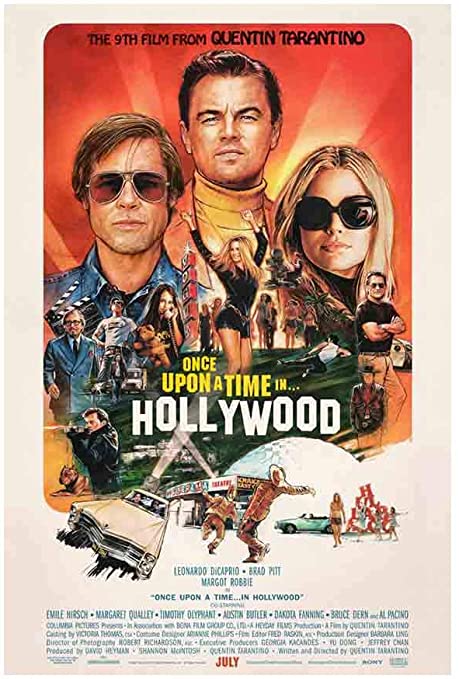
Body double…Au-delà de la dynamique de cette scène-ci, le film noue en effet un dialogue à trois voix entre les images sous plusieurs formes…Cinéma, télévision, publicité, affiches, le réel et l’agent intermédiaire qui permet à la vie d’habiter les images et aux images d’habiter la vie de l’acteur. Cette logique tripartite est au centre du feuilletage narratif articulé autour de trois personnages, un acteur de télévision, une actrice de cinéma et un cascadeur. Il n’est pas interdit de considérer ce dernier comme le cœur secret du film, et ce pour deux raisons. La première tient à ce que la figure du cascadeur se révèle au plus proche de la vision du cinéma de Tarantino, qui fait des images manquantes et fantômes évoquées précédemment le terreau d’une hybridation qui se nourrit du réel pour le sublimer. Dans une cascade tirée d’un ersatz italien de James Bond, Cliff n’est figuré que par une flèche pointant une voiture suspendue au-dessus du vide. Son corps occupe en somme les plis de l’image comme le réel peuple, sans toutefois que l’on puisse nécessairement le voir, l’envers de la fiction. La seconde raison tient à ce que, dans cette logique, le personnage se trouve à la fois à la marge et au centre des grandes étapes qui jalonnent le récit. Dans la première et la dernière séquence, qui se répondent, Cliff joue le rôle intermédiaire entre cinéma et télévision, les deux autres grands pôles de l’intrigue.
C’est ainsi qu’il faut comprendre le très beau mouvement à la toute fin, où le cascadeur s’éloigne de Rick dans une ambulance en même temps que, par un effet de balancier, Jay Sebring descend l’allée du 10050 Cielo Drive pour aller à la rencontre de Dalton. Si Cliff ne sera pas de l’embrassade finale, qui scelle les noces du grand et du petit écran, il n’en reste pas moins celui qui, tout en restant hors-champ, aura permis son accomplissement, il lui aura fallu quitter le film pour que symboliquement son ami puisse entrer dans le cinéma. Cliff s’affirme de surcroît comme le seul personnage qui travaille de ses mains et permet par son labeur à Los Angeles, ville où cohabitent pleinement le réel et ses images doublées voir l’affiche du visage de Dalton qui ouvre le film, de former un microcosme où chaque élément occupe sa place dans une perspective plus large. A la demande de Rick, Cliff se hisse sur le toit de sa demeure pour réparer l’antenne de sa télévision, en démontrant au passage sa dextérité de cascadeur. Tandis qu’il s’attèle à sa tâche, il entend la musique qui émerge de la villa de Polanski et de Tate, puis aperçoit plus loin Charles Manson, venu rendre visite à Dennis Wilson, membre des Beach Boys et ex-locataire des lieux. Ce faisant, il apparaît comme l’observateur de l’Histoire en train de s’écrire et il n’est bien sûr pas anodin qu’il soit amené à jouer plus tard un rôle prépondérant dans la réécriture de cette histoire. Reste que le plus frappant dans la séquence tient dans ses articulations, tout en cherchant à rétablir le flux des images télévisuelles, Cliff semble non seulement guider la progression de la découpe, en étant à l’origine de l’alternance des points de vue, ceux de Tate et de Manson, mais aussi réorganiser la logique interne du montage par la convocation d’un souvenir qui vient éclairer un fragment de son passé.
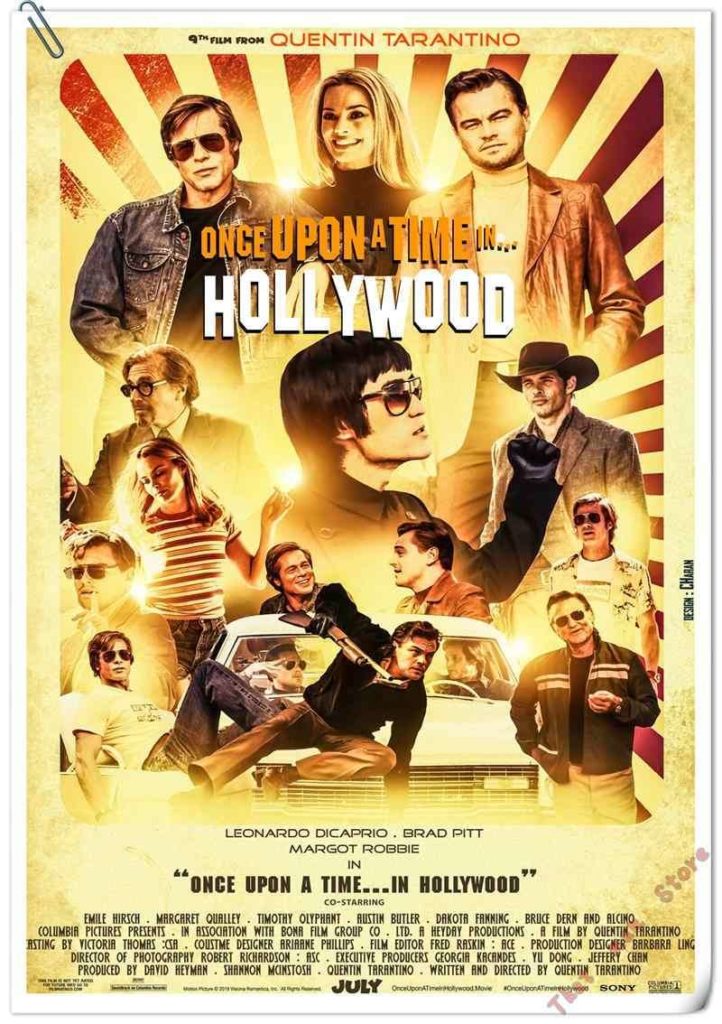
California Dreamin…À nouveau, la logique interne de la séquence éclaire l’ensemble de l’édifice, dont les bouts en apparence distincts reposent en vérité sur un impressionnant montage gigogne regroupant diverses strates temporelles, vrais et faux films, publicités ou encore spots télévisés. Si la chose n’est pas nouvelle chez Tarantino, c’est probablement la première fois que la part postmoderne de son cinéma ne se contente pas uniquement d’irriguer l’écriture, mais devient son pivot. Il faut envisager sous cet angle le choix de Los Angeles, qui d’une part offre un cadre mythologique au récit et de l’autre permet le déploiement d’un monde qui génère des images pour mieux les accueillir en son sein un monde où chacun se voit en mesure d’initier un dialogue avec elles, notamment par l’entremise de la télévision, principal vecteur de leur circulation, jusque dans la longue séquence de western au Spahn Ranch, où un poste cathodique se trouve au centre des enjeux. Outre qu’elles peuplent l’arrière-plan des décors et des situations, les images entretiennent une sorte de compagnonnage avec les personnages, ouvrant sur des scènes moins spectaculaires que triviales, dans un registre au fond proche de la chronique. Dans une scène qui suit Cliff jusqu’à sa demeure, un ample travelling révèle un drive-in à l’ombre duquel se trouve la caravane du cascadeur, où il vit avec sa chienne et regarde de mauvais soaps.
Cliff répond à sa télévision comme Rick répète à voix haute un script dans sa piscine, et c’est dans cette adresse que se résume la démarche de Tarantino, qui substitue à la grande histoire attendue d’un Hollywood flamboyant, en crise mais qui connaît déjà les premiers éclats du Nouvel Hollywood, une contre-histoire résolument plus modeste, voire ingrate, celle d’une poignée de spectateurs dont l’existence est indissociable des images qui gravitent autour d’eux.
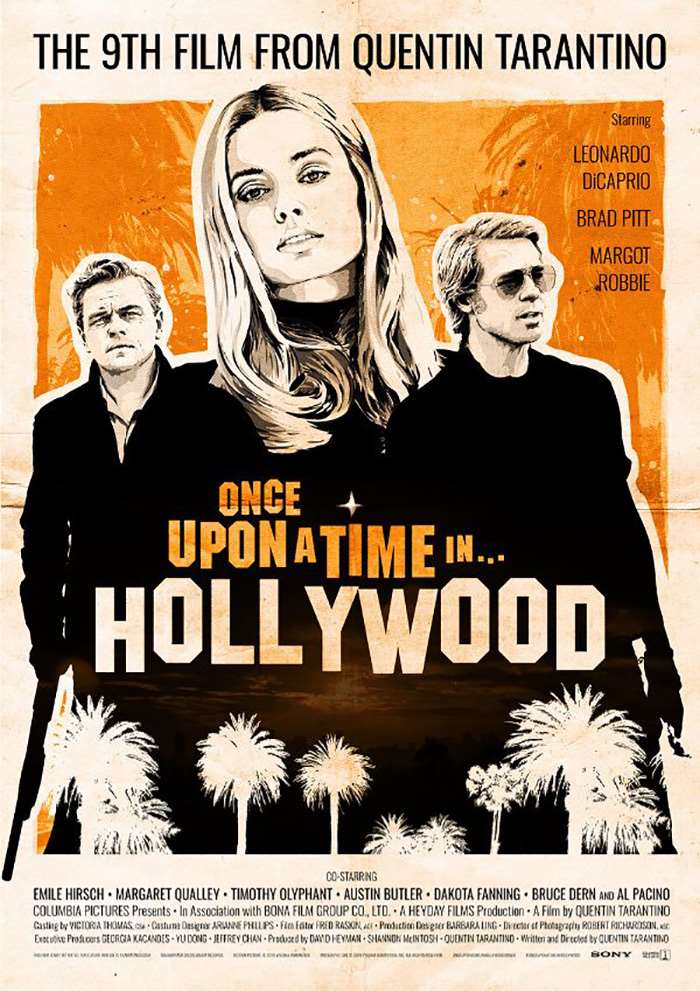
La nuit du 8 août…La présence de la Manson Family relève dans cette perspective du coup de génie. Tarantino réinvente leur destin non pour maintenir intact un supposé âge d’or rêvé, mais bien plutôt pour mettre en exergue et contourner la logique au cœur de la tuerie de Cielo Drive. Historiquement, la nuit du 8 août 1969 est celle d’une attaque contre le cinéma, sur un plan physique et symbolique, tant l’assassinat matérialise dans un sens les images de Rosemary’s Baby, tourné un an auparavant par Polanski. Ici, la Manson Family conscientise cet horizon et le radicalise, dans une logique qui accroît sa portée tout en rabattant les cartes de son issue, puisque le but de cette nuit est de rendre aux images la violence qu’elles ont transmise, autant s’attaquer à leur source la plus prolixe et populaire, c’est-à-dire la télévision. Sauf que, dans le monde de Once Upon a Time…à ce stade, le film l’a démontré pendant plus de deux heures , les images sont vivantes et interagissent avec le réel. Elles vont donc pouvoir répliquer à l’attaque qui leur est faite. Ce dernier segment est l’occasion pour Tarantino de rejouer des scènes entières de son cinéma avec une hauteur de vue qui manquait parfois à ses précédents films.
Si le dénouement, éblouissant, n’a pas théoriquement la même ampleur que ceux d’Inglourious Basterds ou de Django Unchained, il les dépasse pourtant par sa précision méticuleuse, qui fait moins de la scène une célébration naïve et sommaire des « puissances du cinéma » qu’une vaste opération de synthèse de ce qui précède. Tandis que Cliff reconnaît les membres de la « Famille », qu’il a croisés quelques mois avant au Spahn Ranch, l’ensemble de la scène s’apparente à une reprise de différentes actions opérées le long du récit, jusque dans la manière dont Dalton s’inspire d’un de ses films pour faire face aux agresseurs. De fait, les différentes séquences fonctionnent autant indépendamment qu’en symbiose les unes avec les autres, au point que l’ensemble finit par lier trois trajectoires à l’origine parallèles en une seule…1) un cheminement de la télévision au cinéma 2) un déplacement d’Hollywood à Rome, à l’heure de gloire du western spaghetti 3) quelques pas qui séparent la demeure de Dalton de celle de Tate avec, en guise de frontière entre le Hollywood noble et le Hollywood ingrat, un muret et une grille que dépassera ultimement la caméra.

Du pied aux néons…Car le syncrétisme tarantinien implique d’envisager le noble et l’impur sur un même pied d’égalité. C’est le cas, par exemple, de la scène du halo de Sharon Tate évoquée plus haut. La lumière qui cerne pendant quelques secondes le visage de l’actrice s’affirme également comme le contrepoint de l’autre extrémité de son corps, à savoir ses pieds nus, posés sur le fauteuil devant elle. Ces pieds sont, détail important, sales, à l‘instar de tous ceux que Tarantino filme ici avec attention. On le sait, le pied chez Tarantino est une source de désir, or le désir dans Once Upon a Time…va de pair avec une saleté que le cinéaste affectionne, notamment celle du cinéma bis et de la télévision. Il ne fétichise d’ailleurs plus le pied comme dans Boulevard de la mort, en s’attardant sur sa surface et les ongles vernis, mais observe désormais la plante jaunie de Tate ou le talon durci d’une jeune hippie. D’une part le pied semble désirable précisément parce qu’il est sale, de l’autre c’est son envers qui intéresse Tarantino, envers qui occupe paradoxalement le premier plan, que le pied pointe vers un écran de cinéma ou qu’il se colle à la surface d’un pare-brise. Une autre scène clef repose sur une logique analogue, celle du retour à Hollywood, la fameuse nuit de l’attaque de Cielo Drive, qui marque aussi la fin de la parenthèse italienne de Rick et de Cliff. Los Angeles s’éveille à nouveau, ce qui pour Tarantino n’induit pas de filmer les studios ou les lieux les plus connus de la ville, mais plutôt de montrer les enseignes qui s’allument une à une.
Ces néons de bars et de cinémas, ces images scintillantes d’un autre temps, apparaissent comme le véritable poumon de la ville, dans toute leur beauté impure. Au cours de cette nuit chaude, Sharon Tate contemple au loin, avant d’entrer dans un restaurant, les lumières d’une avant-première. L’actrice s’étonne alors que les longs faisceaux blancs semblent provenir d’un cinéma porno. « Dirty movies have premieres too », lui réplique Jay Sebring avec un sourire. Il n’est pas insultant d’envisager ainsi Once Upon a Time…comme un dirty movie, soit un film qui se met en marge des lumières pour mieux s’ouvrir à elles. Ce sont, pour Tarantino, justement les plus beaux.



TARANTINO VIRTUOSE ET TORDU…
« Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus ». Cette phrase de Proust, dans Le temps retrouvé, Quentin Tarantino la fait plus que jamais sienne dans Once Upon A Time in Hollywood. Conçu d’abord comme une lettre d’amour, son film déploie, durant 2h40, une fresque à la fois ultra-ambitieuse dans ses moyens et néanmoins très simple dans son cheminement. On pouvait s’attendre, de la part du réalisateur de Pulp Fiction et Kill Bill, à une nouvelle fiction déconstruite, aux multiples ramifications spatio-temporelles. C’est au contraire son film le plus linéaire et flegmatique, en dépit de quelques digressions et flash-backs opportuns, ainsi que d’une voix off qui, comme un chœur de tragédie, se charge d’annoncer le fatum. Si Once Upon A Time in America, le grand récit proustien du maître de QT, Sergio Leone, carburait à l’opium et au ressouvenir, cet Il était une fois se shoote plutôt au cannabis la drogue de LA, avec une pointe de LSD…C’est en effet dans un pur présent qu’il se déploie ou plutôt un passé ramené au présent, avec un compteur précis de jours, et même d’heures, mais en l’étirant comme du chewing-gum. Pour faire durer le plaisir avant la fin inéluctable, pour profiter des derniers jours comme s’ils allaient durer toute la vie, pour retarder au maximum la chute du paradis. Tarantino, qui a toujours fonctionné selon ce principe d’écriture, le pousse ici à son paroxysme, non plus à l’échelle d’une scène mais de tout un film rejoignant ainsi Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, Mektoub My Love d’Abdelatif Kechiche ou Everybody Wants Some ! de Richard Linklater, dans leur tentative de capter une pointe temporelle dans son infinie brièveté.

Jouir avant sa perte…Los Angeles, et un certain rapport au monde. 69, QT a six ans, année du déclin du vieil Hollywood au profit de la télévision et bientôt du nouvel Hollywood, l’année, enfin, où Sharon Tate fut massacrée, avec un fœtus de 8 mois dans le ventre et quatre de ses amis, par trois membres de la « famille » de Charles Manson. Cet évènement, qui plane tel un spectre sur tout le film, bien que son « exécution » n’en prendra qu’une petite partie, signe historiquement, aux Etats-Unis, la fin de l’innocence, du flower power et de l’utopie hippie, noyée dans un bain de sang. Mais, en attendant, semble indiquer Tarantino, il faut jouir. Le maestro se plaît ainsi à ne filmer là, que ce qui se trouve au cœur de son désir.
Pornographie de la reconstitution…

Brad Pitt en cascadeur castagneur, mélancolique et nonchalant prenant l’avantage sur Leonardo Di Caprio, excellant en acteur ringard de série B. La reconstitution d’un western kitsch dans lequel il joue, si elle impressionne par sa virtuosité, manque d’enjeu. Là où Tarantino, en revanche, excelle, c’est dans l’accumulation gratuite et boulimique de détails. Il n’a au fond plus besoin d’une intrigue, la déambulation urbaine de deux sublimes losers, en train de tomber de leur piédestal, lui suffit. Costumes et accessoires vintage, voitures d’époque, vieux posters, musique soul et rock, enseignes disparues, la plus belle scène n’étant composée que de néons clignotants, boites de pâté pour chien presque érotique…Il y a presque ici une pornographie de la reconstitution accompagnée d’une grande précision historique, qui pourrait virer à l’académisme si Tarantino ne regardait pas le monde, son monde, avec une intensité folle. Voir par exemple comme il filme Margot Robbie et ses pieds, absolument solaire et extatique, lorsqu’elle va au cinéma se mirer.
Versatile dans son propos…Reste la question politique, follement perverse. Par une foule de détails, parfois à la limite de la private joke par exemple quand il fait dire à une hippie psychopathe que sa violence n’est qu’une saine réaction face à celle des écrans hollywoodiens, Tarantino semble adresser un doigt d’honneur, accompagné d’un rire sardonique, à ses détracteurs. Plutôt que de s’excuser, il creuse ainsi son sillon, un peu à la manière de Lars Von Trier dans The House That Jack Built. Il joue carrément avec le feu lorsqu’il laisse entendre, sans le confirmer, que le personnage de Brad Pitt aurait pu se tirer d’un féminicide, sans autre conséquence pour lui qu’une mauvaise réputation sur les plateaux de tournage. Lui-même accusé, peu de temps après Metoo de maltraitances vis-à-vis de son égérie Uma Thurman sur le tournage de Kill Bill, il fait peut-être là une projection tordue. Et toute l’ambiguïté de ce soi-disant âge de l’innocence qu’il entend restaurer, de ce cristal de temps qu’il fait scintiller allègrement, finit par exploser dans le dernier acte, sauvage et sadique. Le film laisse un drôle de goût en bouche, tandis que demeure indécidable le degré d’ironie que porte le cinéaste sur la restauration des valeurs archaïques qu’il met en œuvre.









04/ A-t-on le droit de jouer avec Adolf ? par Jean-Luc Douin
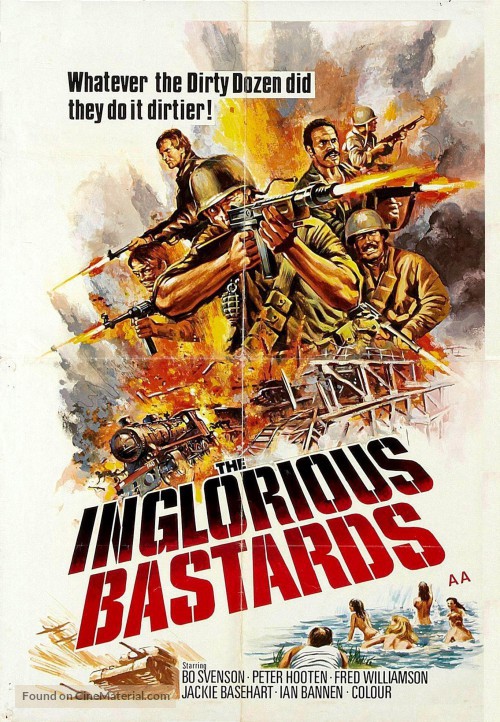
Au surnom de « chasseur de juifs », qu’il renie avec effroi « Je ne suis qu’un détective ! », image du faux derche sardonique maîtrisant sa mission infâme avec un aplomb pervers. Christoph Waltz prix d’interprétation à Cannes. Un colonel nazi traque la famille Dreyfus dans la France occupée. L’une de ses proies lui échappe, la jeune Shosanna, que l’on va retrouver plus tard à Paris, propriétaire d’une salle de cinéma réquisitionnée par Goebbels. Comme Kill Bill, où Uma Thurman exterminait tous les individus ayant gâché ses noces par un massacre, Inglourious Basterds est une histoire de vengeance. Celle-ci prend deux visages. Celle qui prévoit de transformer la salle en brasier le jour où Hitler viendray honorer l’avant-première d’un film à la gloire d’un sniper allemand. Celui du lieutenant Aldo Raine, péquenot sudiste qui s’est juré de semer la terreur dans les lignes hitlériennes avec son commando de juifs, les « Inglourious Basterds », sombres salauds, pour reprendre le titre du film, lui-même décalqué de celui d’une série B d’Enzo Castellari en 1978, qui piétinent les règles de la guerre en scalpant leurs prisonniers. Ces derniers s’immiscent dans le plan d’une actrice allemande travaillant avec les ennemis du IIIe Reich. La vengeance n’est pas seulement celle de ces personnages. Elle symbolise la démarche de Quentin Tarantino qui, transgressant les règles de l’Histoire, imagine une issue chronique dans son film, les choses ne se déroulent pas comme dans la réalité. Le complot contre Hitler ne va pas avoir les mêmes conséquences que celui qui conduisit le colonel Stauffenberg à l’opération Walkyrie en 1944. Les juifs peuvent-ils se venger par la fiction, par le cinéma, par ce cinéaste qui clame là sa foi iconoclaste dans le septième art ? Le cinéma peut-il sauver le monde ? Tarantino croit en tout cas qu’il peut venger les juifs en signant un film où les sales SS sont exterminés, honnis comme dans un spectacle de marionnettes.



Miner les genres hollywoodiens par le fun, réinventer le monde par le cinéma bis, le kung-fu, la mauvaise télévision des années 1960, le western spaghetti dont s’inspire beaucoup Inglourious Basterds, avec une utilisation pastiche des musiques d’Ennio Morricone, cette démarche a fait le style de Quentin Tarantino, sa gloire. Elle est jouissive quand il la maîtrise totalement, ce qui est le cas dans cette version remontée, resserrée, où perdurent ses invraisemblances et des tunnels de dialogue, mais qu’un montage mieux maîtrisé rend plus digeste. Ce pari d’une fiction affranchie de toute servitude historique ne cache pas ses origines culturelles. C’est une utopie d’Amérique, avec ode au melting-pot, métissage et cosmopolitisme social et cinématographique, cocktail de boissons avec lait, bière, champagne, et whiskies, mélange des langues et des accents, déguisements hollywoodiens, allusions aux Indiens, éloge du Black. Ce qui n’est pas sans lien avec Leni Riefenstahl, citée dans le film, qui propagea une vision nazie de l’histoire, signant un film sur les Jeux olympiques de Berlin où elle s’attardait sur Jesse Owens, vainqueur du 100 mètres et icône de puissance et de beauté physique. Avec, aussi, allusion aux nazis qui trouvèrent refuge aux Etats-Unis, le tatouage d’une croix gammée administré sur le front des bourreaux est affiché comme le châtiment minimal auquel doit s’attendre un survivant nazi. Si jubilatoire que soit ce dynamitage des faits, restent des questions éthiques, possibles objets de débats à venir. Jusqu’où peut aller le sacrilège historique et à quels risques ? On peut bien sûr s’amuser à imaginer un film où Waterloo fut la plus belle victoire de Napoléon, mais pourquoi, dans quel but, et pour quelles conséquences ? Dans la farce, l’esprit Mash, la bande dessinée trash, lorsque Tarantino dépeint ses « basterds » cassant du nazi comme dans un jeu vidéo, leur défonçant le crâne à coups de batte de base-ball par jouissance compensatoire, surgit moins un sentiment viscéral de justice que le principe de la loi du talion, avec le spectre de Guantanamo. Nous ne sommes certes pas ici dans le démenti ni dans le révisionnisme. Juste sur un terrain délicat.




Quentin Tarantino est fou, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime. Mais il faut reconnaître que le réalisateur va parfois un peu loin, comme ce jour où il a étranglé Diane Kruger. Car oui, ce sont bien les mains de QT qu’on voit sur le plan serré où on voit le visage de l’actrice allemande agonisant, les yeux exorbités. Cette histoire n’est pas une légende, elle a même été confirmée par les deux parties. A commencer par Diane Kruger…Je me fais étrangler, ce qui était très bizarre car on le ressent quand quelqu’un vous étouffe, c’était une journée de boulot particulière. Le plus drôle, c’est qu’on voit les mains de Quentin sur le plan serré. Quentin m’a dit qu’il n’allait pas bien le faire, ce sera trop ou pas assez, qu’il devrais le faire lui-même…C’était très étrange de me faire étrangler par le réalisateur…Version corroboré par Quentin Tarantino…Quand on voit quelqu’un se faire étrangler dans un film, je n’y crois jamais, j’ai parlé à Diane et je lui ai dit que je voulais le faire moi-même, et sur une prise…Je vais t’étrangler, te priver d’oxygène, on verra la réaction sur ton visage et on coupera. Elle m’a fait confiance, et on a obtenu un truc vraiment bon. C’était vrai.

TARANTINO RACONTE…
par Serge Kaganski
Quentin Tarantino n’est pas seulement un homme de cinéma, c’est aussi un homme de paroles sur le cinéma. Si le cinéaste gagne à chaque film en audace et en maturité, l’homme a toujours cette volubilité enthousiaste du geek de club vidéo qui peut commenter pendant des plombes un raccord ou un plan. Il décortique ici son Inglourious Basterds, ébouriffante odyssée dans la France occupée des années 40, mais aussi, simultanément, dans un territoire plus imaginaire, le pays des images de cinéma. La parole est à Quentin.
Le nazisme et le sort des Juifs sont des sujets lourds. As-tu eu des doutes en greffant ce contexte historique à ton univers ? Les gens qui aiment mon cinéma auraient été déçus si je n’avais pas imprimé mon style habituel. Je n’ai pas laissé mon petit sac de trucs au vestiaire, je suis resté moi-même.
Pour la préparation, avez-vous lu ou revu des films sur la Seconde Guerre mondiale ? Quand j’ai initié ce projet, il y a pas mal d’années, j’ai fait beaucoup de recherches, j’ai lu beaucoup de livres sur la vie en France sous l’Occupation. Je connaissais déjà assez bien le cinéma français de l’époque. J’ai passé six mois à apprendre un tas de choses très intéressantes, et ensuite, j’ai passé une année entière à essayer de faire entrer toutes ces connaissances dans un scénario, ce qui n’était pas facile. Ça m’a pris du temps d’évacuer toute cette masse de savoir de mon système. Bref, en 2008, quand j’ai repris le travail sur le scénario, j’avais digéré ce que j’avais appris. Je pouvais enfin me concentrer avant tout sur l’histoire que je voulais raconter, comme pour n’importe quel autre de mes films. Et s’il m’arrivait de buter sur une situation dont je ne connaissais pas la vérité historique, eh bien j’inventais, afin d’avancer et de ne pas rester bloqué ! Une fois le scénario terminé, je suis revenu en arrière pour vérifier la teneur historique des passages que j’avais inventés. Par exemple, à quelle heure était le couvre-feu à Paris sous l’Occupation, des choses comme ça.
Le film fait parfois penser à une parade du cinéma à l’ancienne, avec tous ses genres et ses figures de style, du cinéma classique au cinéma bis. D’une certaine manière, ça pourrait être ça. Mais quand j’ai commencé à écrire ce film, je ne savais pas encore que ça deviendrait cette espèce de lettre d’amour adressée au cinéma. Au début, mon intention était de faire un film sur une bande de mecs en mission. Et puis j’ai écrit la scène sur les mérites comparés de Chaplin et de Max Linder, le genre de conversation qui m’est très naturelle. Je me suis dit…Ok, tu es en train d’écrire un film de Seconde Guerre mondiale, mais tu es incorrigible, ce sera quand même et malgré tout un hommage au cinéma.



Le film cite des films, des cinéastes, mais il y a aussi une salle de cinéma cruciale, une cabine de projection, de la pellicule, un exposé sur le nitrate, et même un critique ! Comme si tu avais voulu rendre hommage à tous les aspects du cinéma ? Je pourrais répondre oui à ta question, mais je ne me suis pas dit consciemment que j’allais citer tous les métiers du cinéma. J’ai fait ça de manière plus inconsciente, et avant tout parce que ces éléments servaient l’histoire. Par exemple, quand j’ai eu l’idée de me servir de la pellicule 35 mm en nitrate comme d’une bombe qui détruirait la salle de cinéma et le IIIe Reich, j’ai su que j’étais sur les bons rails. Je me suis exclamé…“Quelle idée géniale ! Comment se fait-il que personne ne l’ait eue avant ?” Cette idée que ce ne serait pas une bombe ou de la dynamite qui abattrait les nazis, mais du film ! D’un côté, c’est une métaphore juteuse que ce soit le cinéma qui gagne contre le IIIe Reich, de l’autre, ce n’est pas une métaphore, c’est la réalité, le nitrate était hautement inflammable, et dans le film, la pellicule elle-même tue les nazis. Ça fonctionne à tous les niveaux. Mais il y a encore d’autres niveaux possibles. Imaginons de quoi est fait le tas de pellicule qui va brûler. Peut-être de tous ces films que les nazis ont interdits ? Disons que La Soupe au canard, Le Dictateur, To Be or Not to Be sont dans ce tas. Si on imagine ce cas de figure, c’est comme si Chaplin, Lubitsch ou les Marx Bros eux-mêmes abattaient le régime nazi ! Maintenant, imaginons une autre hypothèse, ce sont des films de propagande nazie, Le Juif Süss, La Ville dorée, etc. Dans ce cas-là, ce serait la création monstrueuse des nazis qui se retournerait contre eux. Tous ces niveaux de lecture sont possibles.
Parmi les films cités directement ou allusivement, il y a Le Corbeau de Clouzot. C’était difficile de trouver des films français de l’époque que j’aimais et qui n’étaient pas censurés par les nazis. Le Corbeau en était un. Je préférais citer ce film plutôt qu’un Fernandel ! Et puis il y a toute la polémique qui a existé autour de ce film. On l’a accusé d’avoir montré des crimes qui n’étaient pas patriotiques, d’avoir fait un film plus ou moins collabo, c’est n’importe quoi. Moi, j’aime ce film, c’est avant tout un excellent thriller noir situé dans une ville corrompue jusqu’à la moelle, mais je peux comprendre qu’on en ait fait des lectures différentes à l’époque. En tout cas, j’ai pris plaisir à inscrire ce film au fronton de la salle de cinéma de mon film.
La référence à Danielle Darrieux est-elle un hommage à l’actrice française, ou une allusion à son voyage à Berlin pendant la guerre ? J’ignorais cet épisode du voyage à Berlin. Non, si je parle de Danielle Darrieux, c’est en tant qu’icône féminine absolue du cinéma français de l’époque. J’aurais pu choisir une autre actrice, Annabella par exemple, mais il me semble que Darrieux était la plus emblématique, la plus rayonnante. Cette histoire du voyage à Berlin ajoute un autre niveau au film, mais celui-là est involontaire de ma part. C’est marrant parce que cet exemple n’est pas isolé. Par exemple, j’utilise à un moment une chanson de Zarah Leander. Et dans un café, j’ai fait mettre un poster de film avec Zarah Leander et Bridget von Hammersmark. Dans la réalité, Zarah Leander était une icône du cinéma nazi, en tant que chanteuse et actrice. Mais il y a des rumeurs insistantes selon lesquelles elle était agent double, exactement comme von Hammersmark, à cette seule différence que Leander travaillait supposément pour les soviétiques ! Je ne sais pas si cette rumeur correspond à une vérité historique mais je trouve déjà intéressant en soi qu’elle existe. On pourrait imaginer Zarah et Bridget ensemble sur un plateau de tournage en train d’envoyer des messages secrets à leurs contacts respectifs !
La pellicule qui brûle évoque les autodafés, l’incendie de la salle fait penser aux crématoires, de même que les basterds pratiquent l’étoile jaune à l’envers en gravant des croix gammées sur le front des nazis capturés. Dans le film, les Juifs retournent contre les nazis leurs propres armes. C’était complètement mon intention. Les Juifs se vengent douleur pour douleur. Ils font aux nazis exactement ce que les nazis leur ont fait.
Tu as pris des libertés avec l’histoire. Dans la réalité, les Juifs ne se sont pas vengés des nazis, tout au plus ont-ils fait des procès à certains responsables pris. Tu inventes ta propre chute du nazisme. Crains-tu les réactions des historiens ou des spectateurs ? Pas vraiment. Je ne triche pas, je fais inscrire dès le début du film, “Il était une fois…” et non, “Basé sur des faits véridiques” ! Je ne prends personne en traître, c’est un conte, une fiction et c’est affirmé d’emblée. Ça veut dire “Regardez ce film comme une fantaisie, comme un roman, comme un conte noir”.

Un élément frappant du film, c’est son aspect polyglotte. Était-ce juste pour les besoins du récit, ou avais-tu aussi l’idée de critiquer l’ethnocentrisme des codes hollywoodiens où tout le monde parle anglais quelle que soit sa nationalité ? Mon premier sentiment, c’est que je m’adresse à un public jeune, aux deux dernières générations. On ne peut plus prendre des acteurs académiquement shakespeariens pour jouer des nazis, ce serait daté, pas crédible. Que ces acteurs s’expriment dans un anglais parfait ou en imitant l’accent allemand, peu importe, on ne croirait plus à ce type de convention. Attention, à l’époque, ça fonctionnait, et j’aime beaucoup certains de ces vieux films, mais c’est juste qu’on ne peut plus faire un film comme ça. Par ailleurs, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, comprendre ou ne pas comprendre telle langue et notamment l’allemand était souvent une question de vie ou de mort. Pensez à la première séquence du film. Si vous étiez un paysan français, ou tchèque, connaître la langue allemande pouvait vous sauver la vie. Et se demander si les uns comprennent ou pas ce que disent les autres peut générer des situations de suspense incroyables. Dans la première séquence, c’est sans doute parce qu’elle a compris la conversation en anglais que Shosanna réussit à se sauver à temps.
Les différentes langues du film créent du suspense, de la comédie et de la sensualité. L’acteur Christoph Waltz est extraordinaire. Le personnage de Hans Landa serait moins réussi et complexe s’il parlait tout le temps anglais. On a l’impression que Christoph est né pour jouer Landa. En écrivant Landa, je savais que j’inventais un de mes meilleurs personnages. Mais il fallait trouver l’acteur pour l’incarner. Cet acteur devait être bon, mais aussi un génie polyglotte, sinon le personnage n’aurait pas existé à l’écran comme sur la page. L’affaire des langues n’est pas spécifique à Inglourious Basterds, tous mes films accordent une grande importance à la question du langage, de la parole. Pour revenir à Landa, j’ai auditionné de nombreux acteurs allemands, ils étaient formidables. Ils parlaient allemand, évidemment, mais la plupart parlaient aussi un bon français. Et ils parlaient anglais couramment. Mais pouvaient-ils lire de la poésie en anglais ou en français ? Pouvaient-ils raconter des blagues efficacement ? C’est une chose de savoir parler une langue techniquement, c’est autre chose de la maîtriser dans toutes ses subtilités. Christoph Waltz peut dire de la poésie dans les trois langues, c’est la différence. Il sait prendre le rythme des trois langues, il peut raconter des blagues et faire rire dans les trois langues. On a le sentiment qu’il a trois langues maternelles.



A propos de rumeurs, beaucoup ont couru sur un nouveau montage du film qui aurait inclus des scènes avec Maggie Cheung ou Samuel L. Jackson. Finalement, le montage final est très proche de la version cannoise. Pourquoi avoir coupé ces séquences que l’on aurait envie de voir ? C’est un processus normal de tout film, on tourne plus que ce qui est au final sur l’écran et c’est à ça que sert le montage. Je dirais que le scénario a toujours besoin de plus d’éléments que le film. Dans le scénario, on a besoin de raconter chaque personnage, de lui donner un passé, de se reposer sur les fondations les plus solides possibles. Quand on passe à l’écran, il faut resserrer. Il y a des éléments qui semblaient importants dans le scénario mais qui le sont beaucoup moins sur l’écran. Je vais te donner un exemple : Maggie était magnifique. Mais la partie avec Maggie expliquait pourquoi et comment Shosanna se retrouvait directrice et propriétaire d’une salle de cinéma à Paris. J’ai préféré l’idée qu’il valait mieux ne rien savoir des trois années de Shosanna depuis la ferme du massacre jusqu’à la fin de la guerre à Paris. C’est au spectateur d’imaginer, de combler cette béance, ça donne plus de mystère au film et au personnage de Shosanna. Le truc aussi, c’est que si je me mettais à filmer toute l’histoire de Shosanna, je pourrais faire un tout autre film. C’était : soit je raconte tout Shosanna et je fais un autre film, soit je ne dis rien de ses trois années entre les deux périodes du film. A part ça, toutes les rumeurs supposant que j’allais rallonger le film étaient du pur bullshit. On a juste procédé à quelques ajustements mineurs après une projection test à Los Angeles.
Es-tu curieux des réactions, notamment dans les pays directement concernés par le contexte du film comme la France, l’Allemagne ou Israël ? Je suis très curieux, mais sans anxiété particulière. Mes films ont toujours suscité des réactions diverses, parfois selon les pays. Mais là, je suis conscient que le sujet est bien chargé, ce qui devrait rendre les réactions encore plus intéressantes que d’habitude. L’Allemagne ne m’inquiète pas du tout, on a tourné là-bas, et les Allemands qui ont lu le scénario et aidé à financer le film sont nos supporters. Je pense que le pays le plus intéressant sera Israël. Je vais y aller sans trop savoir à quoi m’attendre.
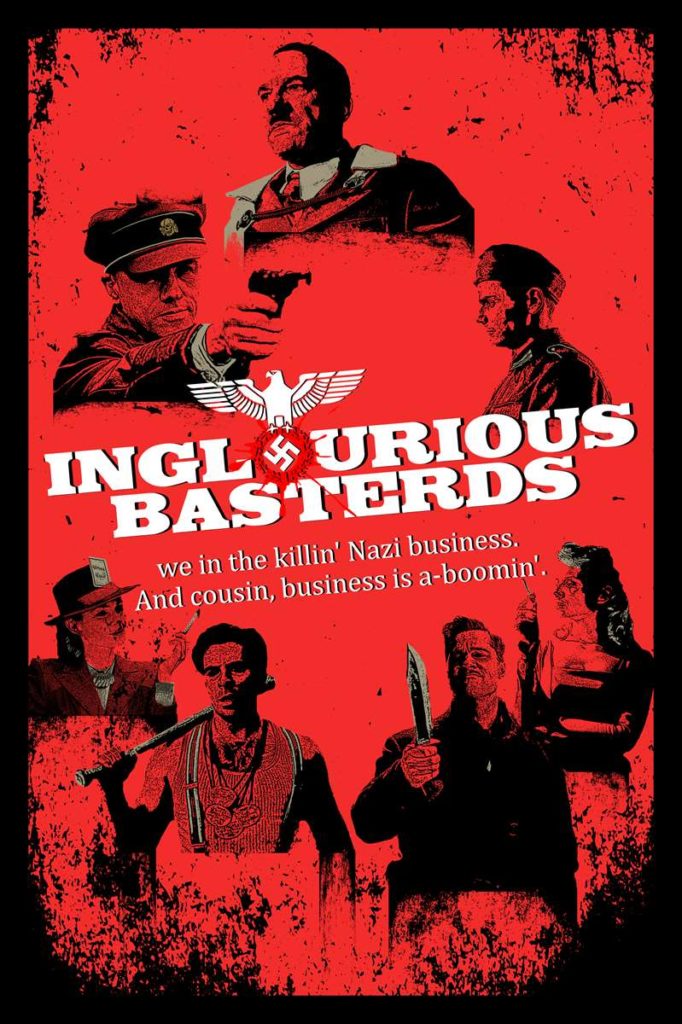



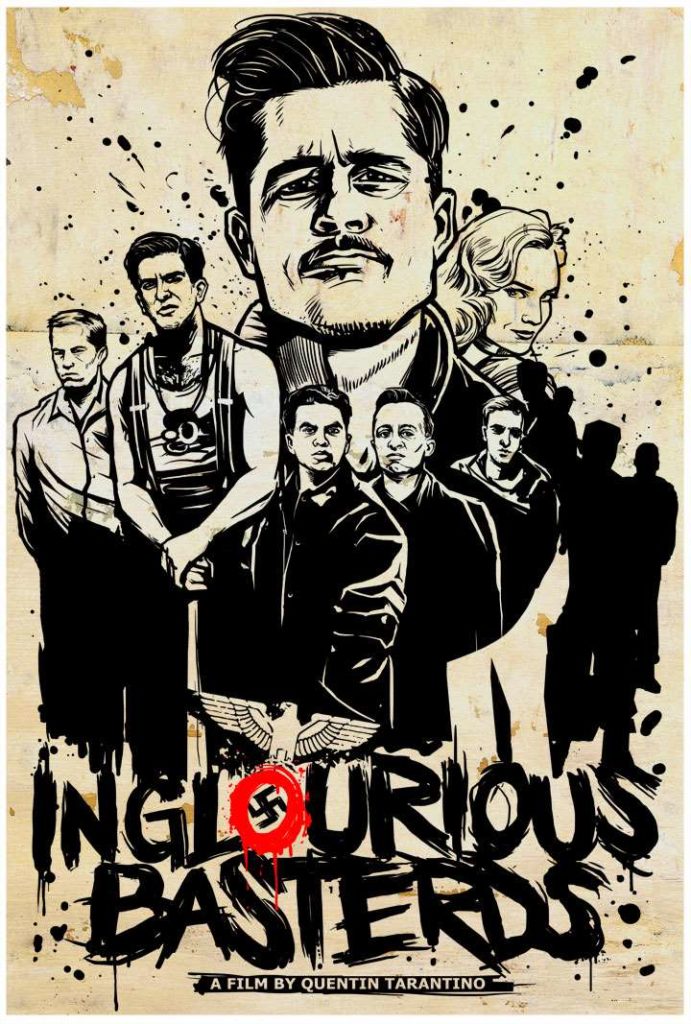
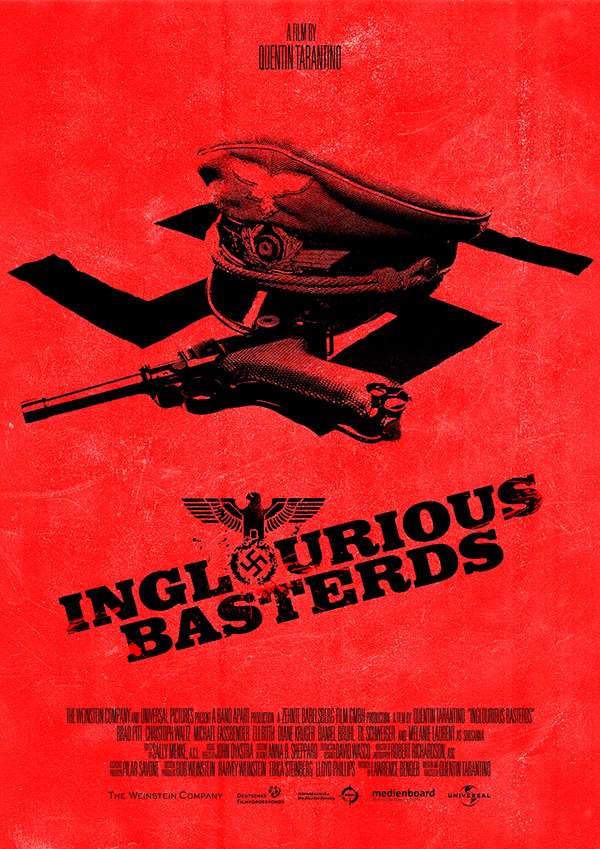
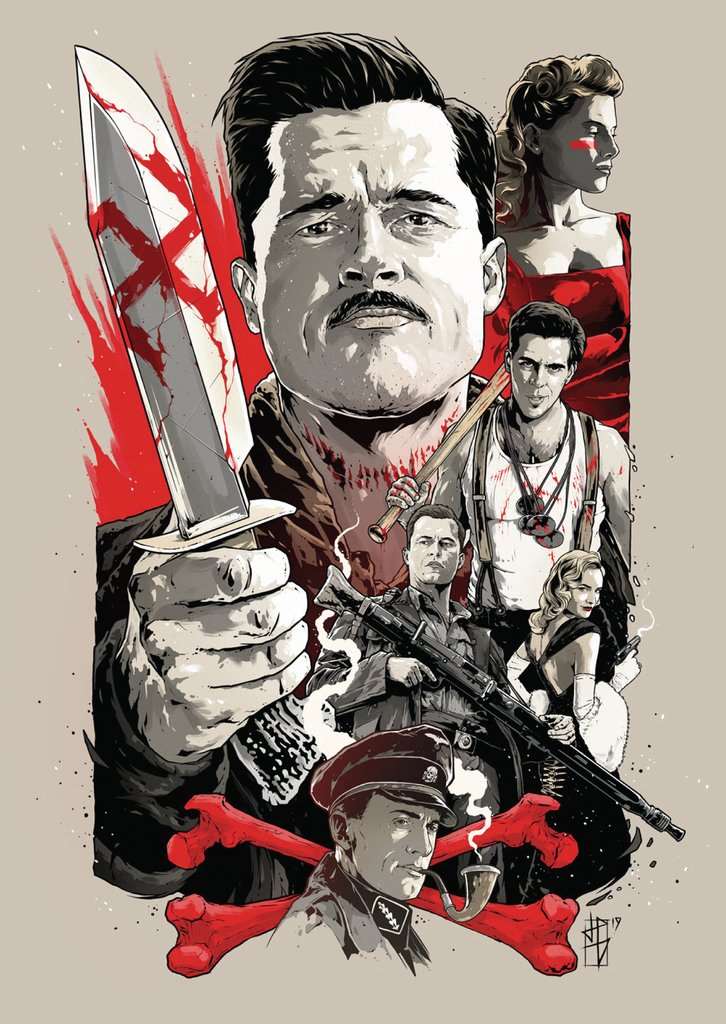
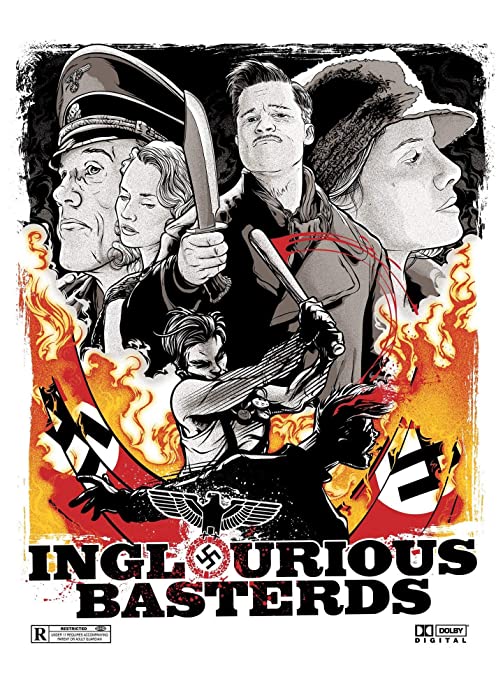





05/ REVANCHE !!!
Dans l’Ouest de Tarantino, rien de nouveau. Et en même temps, tout est neuf. Nouveau genre (le western), nouveau sujet (l’esclavage), nouveaux acteurs (Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio) nouveaux lieux dans l’immensités du Wild West. Mais aussi même science du dialogue à mèche longue, de la réplique qui fuse, même goût du recyclage cinéphage et de la représentation limite de la violence, mêmes figures de la Tarantino’s connection. On est au milieu du XIXe siècle, juste avant la guerre de Sécession. Le docteur King Schultz (Waltz), médecin charlatan et chasseur de primes, libère l’esclave Django (Foxx) et fait alliance avec lui, d’abord pour traquer et capturer une bande de hors-la-loi, puis pour aller délivrer la fiancée de Django, prostituée-esclave dans une plantation. Ladite fiancée répond au nom insolite de Broomhilda, dérivé du germanique Brunhilde. Dans la première partie, Papa Schultz/Waltz se fend d’un véritable cours sur la mythologie allemande qui nous enseigne que l’arc narratif de Django Unchained sera lointainement inspiré des Nibelungen. Influence germanique assez inhabituelle pour un western, mais finalement assez logique dans la continuité tarantinienne…Django Unchained est aux Noirs ce qu’Inglourious Basterds était aux Juifs, une revanche ciné-fictive sur l’histoire.




Le terrible dieu Wotan du mythe germanique prend ici les traits d’un odieux propriétaire terrien, Calvin Candie (DiCaprio), qui ne se distrait qu’au spectacle de ses esclaves dévorés par des chiens ou se battant entre eux à mains nues tels des gladiateurs. Dans cette partie “plantation” mixant ciné A et ciné Z, Tarantino insère des influences européennes qui sont à la fois cinéphiles et justifiées par le récit les maîtres sudistes se prenaient pour des rois et se piquaient de raffinement européen alors que Tarantino prend manifestement plaisir à filmer des séquences de dîners aux candélabres avec vaisselle chic et codes sociaux sophistiqués. Il pense peut-être à Visconti, cite Dumas, ce qui fait également sens puisque Monte Cristo est l’une des plus célèbres fictions de vengeance, genre prisé du cinéaste. Comme avec Inglourious Basterds, Tarantino parvient à faire cohabiter tragédie historique et comédie. La méthode reste la même avec un personnage principal qui porte en lui la part sérieuse du film, Django étant aussi habité de douleur et de colère que l’était Shosanna/Mélanie Laurent. La comédie est répartie sur les autres personnages, Waltz reprenant son grand numéro de phraséologue dialecticien à l’élocution irrésistible, mais en étant ce coup-ci du côté du bien.



On notera une impayable séquence sur les cagoules du KKK ou encore la jouissance incorrecte de Samuel L. Jackson à jouer sans frein un ultra-Oncle Tom au service des Blancs racistes, version noire-américaine de la figure du kapo. Malgré les mille plaisirs qu’il dispense, Django Unchained laisse aussi avec un léger bémol en arrière-goût. Deviendrions-nous tarantinoblasés ? Après réflexion, il m’a semblé que la pointe de déception tenait au western, un genre pas facile à renouveler, comme si les codes inévitables que sont les chevaux, les grands paysages, les villes en bois, les duels au colt étaient irrémédiablement figés dans le formol de l’imagerie, du passé de l’histoire et du cinéma, du déjà trop vu. Autres grands recycleurs de genres, les frères Coen avaient connu le même souci avec True Grit, bon film mais pas leur meilleur parce qu’ils parvenaient moins à surprendre…Tarantino réussit à secouer le western par le sujet, les situations et dialogues, moins par la facture visuelle et la mise en scène. À cette réserve près, c’est globalement du très bon. Du Quentin.

ONCE UPON A TIME IN THE SOUTH…Au bout d’une filmographie qui compte à présent huit films, c’est sûr qu’on ne le présente plus. Si son dernier opus témoigne dès son générique, non, dès le logo du studio une version granuleuse d’époque de la porteuse de la torche de Columbia du style de son auteur, que les mauvaises langues diront singé ailleurs et que les amateurs savent reconnaître comme une vision post-moderne, on a tout de même l’impression d’un tournant marqué avec Inglourious Basterds. Le nouveau Tarantino confirme un Tarantino nouveau. On a souvent accusé le cinéaste de faire des films vides, sacrifiant la substance au profit de l’iconographie cool de tout un pan du cinéma, certes soigneusement recrée mais creux aux yeux de ses détracteurs. Peut-être est-ce cette injuste critique de son œuvre qui l’a motivé, ou peut-être est-ce la prise de conscience par le metteur en scène lui-même de la vanité de son Boulevard de la mort, après le film-somme Kill Bill, mais avec Inglourious Basterds, et maintenant Django Unchained, l’auteur ne semble plus vouloir se contenter de revisiter l’Histoire du cinéma, mais se permet de revisiter l’Histoire tout court. Les deux étant destinés à se mêler inévitablement.

PULP NON-FICTION…Dans son précédent film, Tarantino réécrivait l’Histoire en faisant mourir Hitler de manière jouissive, un gros plan nous montrant son visage troué de balles dans un cinéma en flammes sous les rires d’une juive. S’il n’y a rien d’aussi uchronique dans Django Unchained, les deux œuvres restent indéniablement parentes dans leur volonté de retraverser une époque sombre de l’Histoire en prenant des libertés avec la réalité, libertés que seul le cinéma peut permettre, et qui se font d’autant plus réjouissantes lorsqu’il s’agit du cinéma de genre qu’affectionne tant le cinéaste. A travers les yeux de Tarantino, l’esclave noir devient alors une icône de western, le cinéma lui donnant les moyens de sa vengeance, inaccessible dans le monde réel. Si le film n’est pas un aussi pur revenge movie que Kill Bill, il partage toutefois un goût similaire pour le divertissement, beaucoup plus classique et direct dans sa narration et son traitement qu‘Inglourious Basterds. En fait, le dernier né du metteur en scène s’avère être un peu le bâtard de ces deux films. On retrouve évidemment l’affection et le don de Tarantino pour les dialogues désarmants, art sur lequel reposait presque entièrement Inglourious Basterds dont le récit s’articulait principalement autour de scènes de dialogues laissant la tension monter de façon insoutenable jusqu’à explosion. Cependant, le scénariste semble nous dire ici, en reprenant Christoph Waltz dans le même genre de rôle de manipulateur verbeux, que cette fois-ci le personnage se retrouve tout seul dans un monde bien moins civilisé où l’on a plus tôt fait de laisser parler les armes.
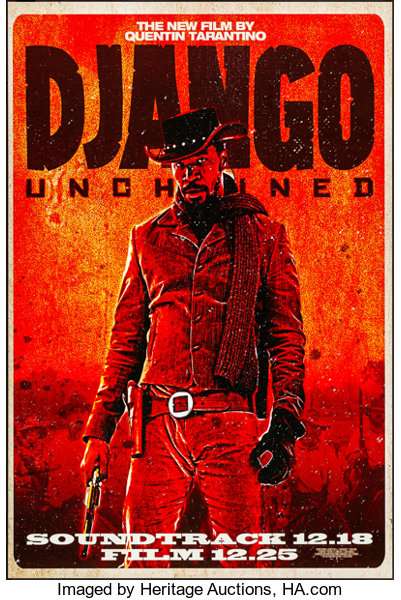
GLORIOUS BASTERD…Un film bâtard donc, avec ce que ça peut entendre de péjoratif, le terme pouvant coller à la structure et au rythme du film, quelque peu malaisés passé l’extraordinaire premier acte. Le récit alterne plus difficilement les moments de tuerie littérale avec les instants plus calmes mais plus menaçants. Est-ce dû à la disparition de Sally Menke, monteuse de tous les films du cinéaste? On ne le saura jamais. Mais après la longue et jouissive introduction montrant comment Django évolue d’esclave à chasseur de primes, le film accuse un coup de mou une fois que nos protagonistes arrivent chez Calvin Candie. Si la suite parvient à faire la part belle à la spécialité du loquace scénariste, elle souffre tout de même de quelques longueurs, avant un climax bonus, une fois de plus jubilatoire, mais moins impliquant que ceux de Kill Bill et Inglourious Basterds. Au-delà de ce léger bémol, Django Unchained demeure une œuvre fascinante. On y retrouve cette même charge que dans le précédent envers un ordre établi méprisable jadis l’Allemagne nazie, à présent l’Amérique esclavagiste, incarnée par un Leonardo DiCaprio génialement inhumain avec le même genre d’ambiguïté morale dans la caractérisation de nos héros. Autrefois, la troupe de soldats juifs gravant des croix gammées dans des fronts comme des étoiles jaunes, ici le commerce du corps auquel se livrent tant les esclavagistes que les chasseurs de prime. Sans oublier le constat des violences infligées à tout un peuple qui nous mène à nous demander si le film n’est pas une parabole pour justifier la délinquance chez les minorités.
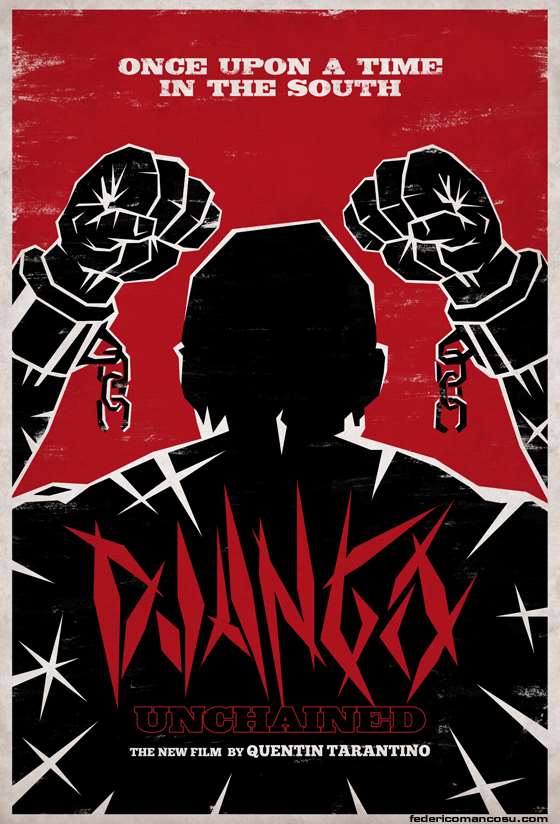
THE GOOD, THE BLACK, THE UGLY…Pour les noirs américains, le Dr. (Martin Luther) King est un sauveur. Dans le film, le sauveur baptisé Dr. King (Schultz) est un blanc qui éduque un noir non-civilisé, pour l’amener vers le chemin non pas de la paix et de la cohabitation, mais de la violence. Et Tarantino couronne Django père de la blaxploitation. Tout cela pourrait être polémique si Schultz n’était pas un personnage aussi romantique, véritable cœur du film, businessman qui se prend d’amitié pour celui qu’il commence à voir comme une figure de conte. Oui, parce que Django Unchained est de ces films qui parviennent à citer d’abord Au service secret de sa majesté puis L’Anneau des Niebelungen. La romance est parfaite, et l’on aurait pu regarder des heures de Waltz et Jamie Foxx cavalant dans le Far West. Dans ce festival d’acteurs, Foxx offre une performance tout en retenue et Samuel L. Jackson rappelle l’interprète qu’il était, les rôles étant écrits une fois de plus aux petits oignons par l’auteur. Django Unchained est un de ces cocktails dont Tarantino a le secret, faisant ressortir toute l’iconographie d’un genre, avec une bonne dose de sang cathartique et de références digérées, qui peut se targuer d’avoir un fond, même s’il n’est peut-être pas aussi abouti que dans Inglourious Basterds, en plus d’être un film de genre badass, même s’il n’a pas l’ampleur de Kill Bill.
Une parodie grotesque» de l’esclavage ?
Le dernier film de Tarantino, western violent autour d’un ancien esclave devenu chasseur de primes, essuie de nombreuses critiques de la part de la communauté afro-américaine. Par Fabrice Rousselot, Correspondant à New York. La première salve est venue de Spike Lee, jamais avare d’une controverse. le réalisateur de Brooklyn, un rien méprisant, a précisé qu’il n’irait pas voir le dernier opus de Quentin Tarantino, Django Unchained…Je ne veux pas en parler parce que je ne vais pas me déplacer, la seule chose que je peux dire c’est que ce serait irrespectueux pour mes ancêtres d’aller voir ce film. L’esclavage aux Etats-Unis ne ressemblait pas à un western spaghetti de Sergio Leone. Ce fut un holocauste. Mes ancêtres étaient des esclaves. Volés d’Afrique. Je tiens à leur rendre hommage. Depuis, la polémique n’en finit plus d’enfler Outre-Atlantique. Django unchained, et donne lieu à des joutes enflammées. Avec un Quentin Tarantino dans le rôle de celui qui est allé trop loin, accusé par une grande partie de la communauté noire d’avoir fait une «parodie grotesque» de l’esclavage. Et défendu par d’autres pour son «irrévérence et son audace». Son film, de par son outrance, ouvre la voie à de nombreuses critiques justifiées. Et pose de nombreuses questions plutôt qu’il n’apporte de réponses…Les attaques se sont notamment concentrées sur l’incroyable violence d’un drôle de long métrage à la limite du gore, mais aussi sur l’utilisation pour le moins récurrente du terme «nigger», qui intervient en rafales durant deux heures et trente minutes, comme les coups de feu de Django, l’esclave devenu chasseur de primes. En anglais, «nigger» est l’insulte suprême et raciste pour la communauté afro-américaine, même s’il est employé par les rappeurs blacks dans toutes leurs chansons sous forme d’autodérision. Spike Lee, déjà, avait reproché à Tarantino d’avoir recours trop souvent à «nigger» dans Reservoir dogs ou Jackie Brown. Cette fois, certains se sont indignés du fait que Django lui même répète l’injure jusqu’à la nausée. Tarantino s’est défendu vivement, en évoquant des «critiques ridicules» et en soulignant que le mot était lié à l’époque…Evidemment que si vous prenez un téléspectateur du 21ème siècle et que vous le transposez en ce temps-là, il va entendre des choses horribles…La querelle a encore pris une autre dimension quand plusieurs voix s’en sont pris à Tarantino en regrettant que Django Unchained fasse de la vengeance aveugle la seule réponse possible à l’esclavage. Avec un Jamie Foxx déchainé, qui tire sur tout ce qui bouge et qui a cette réplique définitive quand le Dr Schultz lui propose d’être chasseur de primes…Tuer des blancs et être payé? Qu’est-ce qu’il y a de mal à cela ?




D’autres disent que Tarantino brise un tabou…A de rares exceptions, le thème de la vengeance dans le cinéma américain est réservé à l’homme blanc. D’autres ont plaidé pour prendre un peu de recul et laisser toute la place à l’art de la provocation de Tarantino et à la pop-culture qu’il véhicule…En réalité, le malaise vient du fait que Tarantino veut choquer, comme il l’a fait avec Inglourious Basterds, mais personne ne pouvait s’attendre à un documentaire de sa part. Aux Etats-Unis, beaucoup de Noirs estiment qu’ils sont les seuls à pouvoir aborder la question de l’esclavage. Au moins le film a-t-il l’avantage d’ouvrir une conversation sur une époque qui reste très sensible et dont pas grand monde ne parle au grand écran. Au-delà de la violence et de la farce, le film replace aussi les Noirs au centre du mythe américain. Jusque-là, on avait droit à John Wayne sur un cheval qui tirait dans tous les sens et on faisait comme si les Noirs n’existaient pas. Mais Tarantino montre un Noir sur un cheval, qui est plus habile avec les armes que n’importe quel autre cowboy, et qui part à la recherche de la femme qu’il aime.

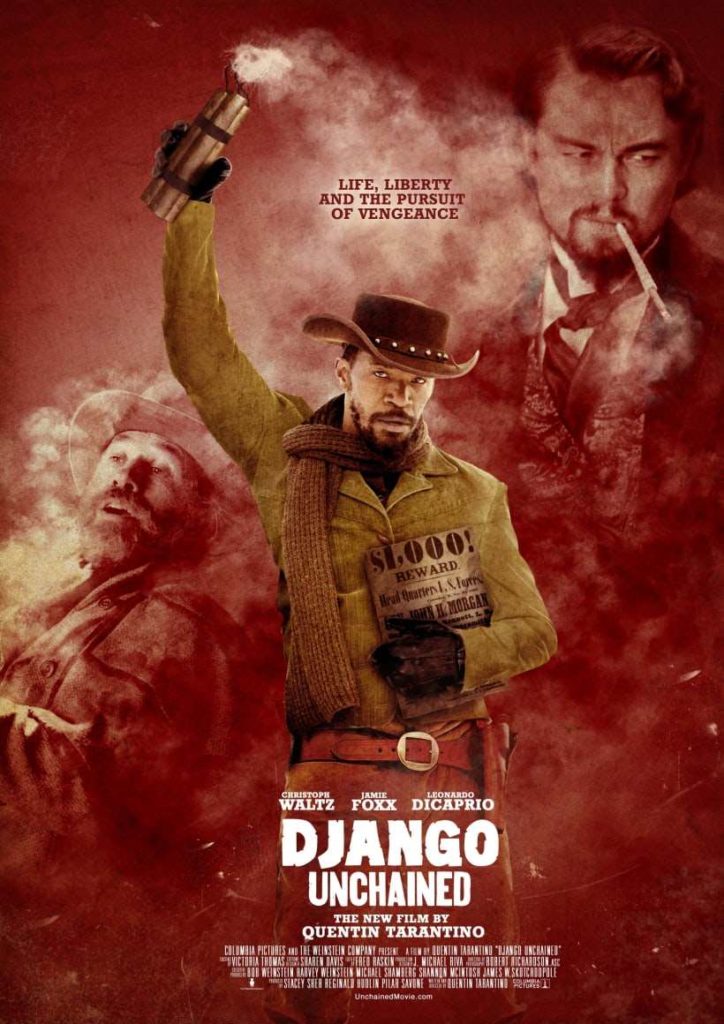


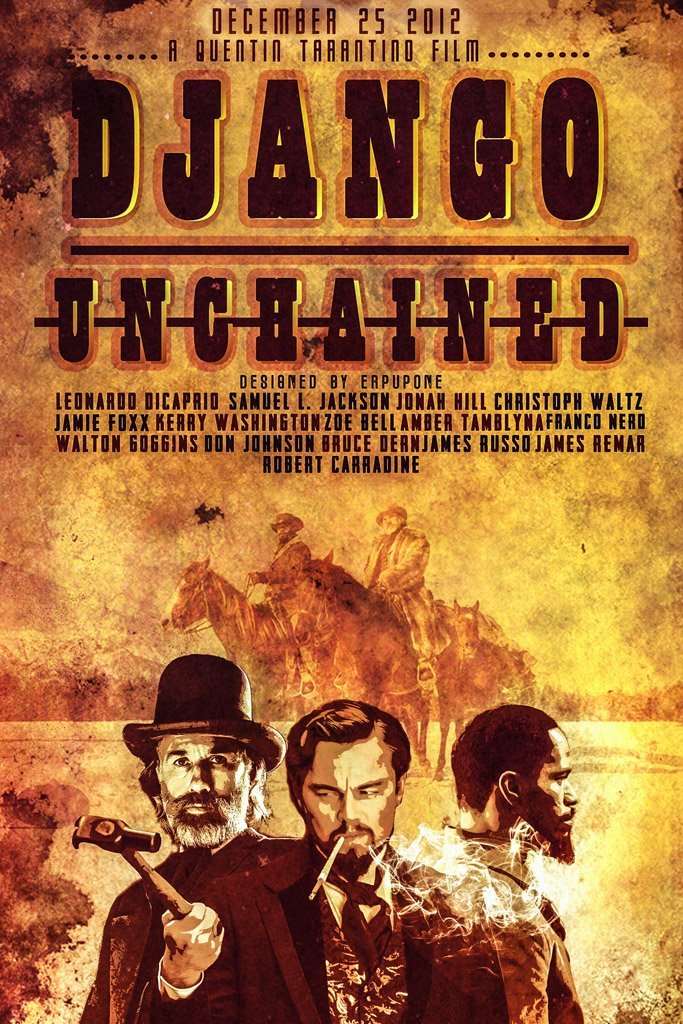


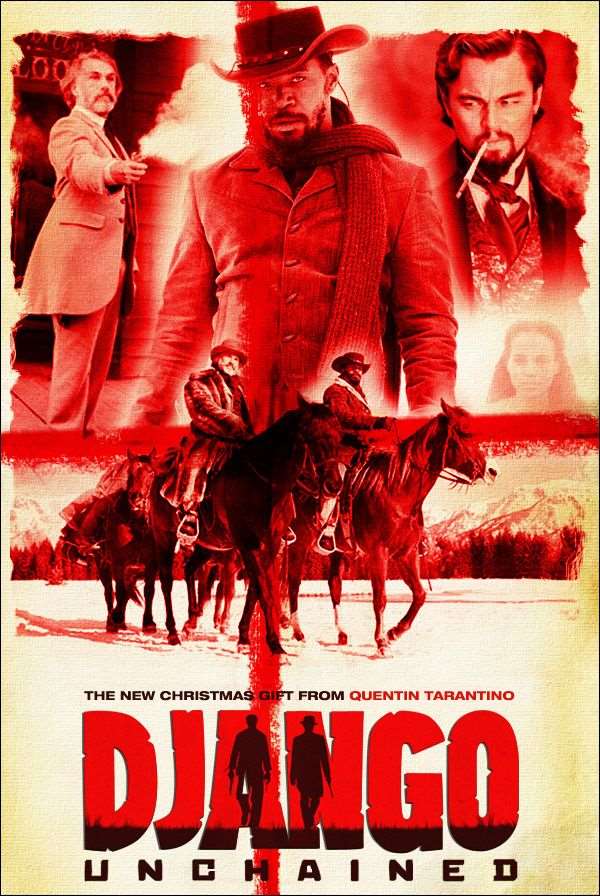
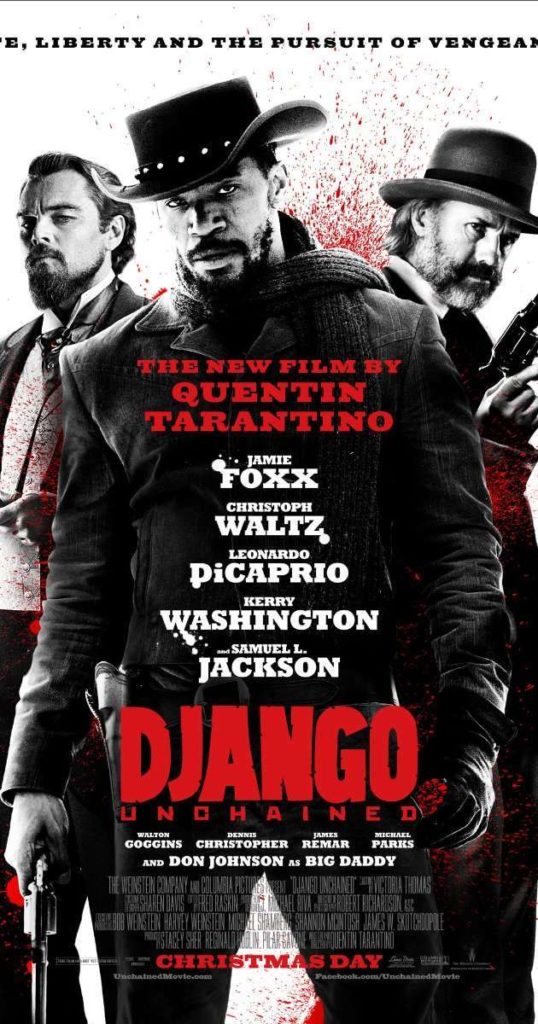

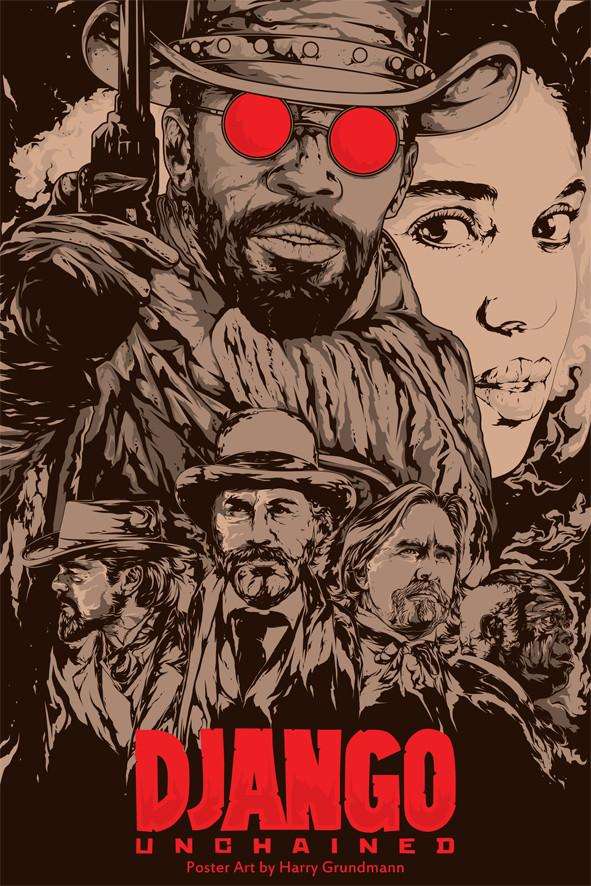

TARANTINO PARLE DE « DJANGO«

Votre film est une variation sur The Legend of Nigger Charley. Vous voulez le réhabiliter ?
Exact, C’est un film très prenant. Ils voulaient faire un grand film, mais ils n’avaient pas d’argent.
Après les nazis dans Inglourious Basterds, les propriétaires d’esclaves dans Django, Quels prochains oppresseurs sur la liste ? Avec ces deux films, il y a une bonne base pour une trilogie. En fait, ma première idée, était de suivre un groupe de soldats noirs qui s’étaient faits avoir par l’armée américaine et qui pétaient un câble…Les Noirs se la jouaient «sentier de la guerre apache» et butaient soldats et officiers blancs avant de tailler la route jusqu’en Suisse. J’ai recadré l’histoire. La majorité du scénario est déjà écrite. Une partie sera connectée à Inglourious Basterds, autour de ces soldats en 1944. Juste après la campagne de Normandie. Je pense que ça s’appellera Killer Crows ou un truc du genre.
Vous êtes un réalisateur blanc qui filme des personnages et des acteurs noirs. Est-ce que cela à provoqué des troubles ou des questionnements d’ordre moral lors de telle ou telle prise de décision dans l’écriture ? Je ne ramène jamais rien à ma propre personne quand j’écris mes scénarios. J’accompagne les personnages là où ils ont envie d’aller. J’ai en quelque sorte mon mot à dire au cours de la première partie de l’histoire, parce que je dois quand même l’organiser un peu, bâtir la trame, mais j’essaie au maximum d’éviter de prévoir quoi que ce soit lorsqu’on en arrive à la deuxième moitié de l’histoire. Parce que je sais qu’à ce moment-là du récit et j’essaie quand même de prévoir un peu les choses avant de les écrire, je sais que quand j’en serai rendu là, j’aurai déjà atteint la moitié du scénario. Et à ce moment-là, tout est différent. Arrivé là, je suis devenu ces personnages. J’ai appris des choses sur eux. Je suis en eux. Ils taillent leur propre route. Il y a évidemment des endroits où j’ai envie qu’ils aillent. Généralement, ils prennent leur temps pour s’y rendre. Et parfois ils y arrivent. Et s’ils ne veulent pas y aller, s’ils veulent tailler une autre route, eh bien c’est un peu comme si ils me disaient que mon idée, c’est de la merde. Alors je les suis. Pour le meilleur ou pour le pire. Ce sont donc les personnages qui dictent leur conduite et qui décident. Certes, tous ces personnages viennent de moi. Mais je ne pense pas mes personnages en tant qu’hommes ou femmes, Noirs ou Blancs. Et quand je m’intéresse à ces questions, c’est uniquement dans le cadre de l’intrigue.





Django Unchained est un peu l’extrême opposé de Naissance d’une nation de Griffith, sorti en 1915, car il véhicule d’énormes préjugés racistes. Est-ce que cela a joué un rôle dans votre esprit ? Je suis obsédé par Naissance d’une nation et son tournage. Ce film a provoqué une renaissance du Ku Klux Klan et la cause de tout le sang versé par la suite jusqu’aux années 1960. Si le révérend Thomas Dixon et D.W. Griffith, avaient été jugés selon les lois du tribunal de Nuremberg, ils auraient été déclarés coupables de crime de guerre pour avoir réalisé ce film et ce qu’il a entraîné. J’ai lu des choses sur le tournage. J’ai lu le livre, qui vient d’être édité, sur le révérend Dixon, qui s’appelle American Racist. C’est un livre très dérangeant. Ce n’est pas la même chose que de tourner Naissance d’une nation pendant un an et de le financer. Vous avez déjà essayé de lire The Clansman ? Honnêtement, il tient très bien son rang à côté de Mein Kampf dans une bibliothèque en termes d’imagerie ignoble. C’est le mal absolu.
Et un moment fondamental de l’histoire du cinéma. Étonnamment, c’est ce qui m’a donné l’idée des personnages du Klan dans Django Unchained. Ils ne font pas encore partie du Klan, le Klan n’existe pas encore, les dirigeants se disputent sur la question des sacs vous le savez peut-être, mais le réalisateur John Ford joue un des membres du Klan dans Naissance d’une nation, et dans ce truc que j’ai écrit, je me mets à spéculer… John Ford a donc enfilé un uniforme du Ku Klux Klan pour D.W. Griffith. Ca veut dire quoi ? Il ne pouvait pas dire qu’il ne connaissait rien de toute cette histoire. Tout le monde savait que le film s’inspirait de The Clansman à l’époque. C’était un best-seller et de nombreuses compagnies théâtrales en donnaient des représentations, tout le temps. Et pourtant, il a enfilé un uniforme du Klan. Il est monté sur ce cheval. Et dans ce film, il participe à la répression contre les Noirs. Et tout à coup, alors que j’écris sur ce passage, j’ai une sorte de révélation parce qu’il faut se souvenir qu’ils chevauchent au grand galop et que je suis sûr que la capuche du Klan doit glisser sur sa tête, et il y peut-être des moments où il ne voit plus rien, et je me dis: waouh, c’est sans doute ce qui s’est passé, il est aveuglé par sa capuche de membre du Klan. Et je me demande comment il est possible que personne n’ai pensé à ça avant. Cinq ans plus tard, j’écris cette scène et tout se met en place. John Ford n’est pas vraiment un de mes héros du western. Pour rester poli, je le déteste. Et je ne parle pas de tous ces Indiens sans visages qu’il tue comme s’ils étaient des zombies. Ce sont des gens comme lui qui maintiennent vivace cette idée d’une humanité anglo-saxonne supérieure au reste de l’humanité. Dans le cinéma des années 1930 à 1950 elle traîne encore.
Spike Lee n’arrête pas de vous critiquer dans les médias pour l’utilisation du mot «nègre» dans le film. Qu’avez-vous à répondre aux réalisateurs noirs qui sont choqués par l’utilisation de ce mot et/ou par les descriptions de l’horreur de l’esclavage ? Si vous voulez faire un film sur l’esclavage et que vous le présentez à un spectateur du XXIe siècle pour le replonger dans cette période de l’histoire, il va entendre et voir des choses affreuses si vous parlez de ce pays avec honnêteté. Je trouve ces critiques ridicules. Je veux que ca soit une énorme pilule à avaler, et que les spectateurs doivent l’avaler sans eau. C’est pourquoi j’évoque Stepin’ Fetchit cet acteur noir, le premier à être crédité dans un générique de film, jouait à l’écran le stéréotype du noir paresseux, pleurnichard et combinard et a été très critiqué pour avoir véhiculé sans vergogne les pires clichés racistes sur les Noirs.
C’est vous qui avez écrit sa tirade ou est-ce un numéro de Sam ? Il improvise à ce moment là ? Il a parsemé le dialogue de certaines de ses petites saillies personnelles. Mais ce personnage était écrit. Sam s’était imaginé en Django mais j’ai décidé de rester sur un Django jeune. Au téléphone avec Samuel L. Jackson je lui dis…«Comme tu vois, j’ai finalement changé mon fusil d’épaule sur le personnage. Tu as quinze ans de trop pour le rôle et tu dirais quoi de jouer Stephen ? Tu veux savoir si ça me poserait un problème de jouer le rôle du pire enculé de noir de toute l’histoire mondiale ? Non, ça me pose aucun problème. Aucun problème mec, je suis déjà dans le personnage. Je suis déjà en train de travailler avec mon maquilleur sur les cheveux, la couleur de la peau. Je veux que ce type ait l’air tiré à quatre épingles.
Pourquoi était-ce si important pour vous de marquer une opposition entre le plus méchant cow-boy noir de l’Ouest, Django, et le plus grand Oncle Tom de l’histoire du cinéma, Stephen ? Pourquoi est-ce qu’une telle opposition binaire est si importante pour votre structure narrative ? En fait, j’avais réfléchi à toute cette idée d’aventure dans le cadre d’un western, et comment tout pourrait s’assembler et ça fonctionne bien à mes yeux, avec l’idée qu’on passe par une sorte de section à la Au cœur des ténèbres, la procession jusqu’à la plantation de Candieland, et puis on arrive à la grande maison des maîtres. Ma vision des choses, au départ, pour cette partie, c’était que le propriétaire était à la tête d’une plantation immense, industrielle. On parle de la quatrième plus grande plantation de coton du Mississippi c’est ça, Candieland. C’est comme être à la tête d’une immense boîte aujourd’hui. C’est une énorme entreprise commerciale et qui rapporte beaucoup d’argent. Et une plantation de ce genre peut facilement faire 60 ou 80 kilomètres de long. Quand vous n’avez pas à verser le moindre centime à ceux qui travaillent vos terres, vous vous retrouvez à la tête d’une sorte de corporation familiale. Il y a donc les esclaves qui vivent sur la plantation et qui appartiennent à son propriétaire. Ils sont sa propriété. Il y a aussi quelques travailleurs blancs qui y vivent avec leurs femmes et leurs enfants. C’est comme une petite ville qui vit sur ce morceau de terre. Et quand la plantation est vaste et que les travailleurs sont nombreux, les propriétaires de la plantation sont littéralement des rois…Et de la même manière qu’un roi a des sujets et qu’il a droit de vie ou de mort sur eux, ils peuvent les tuer en complète impunité quand il s’agit des esclaves et il en va de même pour les travailleurs blancs pauvres, sauf que l’impunité est moins complète. Ils doivent trouver des biais détournés. Mais ils peuvent quand même le faire. Et donc l’idée, en terme presque de conte de fées, c’est que les personnages sont en marche vers le royaume du mal. Broomhilda est la princesse dans la tour. Quand on arrive à Candieland, pour rendre justice à ce sujet complexe, il faut que l’on se frotte aux différentes couches sociales qui cohabitent au sein de la plantation et dans les champs cette différence de statut entre les domestiques qui travaillent dans la demeure des maîtres et les esclaves qui travaillent dans les champs.
Pourquoi avoir décidé de faire de Django un super-héros ? Comment fait-il pour éviter toutes ces balles et s’en sortir sans une égratignure ? Il y a là, clairement, une dimension mythique. Pourquoi était-ce si important de faire en sorte qu’il s’en tire et devienne un super-héros plutôt que de le laisser mourir ?C’est vrai qu’il n’est jamais touché par ces types. Mais d’un autre côté, le film montre bien que ces mecs ne sont pas très adroits. Ils passent leur temps à se tirer dessus les uns les autres. Il y avait pourtant un truc dont je devais m’occuper personne n’en parle, d’ailleurs, alors que c’est pourtant fondamental, c’est que dans les films de Hong-Kong, on voit des types avec des 11,43 automatiques et des uzi qui tirent dans tous les sens. Django, lui, a six coups dans son pistolet, pas un de plus. Et a cette époque, les balles n’ont pas encore d’étui métallique. Chaque cylindre doit donc être préparé: il faut y glisser de la poudre et forcer l’entrée de la balle. C’est pas comme vider son chargeur et remettre des projectiles en un clin d’œil. Il faut préparer les munitions. Et donc, lors de cette grosse fusillade, les deux principales missions de Django sont de tuer des mecs et de leur piquer leurs flingues. Je trouve ça intéressant, parce que d’un côté, je veux raconter une histoire qui tienne la route sur le plan historique, et sur l’esclavage, ses tenants et aboutissants, je me devais d’être réaliste et de raconter ça correctement. Mais pour tout ce qui concerne les aspects plus thématiques et les scènes d’action, je pouvais m’amuser à styliser tout ça parce que ce film s’inspire clairement des western spaghetti. Je peux donc prendre cette histoire d’esclave et lui donner des proportions folkloriques et rajouter des scènes d’actions dignes des films à grand spectacle. Et j’ai décidé de jouer avec ça. Par exemple, quand les méchants tuent des gens, les balles ne font qu’assez peu de dégâts apparents. Elles font de petits trous, tuent ou blessent les gens, mais leurs victimes n’explosent pas. A chaque fois que Django tue quelqu’un, sa victime est coupée en deux. J’ai aussi pris une autre liberté, et là je me moquais carrément que les historiens tiquent ou pas, c’est de reprendre cette idée véhiculée par les western spaghetti que la vie ne vaut rien mais que la mort à un prix élevé la mort a un prix. Les esclaves ne valent rien, à l’achat comme à la vente, mais les récompenses pour les criminels recherchés atteignent des sommes délirantes. C’est juste un gimmick de western spaghetti. La vie ne vaut rien. La vie, c’est de la poussière. La vie ne vaut pas un clou, c’est de la monnaie de singe, de la roupie de sansonnet. Mais la mort, ça rapporte. La mort peut rendre riche. La mort, ça vaut de l’or.



Que répondrez-vous aux éventuelles critiques ? C’est très dérangeant de voir un être humain déchiqueté par des chiens. Comment et quand avez vous décidé des différentes manières de montrer la souffrance des esclaves ? Après Inglourious Basterds, je me suis mis à travailler sur Sergio Corbucci. C’est lui qui a écrit et dirigé le premier Django. Je me suis mis à visionner tous ses western spaghetti et je suis vraiment tombé sous le charme de sa vision de l’Ouest. Parce qu’il me semble que les grands réalisateurs de western ont cela en commun, une vision particulière de l’Ouest. Ce qui ressort du cinéma de Corbucci, c’est qu’il n’existe aucun Ouest américain aussi violent que le sien plus méchant que les méchants de ses histoires. Et ces méchants ont un sens de la dépravation sans limites, et les autres personnages sont sans pitié, la vie ne vaut rien dans ses films, c’est un enfer. La violence est inouïe. C’était un peu comme si à travers ses histoires de cow-boys, il parlait d’un fascisme ce qui n’est pas totalement aberrant, après tout, l’Italie venait juste d’échapper à la botte de Mussolini regonflé par une iconographie de cow-boys et de Mexicains. Quand ses cow-boys s’emparent d’une ville, ça ressemble à une occupation par les nazis, avec des souffrances infligées aux victimes dignes de l’Holocauste. Je voulais que ce film conserve en lui quelque chose d’un divertissement, que ce soit une aventure palpitante. Il y a quelque chose comme ça dans le film. Plus vous vous enfoncez dans le Mississippi, plus vous êtes dedans. Et il faut que vous sentiez vraiment la douleur. Pour moi, la scène de Mandingo et la scène avec les chiens illustrent ça très bien. Il y avait une autre scène dans le script, qui était un peu ma scène à la Liste de Schindler, qui se déroulait à Candieland…Les combattants qu’ils ont achetés sont alignés et Billy Crash en tue quelques-uns pour donner de l’allant aux autres. Candie avait même une réplique «Vous savez, on ne garde généralement que trois des cinq combattants qu’on achète, et ils doivent vraiment avoir de la chance.» Cette scène ressemblait vraiment à une scène d’un film sur l’Holocauste. Finalement, je m’en suis passé…La scène du combat et celle des chiens suffisaient.
Pourquoi pensez-vous que nous avons du prendre nos distances avec la douleur comme nous l’avons fait ce qui explique pourquoi votre représentation est si choquante ? Je ne connais pas la réponse à votre question pour la simple et bonne raison que ce n’est pas comme ça que je fonctionne. Je pense que l’Amérique est une des seules nations du globe à ne pas avoir été obligée, et elle aurait pu l’être par le reste du monde, de regarder en face ses crimes. Et ce n’est qu’en les regardant en face que l’on peut arriver à les dépasser. Et ce n’est pas comme dans le cas du génocide arménien que les Turcs réfutent, au contraire des Arméniens. Dans le cas présent, personne ne veut en entendre parler.
L’histoire d’Hollywood déborde de figures christiques noires. Alors, pourquoi avoir choisi de faire de Dr. King Schultz la figure du Christ ? C’est la clef. Quand le script a commencé à circuler, il y a eu pas mal de discussions à son sujet. Est-ce que Schultz est un personnage de sauveur blanc ? Il agite une baguette magique et tout d’un coup, Django est capable de faire ceci, et puis cela, mais parce que Schultz le lui permet. Pour autant, vous savez, je ne pensais pas du tout que ce genre de choses pourrait fonctionner dans mon histoire. Mais le truc, c’est que c’est quand même sacrément intéressant. Je raconte une histoire de Noirs, mais je raconte aussi un western. Et j’utilise les conventions du western pour servir mon histoire.
En fait, c’est une sorte de western postmoderne sur les esclaves. La formule me va. Vous savez, un des bons vieux lieux communs du western, c’est le pistolero expérimenté qui rencontre un jeune blanc-bec qui a une mission à accomplir, et c’est le vieux flingueur expérimenté qui lui apprend le métier: comment dégainer son pistolet, comment tuer à coup sûr. Ça peut-être Kirk Douglas qui forme le jeune William Campbell dans L’Homme qui n’a pas d’étoile, Brian Keith qui forme Steve McQueen dans Nevada Smith ou la plupart des western spaghettis dans lesquels Lee van Cleef à tourné et qui ne sont pas de Sergio Leone c’est un rôle à la Lee van Cleef. Aujourd’hui, il y a les films de kung-fu. C’est encore la même histoire: celle du vieux qui forme le jeune et qui l’envoie ensuite accomplir sa vengeance.
Est-ce qu’il y a des scènes qui ont été coupées au montage parce que trop crues ou trop déprimantes pour apparaître dans le film ? Si tel est le cas, est-ce qu’on les verra un jour et quelles sont-elles ? Rien n’était trop cru. Mais il y a eu des versions du film, qui ont mené à la version en salles, où la scène du combat à mort des esclaves et la scène des chiens étaient encore pires…encore plus violentes. Je peux en supporter bien plus que la plupart des gens. Je peux supporter plus facilement la vue de viscères que le commun des mortels. A mes yeux, ça ne posait pas de problème. Oui, mais voilà, vous faites votre film et à un certain point, quand vous l’avez vu et revu seul, c’est bien de le voir en présence du public. Et ce film doit fonctionner tous mes films doivent fonctionner de cette manière, mais celui là encore plus que les autres et j’ai donc dû travailler à différents niveaux. Les scènes de comédie doivent fonctionner, les scènes d’horreur doivent fonctionner, je dois arriver à vous faire rire et puis vous ramener à cette scène atroce. Il faut choisir le bon angle dans l’histoire pour que la grosse scène de suspense de la salle à manger produise les effets escomptés. Je vais parler un peu de manière cryptique, mais vous savez de quoi je parle et je ne pense pas gâcher le suspens: ça ne me dérange pas que les spectateurs sachent que Django triomphe à la fin. Il y a un moment ou Django se tourne vers Broomhilda et il lui fait une sorte de petit sourire crispé. Si j’ai bien fait mon travail, en modulant tous les effets du film de la bonne manière, alors les spectateurs devraient applaudir à tout rompre. Ils vont applaudir avec Broomhilda. Ils vont rire avec Django quand son cheval fait cette petite danse. S’ils le font, ça voudra dire que j’ai réussi et que les spectateurs réagissent exactement comme je voulais qu’ils réagissent.

06/ SABRE AU CLAIR…
Film ou Compil ? Auteur ou DJ ? par Jean-Baptiste Morain

Kill Bill Vol.1 est un film de QT…BD, humour, intertitres quasi godardiens, distorsion des clichés, jonglage avec les codes plus télévisuels que cinématographiques et les noms, les accents des personnages. Dans Pulp Fiction, Butch (Bruce Willis), porte son choix sur un sabre japonais pour aller sauver Marsellus Wallace qui se montrait magnanime…Le fameux code de l’honneur. Kill Bill semble marquer une régression par rapport à Jackie Brown, son film le plus mûr et le plus classique. Comme s’il tournait enfin son premier film après les trois premiers, un premier film comme en tournaient les cinéastes dans les années 20…Populaire, d’aventures, romanesque, sans prétention.

Kill Bill Vol.1 est un film. Acteurs fantastiques-Costumes excentriques-Décors-Accessoires colorés et combats sans fin avec du sadisme, des viols, du sang qui gicle. Le tout teinté d’humour. Kill Bill est une histoire de vengeance, dont tous les arts du spectacle populaires sont friands. Impossible d’être dépaysé, on sait de quoi il retourne avec une impression de revoir des vieux schémas. Difficile de ne pas être charmé, avec l’effet de surprise, une lutte éperdue contre l’ennui, une magistrale chorégraphie des corps, la sensualité des peaux. Toutes les bonnes recettes spectaculaires y passent et réussissent leur effet…On se racontera les meilleures scènes entre copains.

Kill Bill Vol.1 n’est pas un film de Quentin Tarantino. Il a tout volé à d’autres…cinéma de sabre japonais et chinois, films de mafia, westerns spaghettis. Molière recommandait de ne jamais copier et de toujours voler et le fit abondamment…Woody Allen, en vieux scénariste, dans son dernier opus, conseille à son jeune disciple de ne voler qu’aux meilleurs auteurs. L’histoire de l’art et du cinéma est une histoire de vol, mais certains sont plus voleurs que d’autres, et les plus forts d’entre eux parviennent à faire oublier ceux qu’ils ont volés. Leur talent est l’unique garant de leur impunité. Tarantino fait de la série A en pillant sans vergogne les séries B… à Z ce qui peut agacer leurs fans. En fait, en pillant tout ce qu’il y a de plus spectaculaire dans le cinéma, l’image qu’on se fait du cinéma, avec son univers artificiel, ses clichés.

Kill Bill Vol.1 n’est pas un film. C’est une compil de cinéma, de musique. Comme si le cinéphage Tarantino nous régurgitait les milliers de films qu’il a absorbés pendant des années. C’est du remix, du remâché, l’annihilation du concept d’auteur de film (où est le responsable ?), un faux proverbe chinois qui se mord la queue et ne signifie rien, du type…Quand la pierre tombe sur l’œuf, l’œuf se brise. Quand l’œuf tombe sur la pierre, l’œuf se brise. Quoi qu’il arrive, l’héroïne mènera sa vengeance jusqu’à son but, triomphera de toutes les épreuves avant d’affronter la dernière, dénouement qui donnera son sens à l’œuvre.

Kill Bill Vol.1 n’est pas. Pas de sens, vacuité, vanité, le film laisse le spectateur béant, béat, bé. Kill Bill raconte l’épuisement, l’exaspération d’un cinéaste, et peut-être du cinéma, le constat de son impuissance à se renouveler, une sorte de gâtisme, de marche en avant ou arrière insensée. Et ce constat, cet aveu constituent peut-être ce qu’il y a de plus déchirant et fait de Kill Bill dans son genre, un chef-d’œuvre blanc comme la neige de pacotille où luttent à mort Uma Thurman et Lucy Liu.
Kill Bill Volume 1 est. Le premier épisode de Kill Bill, le diptyque. Belle tautologie. Peut-être ne peut-on apprécier le Volume 1 qu’à l’aune du second. Une œuvre qui malgré sa claustration cinéphilique reste ouverte. Par conséquent, à suivre…au printemps, et avec impatience !
Il a failli tuer Uma Thurman…En 2018, dans un entretien au New York Times, Uma Thurman, l’une des muses de Quentin Tarantino, revenait sur le comportement du réalisateur sur le tournage de « Kill Bill » et révélait un secret…Elle avait refusé de conduire une vieille voiture à forte allure sur une route de terre et demandé à une cascadeuse de prendre sa place, ce qui n’avait pas plu à Tarantino…« Quentin est venu dans ma caravane. Il était furieux parce que je leur faisais perdre du temps mais j’avais peur. Il m’a dit ‘Je te promets que la voiture fonctionne parfaitement' ». Au final, le réalisateur convainc son actrice à prendre le volant. Quelques minutes plus tard, elle perd le contrôle de la voiture et percute un arbre. Un accident qui aurait pu être très grave…« Le volant était enfoncé contre mon ventre et mes jambes coincées en dessous de moi. J’avais terriblement mal et je me suis dit ‘Mon Dieu, je ne marcherai plus jamais' ». Après un passage à l’hôpital, Uma Thurman retrouve Quentin Tarantino…« Je l’ai accusé d’avoir essayé de me tuer ». Après ces révélations, Quentin Tarantino a émis sa peine et ses regrets…« Plus que l’un des plus regrets de ma carrière, c’est l’un des plus grands regrets de ma vie ». Un épisode qui a jeté un froid sur la relation entre les deux personnes pendant plusieurs années.






KILL IS LOVE…Tarantino prend le spectateur à rebrousse-poil, fait tomber les masques et conclut à haut niveau. Après avoir décapité, découpé, massacré dans le volume 1, la Mariée poursuit sa quête vengeresse. Il lui reste à régler le sort de Budd et de Elle Driver avant d’atteindre la dernière ligne de sa Death list five…
TUER BILL ! Mais avant cela, quelques questions restent en suspens…Kill Bill vol.2 est surprenant…c’est le mot qui convient…surprenant comme le fut Kill Bill vol.1 aux yeux des aficionados de Tarantino qui ne se sont pas encore remis de cette première partie en forme de spectacle jouissif totalement décomplexé. Cette fois-ci, Tarantino surprend ceux qui attendaient de sa part une deuxième partie dans le prolongement, car c’est tout l’inverse qu’il nous propose en prenant le spectateur à rebrousse-poil. La scène de combat principal de chaque volume illustre à merveille le fossé qui sépare les deux épisodes. Le premier est fantaisiste, spatial, irréel comme le combat titanesque qui oppose la Mariée aux Crazy 88’s dans l’immense décor de la House of Blues, le second est brutal, claustrophobe et bien plus ancré dans la réalité à l’image de l’affrontement chaotique entre la Mariée et Elle Driver dans le décor étriqué d’un mobile-home !



La réalité reprend ses droits, les masques tombent, les super-héros deviennent des êtres de chair et de sang…l’exutoire de la vengeance laisse place à la douleur et à la tragédie. Logiquement, le film se recentre sur les personnages afin de développer les tenants et aboutissants suggérés. Le film est donc beaucoup plus posé et là où le premier Kill Bill s’apparentait à un immense hommage au film martial asiatique, le second est une déclaration d’amour envoyée au western italien des deux Sergio…Leone et Corbucci. Tarantino, en livrant un récit plus terre à terre, n’abandonne pas pour autant les expérimentations légions dans le vol.1, du black out claustrophobe particulièrement éprouvant inspiré du Frayeurs de Lucio Fulci avec un Michael Madsen tout aussi sadique que dans Reservoir dogs, au changement de format de l’image afin de mieux souligner le propos d’une scène, le film déborde d’idées, même si, pour le coup, Tarantino reprend son habitude de livrer des dialogues à rallonge, parfois pour le meilleur, parfois pour rien…




ACTIONS !








07/ Une Héroïne noire ! par Serge Kaganski

Trois ans après le carton de Pulp Fiction, Tarantino construit un film virtuose où palpite son amour de la culture black. Avec un casting hors pair, le style approche ici la “perfiction”. Nous sommes en 1994 Pulp Fiction décroche la Palme d’or…Tarantino devient une star mondiale. Son auteur croule sous les tournées promo mondiales, les millions de demandes d’interviews, les projets parallèles ou ponctuels. Comment survivre à un tel monstre ? Je n’ai jamais douté de mes capacités à pouvoir enchaîner. Par contre, je savais que prendre mon temps ne serait pas une mauvaise chose. Les médias avaient atteint ce point de non-retour où ils ne pouvaient plus que me détester pour cause d’indigestion. Mais ils s’étaient rendus malades tout seuls, je ne les ai pas forcés à écrire ces tonnes d’articles sur moi !
Rusé, il n’envisage pas d’exploiter le filon Pulp Fiction. Il veut changer d’échelle et de genre, pour une histoire plus modeste et travailler les personnages. Il choisit d’adapter Punch Creole, roman noir d’Elmore Leonard, un écrivain qui maîtrise les intrigues policières tout en ayant un goût prononcé pour la flânerie narrative, les personnages fouillés, les dialogues savoureux, le sens des lieux et des décors, dans un mélange d’humour, de violence et de cool. Peut-être parce que ses personnages principaux ont déjà de l’âge, un certain vécu, Jackie Brown ira beaucoup moins vite que Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, sera moins chargé en action et en adrénaline, plus prodigue en temps faibles et respirations amples…Pendant l’écriture, j’étais heureux où j’étais, fasciné par ces personnages, je ne pensais pas encore au rythme général du film. Il dure deux heures trente. La première heure est consacrée aux personnages, il ne se passe rien en terme d’action. Mettons que le film soit une voiture, les personnages sont au volant et sur la banquette arrière. Au début, le spectateur est assis à l’avant, il fait connaissance avec les personnages. De ce point de vue, mon modèle est Rio Bravo. Comme chez Hawks, on se lie avec les personnages en allant dans les bars avec eux, on boit des coups, on fume un pétard, on regarde la télé…Puis au bout d’une heure, l’intrigue passe devant et prend le volant du film. Et elle est d’autant plus forte qu’on connaît bien les protagonistes dans toutes les nuances de leurs personnalités.
Jackie Brown contraste non seulement avec les précédents films de Tarantino mais s’inscrit à rebours de toute l’évolution du cinéma hollywoodien, porté sur le rythme trépidant, les temps forts, les morceaux de bravoure et les effets spéciaux. Au milieu de tous les popcorn movies destinés prioritairement aux ados, ce nouveau Tarantino s’adresse plutôt aux adultes, à des spectateurs qui ont déjà une petite expérience du cinéma et de la vie. Le film est carrossé par son tempo tranquille, son montage long, ses plans-séquences, mais aussi son souci de réalisme quotidien. Jackie Brown peut ainsi être vu comme un documentaire sur la South Bay, cette vaste banlieue sud et lower middle class de Los Angeles où a grandi Tarantino. Le film abonde en scènes merveilleusement prosaïques, prélevées dans la banalité du quotidien, comme celle où Max, le prêteur sur gages, débarque pour la première fois chez Jackie et fait plus ample connaissance avec elle devant une tasse de café, avec une chanson des Delfonics en sourdine…C’est un des moments que je préfère. Ils prennent le temps de se découvrir. Cette scène résume un aspect important du film…Le réalisme, le vécu. L’appartement de Jackie est un véritable appartement de Hawthorne, avec un loyer authentique correspondant aux moyens financiers du personnage ; l’appart de Mélanie à Hermosa Beach est aussi un véritable appartement de plage, avec tous les problèmes d’exiguïté et de lumière que ça posait. Le bureau de Max est un vrai bureau de prêteur sur gages existant depuis seize ans. Ces décors ne ressemblent pas à un plateau de cinéma, ils ont l’air vrais et ils le sont !




Le réalisme du film, ce sont également les rapports entre Noirs et Blancs, vaste sujet américain qui obsède le cinéaste, petit Blanc qui a grandi au contact de voisins noirs et de la culture black. Ce n’est pas pour rien que l’un des changements majeurs entre le livre et le film consiste à transformer le héros du bouquin en une femme noire. Jackie Brown est truffé d’argot noir, du mot “nigger” utilisé dans un contexte antiraciste, de soul music et, bien sûr, de relations entre personnages blancs et noirs. Cela va de l’amitié (entre Samuel L. Jackson et Robert De Niro) à la relation amoureuse (entre Pam Grier et Robert Foster), en passant par le désir sexuel “exotique” (entre Samuel L. Jackson et Bridget Fonda). Tarantino est intarissable sur ces questions, mais dans le contexte tout frais à l’époque du procès O. J. Simpson, il regrette ce qu’il perçoit comme une régression dans les relations interraciales américaines…Il y a une tendance au séparatisme sexuel et amoureux, les Noirs doivent coucher entre eux, etc. C’est comme si on avait fait tous ces efforts pour finalement retourner en arrière. Dans les années 70, les relations interraciales représentaient un sommet de l’ouverture d’esprit et du progrès humain. C’est de cette culture que je viens. L’usage récurrent du mot “nigger” choque certains lobbys et personnalités publiques. Dans la bouche des Noirs américains, ce mot n’a aucune connotation raciste, C’est un compliment, ça veut dire ‘mon pote’ ou ‘mon frère’. J’aime la danse du langage, j’aime faire swinguer les mots. Un jour, j’ai dit à Sam…Personne ne joue la musique de mes dialogues aussi bien que toi, et il m’a retourné le compliment…Quentin, personne n’écrit d’aussi bonnes musiques que toi ! Si Jackie Brown est un film soul, l’équivalent cinéma des disques Motown ou Stax, Quentin Tarantino est Berry Gordy ou Bobby Womack, alors que Samuel L. Jackson ou Pam Grier seraient ses Marvin Gaye et Aretha Franklin. Comme dans tous les films de Tarantino, le casting est fondamental. En dehors de Jackson, qui devient pour Tarantino l’équivalent de ce que fut De Niro pour Scorsese, on retrouve justement De Niro dans un magnifique contre-emploi de taulard abruti, Bridget Fonda parfaite en surfer girl frivole, ou encore Michael Keaton en gentil flic plus ou moins amoureux de sa proie. On trouve surtout au centre du film deux comédiens chevronnés, mais oubliés, que Quentin est allé rechercher dans les limbes de sa cinémathèque perso et de ses souvenirs d’ado : Pam Grier, bombasse ex-queen de la blaxploitation, et Robert Forster, quinqua au charisme insidieux et discret, disparu des radars depuis certains nanars d’action des eighties style Vigilante, Delta Force ou Maniac Cops 3. Celle qui fut “Foxy Brown” ou “Coffy, la panthère noire de Harlem” raconte son plaisir à travailler avec Tarantino, et c’est beau comme du Daney…Il n’a plus la liberté économique des années 70, il n’a plus le droit à l’erreur, tout doit être prévu. Il cherche à imiter la réalité avec des plans très longs qui nécessitent une longue préparation. Le spectateur a une impression de temps réel grâce à des plans-séquences de neuf minutes de dialogues. Il y a de moi dans Jackie, surtout cette sagesse que l’on acquiert avec les années. Sans cette maturité de femme et d’actrice, je n’aurais sans doute pas pu l’interpréter.

Forster prend ce film comme un miracle tombé du ciel…Ma carrière se résumait à un 1er acte de 5 ans, puis un second de 25 ans en glissade permanente vers le bas ! Et là, Quentin me propulse au-dessus des nuages que je ne pourrai jamais lui rendre la monnaie. Il la lui a quand même rendue par sa performance toute en douceur et subtilité. Le couple Jackie-Max/Pam-Robert fait merveille par sa timidité précautionneuse, sa prudence de chat qui a déjà vécu et reçu des coups, sa séduction à feu doux et son alchimie. Cet amour naissant et compliqué est le vrai moteur du film, certes loin des gerbes d’étincelles produites par Jackson et De Niro, mais tellement plus profond. L’épaisseur romanesque de Jackie Brown est là, dans cette possibilité ténue de relation amoureuse à 40 ou 50 ans, cette promesse anti-fitzgeraldienne de second acte dans une vie américaine, elle aussi à rebours du jeunisme hollywoodien.




Décembre 1997, notre correspondant à L. A., assiste à l’avant-première et fait part de son enthousiasme…Une bombe incendiaire, un doigt enfoncé dans toutes les gerçures, crevasses et troufignons de l’enveloppe sociale de Los Angeles. Les failles tectoniques entre ethnies sont au cœur de ce qui fait de Jackie Brown un film de Tarantino plutôt qu’une histoire d’Elmore Leonard. Il pointe aussi la qualité des acteurs et des personnages, la justesse de leurs sentiments. Tarantino lui-même insiste sur la longueur en bouche de son film…Reservoir Dogs et Pulp Fiction se revoient comme on réécoute un album, on peut les regarder distraitement, en groupe, en buvant des coups…Ce n’est pas la même chose avec Jackie Brown, je crois qu’il faut le (re)voir d’un bout à l’autre en étant complètement dedans, sans distraction extérieure. Dix-huit ans plus tard, Tarantino n’a pas changé d’avis…C’est un film unique dans mon œuvre parce que c’est le seul qui ne se situe pas dans le ‘monde de Tarantino’. Jackie Brown se passe dans la réalité, dans un monde presque plus vrai que la réalité. Je l’aime aussi parce que je suis attaché aux thèmes que ce film développe. Je l’ai fait à 30 ans et quelques, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que je le tourne maintenant, à la cinquantaine. C’est un film de maturité, comme on dit. Je suis très fier d’avoir fait un film sur le vieillissement, la conscience de sa propre mortalité, alors que j’étais encore un jeune homme ! Je suis très fier de son humanité, de son épaisseur. Plus on revoit Jackie Brown, plus on s’y attache, parce qu’on connaît les personnages en profondeur. Et plus on les connaît, plus on aime passer du temps avec eux, comme avec des proches. Voilà ce que nous fait Jackie Brown. Vraiment, j’en suis fan !
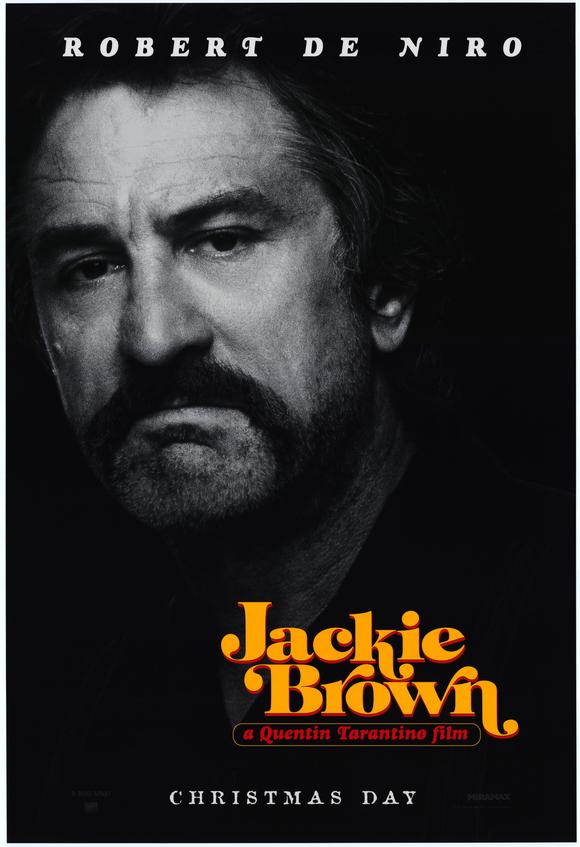
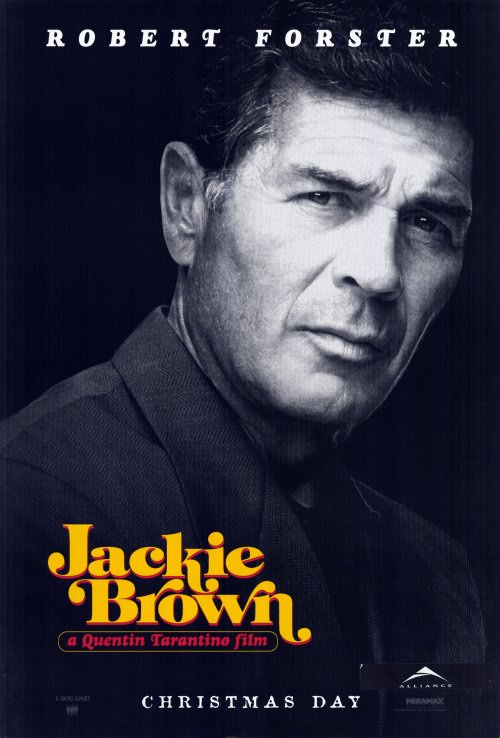

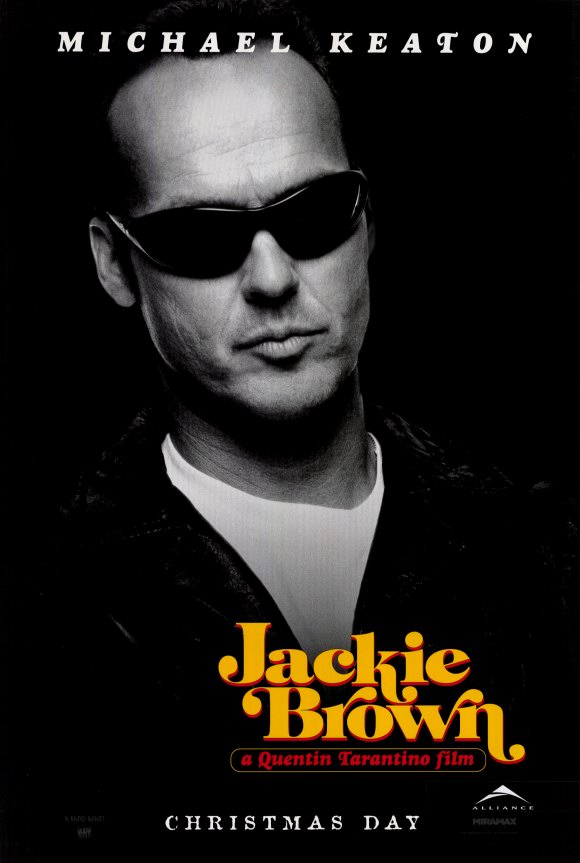
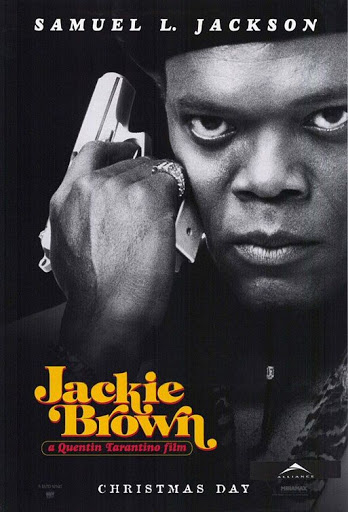

08/ WESTERN VERSION TARANTINO
Dans la filmographie de Tarantino, son huitième film appelle plus que jamais les superlatifs…Le plus abouti, le plus beau, le plus sombre, le plus pessimiste. Mais certainement pas le plus cool. Les Huit Salopards ressemble à un film-somme qui opérerait la synthèse de tout ce que Tarantino a déjà fait, et certains ne vont pas manquer de compiler les motifs récurrents, arguant que tel plan vient de Reservoir Dogs, tel autre d’Inglourious Basterds. De fait, on est en terrain familier, tous les ingrédients qui font la signature de QT sont au rendez-vous…Les dialogues virtuoses, la direction d’acteurs, le mariage idéal de la musique et de l’image. En plus, il a obtenu des moyens à la hauteur de ses ambitions. Il s’est enfin assuré la collaboration d’Ennio Morricone, qui lui a composé une partition à dominante de cordes et à la tonalité beaucoup plus proche du thriller horrifique que du western. Il s’est aussi payé le luxe de tourner en 70mm au format Ultra Panavision, un ratio exceptionnellement large, mais qui assure un tel confort de vision qu’il donne l’impression d’avoir toujours été la norme. Robert Richardson l’utilise magistralement, non seulement en extérieurs pour mettre en valeur de vastes paysages, mais aussi en intérieur pour définir l’espace avec précision et scruter les personnages en gros plans. Mais derrière la surface rutilante, on observe une évolution majeure qui place ce huitième film au-dessus de tout ce que QT a fait jusqu’à présent. Le cinéaste a mûri et il a fortement réfréné certains de ses excès de jeunesse comme l’ironie ricanante, le second degré pour traiter d’un sujet sérieux…Comment survivre en Amérique quand on est noir ou femme. Il a choisi une forme hybride qui remonte au classicisme de Howard Hawks par le biais de John Carpenter, le tout situé dans le contexte de l’après-guerre de Sécession. L’action a lieu en terrain neutre, dans une auberge isolée où huit personnages ont trouvé refuge alors qu’une tempête de neige fait rage. Ils ont toutes les raisons de se méfier les uns des autres, hommes de loi contre possibles hors-la-loi, Blancs contre Noirs, anciens confédérés contre anciens nordistes.




Ce huis presque clos rappelle La chose de John Carpenter. Dans l’un et l’autre film, Kurt Russel sent que quelqu’un n’est pas qui il prétend être, et il entend bien le démasquer. L’enquête prendra des détours complexes et imprévisibles, selon une narration très tarantinienne, qui consiste parfois à répéter les mêmes scènes pour leur donner différentes significations. C’est un peu sa version du Rashomon de Kurosawa. Au fil des discussions, un motif capital se révèle, celui du mensonge, qui surpasse celui de la vengeance et prend une importance particulière dans cette intrigue où tout le monde dissimule son identité ou ses intentions. En virtuose des dialogues, Tarantino a développé une rhétorique de la tromperie comme révélatrice de vérité autant que moyen de parvenir à ses fins. Les acteurs s’en délectent et tous y trouvent l’occasion de briller. La part du lion revient à Samuel L. Jackson, dont les intonations, le phrasé et la rythmique sont devenus des éléments indissociables du cinéma de Tarantino. La musique du langage sert aussi à distinguer chacun des personnages…Kurt Russel parle comme John Wayne, Tim Roth accentue ses anglicismes, et Damien Bechir sa mexicanité. Comme souvent, Tarantino révèle un talent cette fois, c’est le tour de Walton Goggins, qui passe du statut de second rôle pittoresque dont on ne se rappelle jamais le nom à premier rôle qu’on ne pourra plus jamais ignorer. Il parle avec une fausse candeur et un accent du sud qui font des merveilles. Une autre bénéficiaire est Jennifer Jason Leigh, dans un rôle qui semble avoir été écrit comme un hommage à sa carrière passée à prendre des coups, et dont elle s’acquitte avec une sorte de joie mauvaise. On a souvent reproché à Tarantino de s’écouter écrire des dialogues, et ceux-ci occupent une bonne partie de la durée exceptionnellement longue du film. Mais la présentation road show, avec son intro et son entracte aux 2/3 laisse le film défiler à un rythme naturel. Autrement dit, on ne voit pas le temps passer. Les deux premiers tiers servent à faire monter la tension qui se libère à la fin dans une orgie d’action d’une intensité éclaboussante. C’est dans cette dernière partie que le film change de registre et convoque un autre film de Carpenter, Assaut remake de Rio Bravo de Howard Hawks. Chez Carpenter, le bien s’associe au mal pour combattre le pire. Ici aussi, les circonstances obligent les protagonistes à choisir leur camp et à former des alliances inattendues.
Sauf que chez Tarantino, il n’y a aucun personnage positif. Le Bien n’a plus sa place, il n’y a que des nuances de Mal. Le moins odieux des personnages est seulement raciste et misogyne. Il en ressort un tableau particulièrement sombre de l’Amérique, où seul le mensonge permet d’arriver à ses fins, où seul l’argent permet de rendre la « justice » et de faire régner l’ordre, où la vie humaine n’a aucune valeur…Mort ou vif, la récompense est la même, et où la liberté s’arrache par les armes et par la violence. Tarantino a écrit un de ses films les moins cool, dans lequel la violence n’est plus un motif de plaisir mais de réflexion liée à son sujet et à ses retombées, la brutalité envers les Noirs américains est toujours d’actualité aujourd’hui. Et s’il y en a que la sauvagerie graphique du film peut choquer, qu’il leur suffise de se rappeler Henry Fonda massacrant de sang froid une famille entière dans Il était une fois dans l’ouest pour voir que Tarantino n’est pas tellement plus sanglant que Sergio Leone. Il serait flatté d’être placé au même niveau. Et on peut hasarder que Hateful Eight a d’ores et déjà sa place parmi les grands classiques américains.




LA CHEVAUCHÉE BORDÉLIQUE par Adrien Dénouette
Il y a vingt-cinq ans, à l’heure où les deux grands vainqueurs du Nouvel Hollywood accordaient les violons de leur maturité respective avec la virtuosité clinquante et nihiliste des Affranchis de Scorsese, contre la ligne claire du storytelling spielbergien, terreau d’un héroïsme forcené, Quentin Tarantino faisait une OPA sur le cinéma indépendant américain avec un petit film gonflé à l’épate, saignant et fun Reservoir Dogs. Qui aurait cru qu’un quart de siècle plus loin, le rejeton d’un Scorsese plus apolitique que jamais dialoguerait avec Spielberg sur les cendres de Ford et du peuple américain ? Problème, virant la toile de fond purement cinéphilique de son œuvre pour la recouvrir d’un peu de politique, virage qu’Inglourious Basterds et Django n’entamaient qu’indirectement, d’abord occupés à venger l’histoire du cinéma, Tarantino, un peu décontenancé, se retrouve nez à nez avec son propre héritage. Mais si l’autopastiche a tout d’une impasse, on aurait tort de snober son plaisir devant la crudité des Huit Salopards, où esclaves, bourreaux, et tout l’édifice tarantinien s’enfoncent dans les eaux usées de l’histoire américaine. Comme souvent chez Tarantino, mieux vaut prendre le récit par le milieu. C’est ici qu’à la faveur d’un coude narratif, la Minnie’s mercery, théâtre de ce huis clos hivernal planté sur les plaies non cicatrisées d’un Wyoming post-guerre de Sécession (on pense très fort à The Thing, auquel les présences d’un Kurt Russell suspicieux et celle d’Ennio Morricone à son meilleur font un gros clin d’œil, mais surtout au D.W. Griffith de Naissance d’une nation, qui réécrivit aussi le sort de l’Amérique le temps d’un long climax dilaté, auquel Tarantino apporte enfin sa réponse, est présentée comme un parfait petit havre de paix. À ce moment personne n’est dupe, et le spectateur sait déjà, alerté par la fumée qui s’échappe du melting-pot comptant un chasseur de primes noir, deux racistes, un desperado, un chasseur de primes blanc, une renégate, un Européen raffiné et un Mexicain, que cette maison de poupée aux couleurs suaves d’une Amérique réconciliée, n’attend que de se faire pulvériser. À l’image de cette bonbonnière multicolore, rangée bien trop haut sur les étagères de l’utopie, l’idéal démocratique n’est qu’un bibelot sans usage, prêt à voler en éclat à la moindre secousse. C’est ainsi qu’au terme d’une première partie toute en tension sourde, Tarantino place patiemment ses pions pour mieux faire durer le spectacle lancinant d’une nation damnée, purgée de héros qu’elle ne mérite même pas en rêve (ni en fiction). Aujourd’hui que Le Pont des espions précède d’un mois Les Huit Salopards, et alors que Lincoln et Django sortaient à quelques semaines de distance, la concomitance des Spielberg et des Tarantino fait plus que jamais défiler des blocs d’histoire américaine à intervalles réguliers. Mais si Spielberg s’emploie à maintenir coûte que coûte la tête de l’héroïsme démocratique sur les épaules d’une nation en proie à toutes les hypocrisies, celle des lynchages médiatiques, des procès déloyaux et des bricolages de la CIA, dans Le Pont des espions, le second fait carrément du mensonge, de l’imposture et de la paranoïa, les fondements pathologiques d’une société moribonde, incapable de faire coexister ses citoyens sous un même toit.
Jamais Tarantino n’avait atteint une hauteur de vue comparable à celle qui fait des Huit Salopards une œuvre majeure. Recul par lequel, esquissant une représentation totalement déréglée de la société américaine post-esclavage, son huitième film s’élève non seulement au dessus de la chevauchée purement corrective de Django, mais sort pour la première fois du formol de sa cinéphilie. Si bien que les puissances du pastiche, autrefois réveillées pour le seul plaisir d’offrir un beau clin d’œil aux victimes de l’histoire des sous-genres, ont finit par déteindre sur son propre cinéma. Difficile d’imaginer il y a encore deux ans, que Tarantino synthétiserait tout le personnel héroïque de ses films en un peuple d’abrutis. Drôle de tournant auto parodique à quoi s’ouvre une cinématographie dont la séduction tire, depuis Jackie Brown, ses fruits d’un manichéisme jubilatoire. Jusqu’à Django, jusqu’à l’exploitation des Noirs par les Blancs, jusqu’à l’asservissement d’un peuple sans défenses par une caste coupable, la présomption d’héroïsme est encore possible. Après quoi, une fois les Noirs rendus à leur libre arbitre, le tapi d’idéalisme se dérobe sous les lois conjuguées du talion et du sauve qui peut : ainsi du major Marquis Warren, héritier direct du personnage de Django, réduit ici à une figure de vieil affabulateur dont l’étoffe potentielle de héros craque sous les bombements d’une vie de mensonges et de frustrations. Et qu’il se glisse sous les traits du vieux majordome corrompu de l’enfer négrier de Candyland dans Django Samuel L. Jackson, encore étincelant n’a évidemment rien d’anodin…Comment un Noir éduqué par les Blancs à une violence libératoire pourrait-il conserver le visage de l’innocence ? Django, libéré par les outils d’asservissement de son propre peuple, hérite ainsi du visage de la perfidie, payant au prix fort son drôle de pacte faustien avec le pays de l’oncle Sam.
Le mal, qui prenait dans The Thing toutes les formes possibles gros melting-pot métamorphe, à l’image d’une société cannibale refait ainsi surface sous les traits de l’imposteur. Alors que MacReady est persuadé que l’un des pensionnaires de la mercerie n’est pas celui qu’il prétend, le récit bascule au moment de son empoisonnement, renversant subitement les règles du Cluedo. Dès lors, la question n’est plus de savoir sous quel masque se dissimule le monstre comme chez Carpenter, mais qui d’entre tous peut encore être innocent. La réponse, limpide, est donnée dans l’épilogue. Scellée par la pendaison de la renégate, la réconciliation bordélique entre Marquis Warrend et Chris Mannix renégat se fantasmant shérif reflète le visage monstrueux de la fraternité…Qu’un Noir ayant fui le gibet toute sa vie se retrouve à tirer la corde en se bidonnant, épaule contre épaule, avec le plus raciste de tous les salopards en dit long sur le sort que le cinéaste réserve à l’héroïsme. Si bien qu’à la question de savoir lequel, dans ce précipité d’Amérique, peut encore être innocent, Tarantino ne fait pas d’équivoque…Aucun, évidemment…



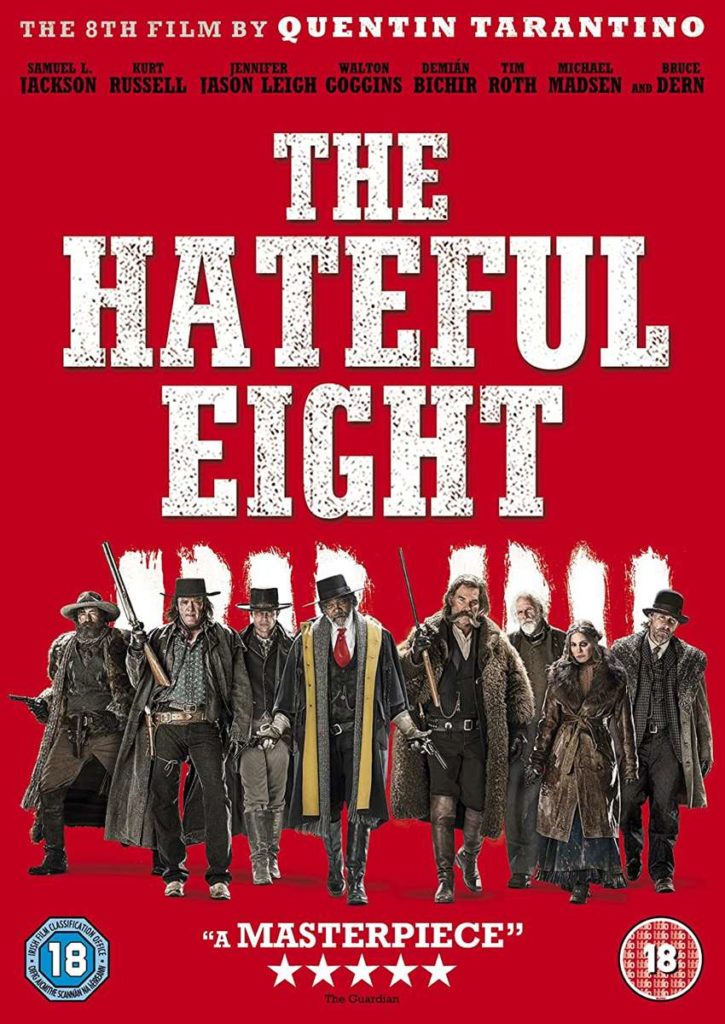




PAROLES DE TARANTINO…




Comment vous sentez-vous avant la sortie de votre dernier film Les Huit salopards ? Ce film occupe une place particulière dans ma filmographie. Je ne dirais pas, en tous cas pas encore, que c’est la meilleure chose que j’ai faite seul le temps pourra le dire. Mais, oui, c’est un film spécial. J’en suis très fier et j’aimerais qu’il cartonne, qu’il devienne un sujet de discussion, qu’il fasse partie très vite de la pop culture. Comme ce fut le cas avec Django. Quand des gens s’inspirent des personnages de vos films pour leurs déguisements d’Halloween, c’est toujours bon signe.
En quoi Les Huit Salopards est-il si spécial pour vous ? C’est mon scénario le plus littéraire. J’étais très enthousiaste de réunir exactement les acteurs qu’il faut pour ce texte, et de répéter pendant quatre semaines avec eux avant de tourner. Il y avait cette idée excitante de tourner dans la neige, de capturer tous ces détails qu’on n’a plus l’habitude de voir aujourd’hui, et qui nous ramènent plutôt aux grands films épiques des années 60. Et enfin, il y avait l’idée de montrer le film en 70mm, d’en faire un événement particulier, un truc rare, une expérience. Ça change de l’amas de pixels morts qu’est une projection numérique. Bref, il y avait l’idée de prendre des risques, de se mettre en danger. Et la raison qui m’a poussé à le faire, c’est ma confiance absolue dans le scénario. Je savais que j’avais un bon matériel de départ, et que par conséquent ça valait le coup de le tirer au maximum.
Vous avez décrit Django comme une « mise en examen de l’Amérique raciste ». Les Huit salopards ne serait-il pas l’acte II de ce procès ? Tout à fait, mais par le prisme de la guerre de Sécession. Je voulais parler de la question raciale, de l’hypocrisie des blancs et des raisons qui ont mené à la guerre, de la destruction pure et simple de la moitié du pays. Et à travers ça je parle évidemment d’aujourd’hui, même si je ne pouvais pas prévoir lorsque j’ai écrit le film que les violences racistes allaient resurgir aussi brutalement dans l’actualité, je dis bien dans l’actualité, parce qu’en réalité elles ont toujours été là, elles étaient simplement tues.
Est-ce que vous avez eu une complète liberté à toutes les étapes du processus ? La seule pression que j’avais, c’est par rapport à la quantité de pellicule. Quand je tourne en 35mm, je n’économise pas la pellicule parce que je sais qu’elle est moins chère que tout le reste, et notamment le temps des artistes qui travaillent sur le film. Avec du 70mm, ce n’est pas le cas, le matériau est rare et cher, et il ne faut pas le gâcher. J’avais une autre pression, le climat, qui imposait le rythme et l’ordre des scènes. J’ai parfois dû attendre deux ou trois semaines pour tourner un contre-champ, pour avoir exactement la même neige. Mais vous voyez, ce sont des pressions artistiques, des pressions que je me suis imposées, donc ce ne sont pas des problèmes.



Pour la sixième fois sur 8 films, Samuel L. Jackson est à nouveau à l’affiche d’un de vos films. Que représente-t-il pour vous ? Samuel est un peu mon tonton ronchon. On a tous un oncle grincheux et irascible qu’on est bien content d’avoir lorsqu’on est à la rue, ou lorsqu’on a un conseil à demander. Eh bien pour moi, c’est Sam. Par moments, ce type me casse les couilles, si vous saviez…Cet enfoiré me chambre tout le temps, il a le pire esprit de contradiction que j’aie jamais vu, mais je l’aime. C’est par ailleurs un énorme bosseur qui connaît toujours son texte sur le bout des doigts et qui a une capacité unique à jouer mes dialogues. Comme il est aussi bon écrivain, il est le seul à qui je donne un vague droit à réécrire un tout petit peu mes dialogues, s’il en a envie. Personne d’autre que lui n’a cette prérogative.
Il y a quelque chose d’autre en jeu que le film lui-même, la possibilité, pour vous ou d’autres réalisateurs, de continuer à faire des films en 70mm, ou du moins en pellicule, en cas de succès. Est-ce le cas ? Je ne pense cependant pas qu’un bide condamnerait à jamais la pellicule, mais un succès pourrait être un encouragement. Si je faisais un film de science-fiction ou un film d’aventure sur Hannibal traversant les Alpes à dos d’éléphant, ça paraîtrait normal de le faire en 70mm. Mais moi je fais un film bizarre. Je fais un western avec des gens qui discutent dans une auberge. Et je veux prouver que ça vaut quand même le coup de le voir en 70mm. Je veux prouver aux spectateurs que ça, ce genre d’expérience, on ne peut pas l’avoir sur Netflix.
Donc vous n’êtes pas inquiet par rapport à la possibilité de tourner vos prochains films en pellicule ? Pour les deux prochains, ça devrait aller. De toute façon, je n’ai pas le choix, je ne tournerai jamais en vidéo, je n’ai pas signé pour ça. Donc je veux en faire encore deux en pellicule, et basta. Ça fera dix films, c’est un bon nombre pour partir à la retraite. Non, en revanche, l’enjeu est sur la projection en pellicule. De moins en moins de salles en sont capables, et c’est un problème.
Parlant de projections, vous avez repris une salle à Los Angeles, le New Beverly, où vous programmez tous les soirs un double-programme. En pellicule évidemment. Quel était votre objectif en acquérant cette salle ? L’objectif est plus que rempli. Je ne pourrais être plus heureux. Les gens de l’industrie étaient sceptiques, j’entendais dire qu’on ne peut pas programmer uniquement des vieux films et faire du profit. Eh bien j’ai prouvé que c’était possible. Cela fait un an qu’on a rouvert avec ce nouveau concept, et le cinéma presque plein tous les soirs. Et le public est jeune. Et fidèle. Beaucoup d’étudiants en cinéma notamment. Je crois avoir vraiment fait un truc pour la communauté cinéphile de Los Angeles. C’est ma ville, ma communauté, et j’ai l’impression de lui rendre un truc qu’elle m’a offert quand j’étais jeune moi-même.
Vous arrive-t-il malgré tout de regarder des films sur un ordinateur ou un iPad ? Je ne peux pas regarder un film sur un iPad, ou même sur un petit écran dans un avion. Le seul truc que j’ai réussi à regarder dans ces conditions, ce sont des épisodes de Studio 60 on the Sunset strip parce que je n’avais pas d’autres moyens de les voir. Je me suis mis un peu tard à Aaron Sorkin, mais j’admire à peu près tout ce qu’il fait. En particulier The Newsroom, la meilleure série actuelle. Je me suis enfilé tous les épisodes de Studio 60…sur iPad en 3 jours. J’ai aimé, mais pour moi c’est comme dévorer un menu 3 étoiles debout dans la rue avec les doigts. J’ai bâfré cette série comme un cochon, sans vraiment en profiter, je l’ai juste ingéré, pas dégusté. C’était un truc de junkie.
Avec l’expérience, est-ce que faire des films devient plus facile ? Non, pas vraiment, parce que ce qui est plus facile se trouve rééquilibré par les nouveaux défis que je me pose. J’en sais beaucoup plus aujourd’hui sur la mise en scène, la technique, la direction d’acteurs, sur la direction de toute l’équipe…Mais, ceci étant dit, dans mes trois films des années 90 Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown je n’ai rien fait qui me semblait infaisable. En gros, une fois que j’avais trouvé mes acteurs, je savais que ça allait bien se passer. À partir des années 2000, en revanche, je n’ai cessé à chaque fois de me poser de nouveaux défis. J’ai fait une pause de six ans, et ça m’a fait prendre conscience qu’il était temps de sortir de la zone de confort. J’ai soudain eu envie d’écrire des films dont je n’avais pas la moindre idée de la façon de les réaliser. Et c’est devenu un moteur au fil du temps. Ça a donné la scène de baston des Crazy 88 dans Kill Bill. La poursuite en voiture dans Boulevard de la mort. L’incendie et la fusillade dans le cinéma à la fin d’Inglorious Basterds. L’assaut du Ku Klux Klan dans Django. Dans Les Huit Salopards, tourner dans le froid et sous la neige et aussi quelques scènes d’action dont je ne peux vous parler ici…Toutes ces scènes nécessitent un apprentissage, et c’est cela que je cherche aujourd’hui.
Boulevard de la mort a été un échec, et vous avez déclaré que c’était, de vos films, celui que vous aimiez le moins. Or c’est à mon avis l’un de vos meilleurs. Je me demande s’il n’y a pas un lien entre la réception de vos films et votre jugement sur ceux-ci… Je sais que, vous, les Français, et en particulier les critiques français, adorez Boulevard de la mort. Écoutez, moi aussi je l’aime bien désormais. J’ai évolué là-dessus. Et je crois que le public américain a lui aussi évolué. C’est mon film le moins vu, mais un culte s’est peu à peu formé autour de lui. Notamment chez le public féminin. Je croise régulièrement des jeunes femmes de 20-22 ans qui me disent adorer ce film et s’y reconnaître. C’est très gratifiant. Plein de trucs sont réussis : la structure est intéressante, les courses sont cool, Kurt Russel est super… Voilà, donc dire que c’est mon pire film ne veut pas dire que c’est un mauvais film, juste que c’est le moins bon. Il en faut bien un.
Et votre film préféré, parmi les vôtres ? Je change d’avis tout le temps…J’ai l’impression qu’Inglorious Basterds est celui qui restera, quand on se posera la question dans 20 ans. Personnellement, j’ai un faible pour Reservoir Dogs car c’est là que tout a commencé. Et quand il s’agit de savoir quel film exprime le mieux « ma » vision, je nomme généralement Kill Bill, les deux réunis. C’est mon film le plus visionnaire. Après ça, je suis devenu plus…littéraire.
Il y a un type de scène que vous répétez dans presque tous vos films…Un personnage avance masqué, avec une fausse identité, et se trahit lui-même à cause d’un détail. C’est l’intrigue de Reservoir Dogs, c’est Michael Fassbender dans l’auberge allemande dans Inglorious Basterds, c’est Jamie Foxx se faisant passer pour le serviteur de Christopher Walz dans Django…D’où ça vient ? Vous avez absolument raison sur la récurrence de ce motif. Avancer masqué, c’est exactement ça. J’ai souvent plaisanté sur le fait que mes personnages étaient tous d’excellents acteurs. Je crois que c’est simplement indicatif de ma personnalité. Surtout lorsque j’étais jeune, je mentais constamment. Je me faisais passer pour celui que je rêvais d’être. Pour draguer des filles. Pour me faire mousser. Pour obtenir un job…Lorsque j’avais 22 ou 23 ans et que je cherchais à devenir acteur, et que mon CV était vide, je m’inventais des rôles dans des films qui n’existaient pas. À l’époque, il existait encore un tas de films d’exploitation qui sortaient dans quelques salles de quartier ou drive-in, et pas forcément à Los Angeles. Donc on pouvait parfaitement passer à côté, et pas d’Internet pour vérifier…C’est ainsi que j’ai inventé des tonnes de faux films et de faux rôles, sur lesquels je pouvais baratiner des heures. J’ai un milliard d’exemples mais je vais vous en donner deux. L’un de ces films s’appelait Brooklyn Br., je disais que ça ressemblait à La taverne de l’enfer de Sylvester Stallone et j’y jouais un certain Dominic DeVito. Et puis il y avait un film de poursuites automobiles intitulé Drag Race No Stop et mon personnage s’appelait Mag Wheeler. Mais les directeurs de casting me croyaient plus, alors j’ai pris Zombie de George Romero, parce que je me suis rendu compte qu’il y avait un type qui me ressemblait vaguement enfin disons qu’on avait à peu près la même coiffure et qu’on aperçoit lors de l’assaut du centre commercial. Et j’ai dit que c’était moi. Pour donner plus de poids à mon mensonge, j’ai inventé des anecdotes de tournage, ou je racontais que le réalisateur de Drag Race ‘No Stop était un pote de Romero et que c’est grâce à lui que j’avais eu ce petit rôle. Ce genre de trucs, vous voyez.
Seulement, pour vous ça s’est bien terminé, tandis que dans vos films, la découverte du pot aux roses se termine toujours en bain de sang…Pour moi ça ne s’est certes jamais terminé en bain de sang, mais voyons les choses en face, je n’ai jamais réussi à séduire personne comme ça non plus, quant à ma carrière d’acteur, on ne peut pas vraiment dire qu’elle ait décollé !
Mais pour en revenir à vos films, la violence agit comme un couperet, comme un brutal retour à la réalité après une agréable affabulation…Dans mes films, la mort attend toujours au tournant. En gros, si tu déconnes, t’es mort. Mais en même temps, vous avez raison de le souligner, il y a un vrai plaisir créatif à mentir. J’ai toujours pensé que si on mentait bien, qu’on y mettait du sien, si on était suffisamment bon pour ne pas se faire prendre, eh bien…Ce n’est plus un mensonge. Juste une autre version de la réalité.
Avec le temps, vous chérissez de plus en plus ces moments de suspension de la vérité, ces discussions interminables, et que vous repoussez toujours plus loin le couperet de la violence. Revenons un peu en arrière. Dans les années 90, quand j’ai fait Jackie Brown, je me souviens qu’un critique avait écrit…Tarantino n’est pas mauvais, mais un truc qu’il ne saura jamais créer, c’est le suspense. Parce que j’aimais trop les petits détails insignifiants. Ce qu’on appelle ici les ‘Shaggy Dog Story’ les histoires absurdement compliquées qui se concluent en eau de boudin. Mais depuis Inglorious Basterds, je prends plaisir à explicitement jouer avec le suspense. Dans Les Huit Salopards, il y a encore cette même idée, plutôt que de créer un bon petit suspense efficace, je vais dans la direction opposée. Je traite la narration comme si elle était un élastique qu’il s’agit de tirer au maximum. Et encore et encore et encore, jusqu’à ce qu’il soit à la limite de casser. Et ma conviction, c’est que si ton suspense est fondé sur un bon principe de départ, alors il n’y a pratiquement pas de limite à la tension de l’élastique. Plus tu le tends, meilleure est ta scène. Et si tu réussis à faire durer un suspense 15 minutes au lieu des 3 réglementaires, crois-moi, tu tiens un truc.
Vous employez la métaphore de l’élastique, mais moi c’est celle du sexe qui me vient à l’esprit quand je vois vos films…Exactement ! Je n’osais pas le dire, mais oui, quand la violence finit par advenir, c’est comme une éjaculation.
D’où vient votre fascination pour les femmes puissantes ? Vous considérez-vous comme féministe ? Je ne sais pas si je me considère comme féministe dans la vraie vie. Néanmoins il existe une certaine émancipation féminine dans ma filmographie. Si on veut en chercher les raisons psychologiques, il n’est pas difficile de deviner que le fait d’avoir été élevé par une mère célibataire a eu un impact. Ma mère est une personne formidable, qui a su tracer sa propre voie et m’offrir une belle enfance. Elle m’a inculqué un modèle où les femmes ne sont pas des citoyens de seconde zone qui restent à la maison pour faire la cuisine à leur mari. Et puis les personnages forts sont les seuls qui m’intéressent vraiment, vous savez. Qu’ils soient féminins ou masculins.
Longtemps, vous avez montré vos films à Cannes. Depuis Django, ils sont prêts à la fin de l’année, pour la saison des Oscars. Est-ce une volonté de votre part ou de vos producteurs ? Et si oui, qu’indique-t-elle ? Si on était en avril, qu’au lieu de vous parler j’étais assis dans ma salle de montage, et que j’étais à une semaine de terminer mon film, je l’amènerais sans doute à Thierry Frémaux dans l’espoir qu’il le sélectionne. Mais ce n’est pas le cas. Je dois dire cependant, pour être tout à fait honnête, que le dernier festival de Cannes m’a laissé un goût amer. Ce n’est pas du tout la responsabilité du festival, qui m’a toujours soutenu, qui a projeté le film Inglorious Basterds dans des conditions idéales ; et j’étais excité comme une puce à l’idée de montrer mon film là bas, à la projection de presse de 8h30. Mais, comment dire, le fait de voir tous ces gens littéralement courir en dehors du Palais pour être les premiers à publier leur critique bâclée. Ou ces gens qui tweetent pendant la séance. Ça me déprime un peu en fait. Ça casse la magie. Je n’avais pas le souvenir d’une telle fièvre auparavant. Les gens semblaient prendre davantage le temps de digérer les films. Il y avait plus de gentillesse. Bref ça m’a laissé un mauvais goût. Et puis tout ce bazar journalistique…Bon, je fais cette interview parce que c’est pour la France, mais je n’ai aucune envie de m’asseoir en face d’un journaliste américain. Il m’en coûte trop à chaque fois. Je dis un truc hors des clous et c’est récupéré partout. C’est comme quand j’ai dit que le film Selma méritait un Emmy plutôt qu’un Oscar, et derrière on me traite de tous les noms. Je n’avais pas vu le film donc j’ai dû clarifier ce que j’avais dit, mais même si je l’avais détesté, qu’est-ce que ça peut foutre ?
Vous êtes l’un des artistes contemporains dont les propos sont les plus commentés. Chance ou bien Malédiction ? Mes interviews n’ont pas changé, c’est l’époque qui a changé. Je vous le dis franchement, si vous n’étiez pas français, je ne ferais pas cette interview. À chaque fois que je m’exprime ici aux États-Unis, il y a 444 articles sur Internet pour commenter ce que j’ai dit, ou ce qu’on croit que j’ai dit…C’est lassant.




09/ A BOUT DE SOUFFLE…




SOUVENIRS, SOUVENIRS… par Matthieu Santelli
Sorti sous une forme de « deux en un » le dernier film de Quentin Tarantino se voit amputé du film avec lequel il était couplé et rallongé d’une demi-heure pour sa sortie internationale. Peut-être est-ce dû à l’échec commercial de ce film binôme outre-Atlantique, le premier de la carrière du réalisateur de Pulp Fiction à cause de son concept un peu trop radical ? En tout cas, en allant jusqu’au bout de sa démarche, Tarantino réalise ce qui est peut-être son film le plus sincère et le moins snob. Aujourd’hui, le cinéma hollywoodien est de plus en plus un défi illustratif. Raconter des histoires similaires, répondre à des poncifs établis, filmer avec le même souci anthropocentrique: seul l’aspect, ce à quoi ressemblera le héros, le vilain et/ou le décor, fera la différence. Depuis quelque temps, ce souci esthétisant s’est vu gratifié d’une mode rétro, où une imagerie « à l’ancienne » se déploie comme l’atout majeur. Capitaine Sky et le monde de demain de Kevin Conran, 2004, The Good German de Steven Soderbergh, 2007 ou même Le Dahlia noir de Brian De Palma, 2006, sont autant d’exemples de films faits « à la façon de ». Assurément, le dernier projet commun de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, Grindhouse, s’inscrit dans cette veine. Il s’agit cette fois de reproduire le visuel et l’esprit des séries Z des années 70, de la simplicité des histoires à la multitude de défauts techniques inhérents à ce genre de productions pauvres mais en y mettant beaucoup de moyens. Déjà, avec son précédent film, Kill Bill, Tarantino avait tenté de réunir un brassage de toutes les formes de la série B des années 1970. Jusqu’à maintenant, cette mode nostalgique a produit des films dont la réalisation obéissait au cahier des charges d’une esthétique prédéfinie dans le cadrage, la lumière et le jeu des comédiens mais du coup assez impersonnelle, où le cynisme du cinéma actuel tourne en dérision ce qui est perçu comme la naïveté des vieux films. Derrière l’hommage, on décrypte aussi une pointe de mépris.
Chez Tarantino, il n’y a pas ce problème. Dans Boulevard de la mort, l’utilisation minutieuse des codes de la série Z, des faux raccords aux coupures abruptes de la musique, du ménagement des (rares) effets à la structure simpliste du scénario, démontre une connaissance absolue de ce cinéma. Et pour l’avoir étudié aussi assidûment, il faut l’aimer passionnément. Tarantino est un cinéaste cinéphage. Il a un rapport fétichiste à l’image alors que le cinéaste cinéphile, comme De Palma, aurait plutôt un rapport obsessionnel à elle. Là où il excelle, c’est dans le recopiage scrupuleux de cette image. Là où il existe, en tant que cinéaste, c’est dans le respect infini qu’il lui témoigne. C’est à la fois la qualité de son cinéma, mais aussi sa limite…Le cinéphage est un jouisseur stérile. Dans Kill Bill, la volonté de calquer une image s’accouplait mal avec la volonté de la mélanger à une autre. Le cinéphage duplique une image mais ne sait pas lui donner un autre sens que celui qu’elle avait initialement alors que le cinéphile ne cesse de lui trouver un sens nouveau, c’est pour ça qu’il est généralement plus intéressant. D’où ce sentiment de « compilation » devant Kill Bill, l’impression que les scènes se succédaient sans qu’aucun des effets empruntés n’influait vraiment l’un sur l’autre. Un psychopathe, macho, beauf et impuissant, avec une cicatrice en guise de castration par un extraordinaire Kurt Russell qui s’amuse à tuer des jeunes filles grâce à sa voiture « à l’épreuve de la mort » Death proof en anglais. Seulement, un jour, il va tomber sur des filles plus tenaces, bien décidées à ne pas se laisser faire. Voilà pour l’histoire. Comme il se doit dans les films d’exploitation, elle n’est qu’un prétexte. Prétexte à filmer des courses-poursuites et des cascades en voitures, prétexte à filmer du sang, prétexte à filmer des filles avec Tarantino qui filme les pieds de ses actrices comme Russ Meyer grande référence du cinéma Z qui filmait la poitrine de ses égéries avec une fascination hypnotique et surtout prétexte à filmer des dialogues. Mais on ne trouve de prétexte que là où l’on cherche à se procurer du plaisir. Tarantino met le doigt sur l’essence même du cinéma d’exploitation: une jouissance instantanée, assumée et masturbatoire. C’est peut-être pour ça que le film fut moyennement accueilli à Cannes, parce qu’il met le spectateur dont la critique à nu face à son plaisir, sans la fioriture du scénario et le chichi de la mise en scène comme « couvertures » ou alibis.




Boulevard de la mort semble être le fantasme assouvi du cinéma de Tarantino…Le désir de reproduction pur et simple. Occupé à imiter les stigmates des films d’exploitation, le cinéaste laisse de côté les sophistications qui plombaient ses précédents films bien qu’il y cède parfois, notamment lors d’une scène de repas dans un restaurant, filmée en plan-séquence de dix minutes, virtuose, mais pénible. Son cinéma nous apparaît plus limpidement lors de scènes simples comme celle, très touchante, où une des jeunes femmes échange des SMS sur son téléphone mobile avec son petit ami. Mis en scène avec la mièvrerie caractéristique du cinéma fauché des années 1970, c’est-à-dire maladroitement mais aussi avec conviction, ce passage est un anachronisme. Et cet anachronisme évoque la nostalgie de Tarantino, celle d’un cinéma qui, malgré tous les efforts mis en œuvre, ne sera plus tout à fait comme avant.
Lorsque Tarantino prend conscience
il est un Cinéaste stimulant.
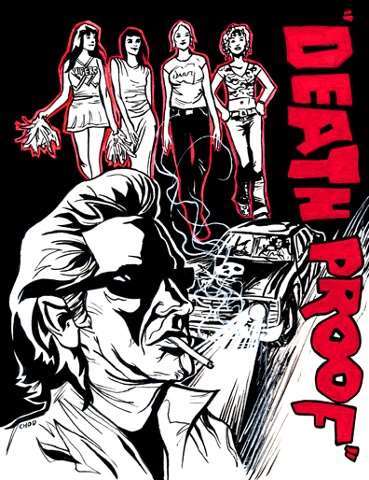
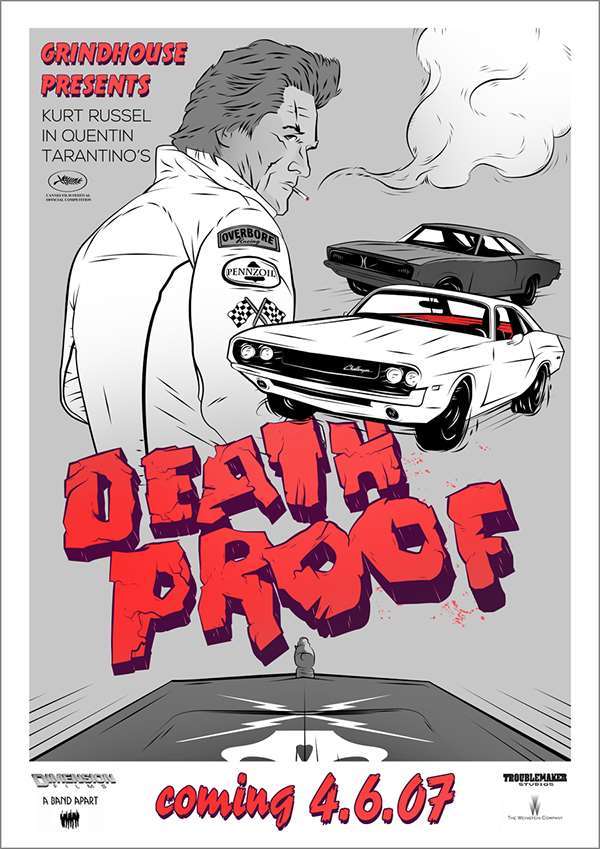



L’HOMME
QUI AIMAIT LES FEMMES ?
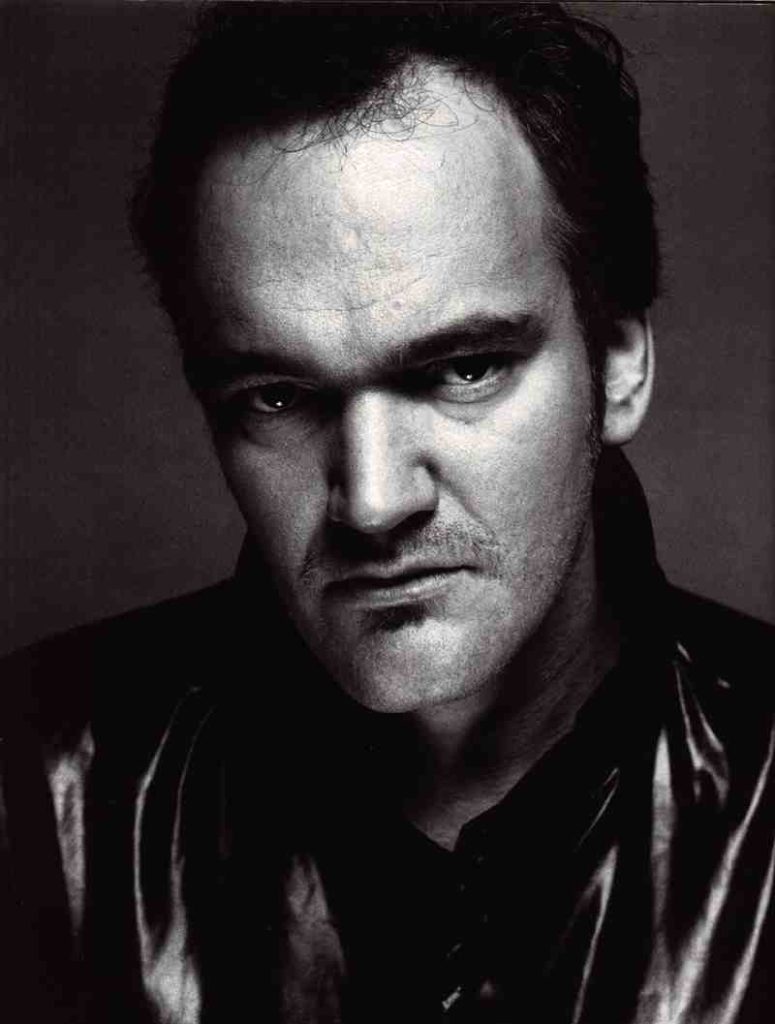
En 1992, pour son film noir Reservoir Dogs, fidèle au machisme fanfaron il évacue la question féminine. On est entre hommes ! Reservoir Dogs est un film de combat, à coups de mots, de flingues. Passons sur la symbolique pénétrante des multiples armes à feu qui posent le point final des joutes verbales, pour revenir sur celles-ci, et plus particulièrement la toute première séquence, le rendez-vous au diner où la conversation se tisse autour du pourboire de la serveuse et de la signification réelle de Like a Virgin de Madonna qui lui dédicacera plus tard un album avec le message…À Quentin. Ça parle d’amour, pas de bites. Les personnages de Tarantino passent le temps en parlant sexe, autour de l’interprétation de la chanson, puis passent à un discours plein de commisération autour de la pauvre condition des serveuses de diner, paroles, paroles, paroles…Sans la moindre apparition féminine…A la sortie, les Dogs sont filmés au ralenti, magnifiés par la mise en scène comme par leurs costumes, par leurs attitudes si cool, on vient de rentrer dans le film à proprement parler, fini les femmes. Tarantino sacrifiait-il aux codes du film noir, ou était-il simplement misogyne ? La question restait posée…

Tout Pulp Fiction apparaît comme une tentative passablement machiste pour dépeindre la femme comme bien pire que l’homme comme plus violente, plus perfide. L’humour clin d’œil de Tarantino dans son film ressemble à s’y méprendre à une histoire racontée en présence uniquement virile…Finalement, les pauvres hommes peuvent faire les malins avec des armes démesurées, il suffira d’un regard d’une femme pour les réduire à néant. La mise en scène des rapports hommes-femmes fonctionne ainsi comme un affrontement la rencontre entre Mia Wallace et Vincent Vega au Jack Rabbit’s Slim ayant même toutes les apparences d’un duel, jusque dans la fameuse scène de danse. Avec son esthétique cartoonesque et son ultraviolence, Pulp Fiction, comme les magazines à bon marché dont il s’inspire, se prête à le représentation des plus bas instincts d’un point de vue qui se révèle très masculin. Lorsqu’il s’agit de dépeindre la femme, elle le sera toujours avec peur et incompréhension. Lorsqu’il s’agit de dépeindre l’homme, par contre, il conviendra toujours de se rassurer sur sa puissance, bien sûr avec force armes à feu et meurtres divers mais également via le personnage de Butch, le boxeur on en peut plus viril.
Quelle importance revêt réellement la montre de son père pour Butch ? Celle-ci a été conservée, des années durant, par son père et un autre soldat, dans leur anus pour échapper aux fouilles des ennemis dont ils étaient prisonniers. Le legs de ces deux hommes au jeune Butch n’est pas tant l’objet lui-même que la terrible humiliation qu’il a fallu subir pour le ramener. Non seulement il s’est agi de subir une pénétration, mais encore une sodomie le soupçon de l’homosexualité, pour ces hommes qu’on devine facilement fiers de leur mâle virilité, la honte est terrible. Et lorsque Butch se retrouve à devoir risquer sa peau pour retrouver ce legs ô combien important par la faute d’une femme, il se retrouve, évidemment, à la merci de deux violeurs suintants. Forcément, lorsqu’il s’agira de se venger de ces deux-là, Butch choisira une arme…pour sa taille dans son monde mâle à outrance, on gagne quand on a la plus grosse. Tarantino, indéniablement capable de jouer avec les codes, s’amuse t-il des codes machos du Pulp ou va-t-il dans leur sens ? Il y a fort à parier que l’insuccès relatif et l’impopularité de son film suivant, Jackie Brown, présenté d’un point de vue bien plus féminin, vienne donner un indice à la fois du tempérament de joueur du réalisateur et de l’attachement d’une grande partie de son public masculin à ces codes du cinéma viril…

Dialogues virils et grosses pétoires, en 1992, Reservoir Dogs posait l’univers de Quentin Tarantino comme fleurant bon la testostérone. Des années plus tard, les Kill Bill et Boulevard de la mort imposent le réalisateur non seulement comme capable de subvertir les codes du film mâle au profit d’une relecture féminine, mais encore comme un véritable féministe. Au fil de son œuvre encore passablement limitée, le rapport de Tarantino à ses personnages féminins, souvent centraux, a certes évolué, presque chronologiquement semble-t-il. Mais est-ce bien le cas ? Dans les colonnes du Figaro, en 1993, Quentin Tarantino, adoubé par le public et la critique nouveau Wonder Boy du cinéma américain avec Reservoir Dogs, revenait sur sa propre perception du cinéma…Dans un film, il y a une logique, qu’elle soit émotionnelle, esthétique ou narrative. Si vous faites un film de guerre, il n’y aura pas de femmes. Si on vous impose des femmes, il faut refuser. Tarantino en 2009 donne un rôle central à Mélanie Laurent et Diane Kruger dans Inglourious Basterds. Une place centrale de personnage sacrifié, cependant. Tarantino consacré grand défenseur de la femme pour les valkyries de Kill Bill et de Boulevard de la mort, aurait-il retourné sa veste ? Ou cette posture n’est-elle avant tout qu’un fantasme savamment entretenu ?
Deux ans plus tard, Tarantino livre le film de sa consécration, Pulp Fiction, avec en figure de proue une Uma Thurman vénéneuse, entre Betty Page et Anna Karina. Est-ce pour autant que le film est celui de Mia Wallace, la sensuelle épouse de Marcellus Wallace ? Indéniablement, les femmes deviennent dans le second film de Tarantino une force motrice des actions des hommes, Mia Wallace mène Vincent Vega (Travolta) par le bout du nez, Fabienne (Maria de Medeiros) semble être la seule personne pour laquelle Butch laisse son tempérament bagarreur de côté, quitte à se mettre réellement en danger pour cela et Yolanda «Honey Bunny» (Amanda Plummer) semble indéniablement dominer le couple (de braqueurs) qu’elle forme avec Ringo «Pumpkin» (Tim Roth). Mais plus encore que les femmes elles-mêmes, c’est avant tout la peur des femmes qui provoquent les actions des hommes. Jody (Rosanna Arquette) met mal à l’aise Vincent Vega, pourtant un tueur accompli, par un simple «c’est un truc sexuel» pour expliquer son piercing sur la langue, Yolanda est à la fois crainte par Ringo et par Jules Winnifield (Samuel L. Jackson) comme celle qui peut tout faire dégénérer lors de l’attaque du restaurant. Mia existe dans le film bien avant son arrivée à l’écran par l’inquiétude qu’elle suscite chez ces messieurs, une crainte qui demeure une fois que Vincent et elle sont en présence pour finir sur la légendaire Bonnie, épouse de Jimmy (Tarantino), qui provoque l’intervention de Winston Wolf (Harvey Keitel) pour faire disparaître une voiture encombrée du cadavre de Marvin une Bonnie qu’on ne verra jamais, ce qui n’empêchera pas sa présence de se faire sentir…

1997…Cinq ans après les émeutes de Los Angeles, Tarantino lance avec Jackie Brown son plus beau pavé dans la mare avec une résurrection en règle de la blaxploitation, avec un nombre de «nigger» («nègre») impressionnant dans les dialogues, suffisamment pour que le moralisateur Spike Lee dénonce le film comme «pas cool». Les fans sont pour une bonne part déstabilisés par le nouveau film du réalisateur, un scénario de polar blaxploitation pur, à la réalisation moins tape-à-l’œil, sans les digressions coutumières à Tarantino et avec au centre de l’intrigue, une femme. Et pas n’importe quelle femme, icône de la blaxploitation, le premier « genre » cinématographique à parler des Noirs avec des Noirs à l’écran dans les rôles centraux, Pamela Grier est une figure sulfureuse. Sensuelle en diable, elle est, du propre aveu de Tarantino, l’un de ses fantasmes adolescents à tel point que Pam Grier s’étant présentée pour le rôle tenu par Rosanna Arquette dans Pulp Fiction, le réalisateur lui a refusé parce qu’il n’était pas digne d’elle, l’actrice gagne sa popularité dans des films comme Foxy Brown ou Coffy, la panthère noire de Harlem une popularité qui, dans les années 1970, est déjà en soi une provocation pour le public noir américain auquel s’adresse le genre. Personnage public aux antipodes des codes machistes dudit public, Pam Grier est vue, avec Aretha Franklin ou Toni Morrison, comme une figure majeure de l’émancipation de la femme noire.
Rien n’est innocent sur les choix de Tarantino pour Jackie Brown d’une part, il fustige le discours cauteleux et malaisé des années post-émeutes en livrant un film cinématographiquement et musicalement voulu comme un hommage à la culture noire américaine des années 1970, certainement pas une culture du compromis, d’autre part, il ramène à l’écran l’icône provocatrice de ces années là, une actrice dont la carrière même est un exemple féministe. Nous sommes loin, avec Jackie Brown, des circonvolutions thématiques de ses précédents films…En abordant de façon frontale son polar avec Pam Grier en vedette, Tarantino place cette fois de plein droit la femme au centre de son cinéma. Il s’agit, certainement, pour le réalisateur, de poursuivre dans la provocation avec ce qui apparaît comme son portrait de femme le plus intense…Visuellement, la séquence qui débute le film place immédiatement Pam Grier, un quadragénaire arrondie par l’âge, au centre du regard d’une caméra gourmande, sensuelle, qui la filme sous tous les angles, comme pour mieux, à la fois, en faire le centre de l’intrigue, et aimer l’image de cette femme. Lorsque Jackie se plaint à Max Cherry (Robert Forster), son prêteur de caution, du fait que l’âge ait accentué ses formes, celui-ci, un homme de près de 60 ans, lui réplique «il n’y a rien de mal à ça». Non seulement la femme a le droit d’être le centre de l’écran, d’être le centre de l’intrigue, capable de duper tout le monde, mais elle a le droit de vieillir, de ne pas rester prisonnière d’une image parfaite voulue par une société fondamentalement phallocrate. Et, de même, un homme d’un certain âge peut tenir un discours sexuellement actif, sous-entendre qu’il pourrait aller au-delà des mots…Est-ce Tarantino qui parle par la voix de Max Cherry ? Peut-être bien. Lors de la superbe scène finale du film, Max, qui a aidé Jackie à parvenir à ses fins, se voit offrir de l’accompagner en Espagne et, en filigrane, partout ailleurs mais il refuse. «Je vous fais peur ?», lui demande-t-elle. Et lui de répondre par l’affirmative Tarantino avouerait-il ici, avec tendresse et sagesse, ce qu’il a dit via les fanfaronnades de Pulp Fiction, qu’il aime et craint les femmes à la fois ? Qu’en est-il des autres femmes du film ? On peut distinguer trois groupes…Les femmes soumises, les hommes au contrôle, et l’électron libre, Jackie…Tout au long du film, la violence apparaît comme le moyen de contrôle du mâle sur les femmes.

Seule se distingue Jackie. Si elle ose saisir l’opportunité de se dresser contre tout ceux qui tente de l’oppresser, ce n’est pas avec l’arrogance surpuissante d’Ordell ou de Nicolette, Jackie a ses doutes, ses peurs, et le courage de leur faire face et de vivre avec eux. La chanson thématique du film, le superbe morceau Across 110th Street de Bobby Womack, commence sur ces paroles...«J’étais le troisième fils parmi cinq enfants / J’ai fait ce que j’ai dû pour survivre / Je ne dis pas que ce que j’ai fait était juste / Essayer de se sortir du ghetto était un combat de chaque jour» si c’est la chanson qui accompagne le début du film, c’est également celle que susurre Jackie dans sa voiture, alors que l’arnaque qu’elle projette est en cours, ce qu’elle fait n’est pas juste, ni glorieux, ni droit, mais il s’agit de faire ce qu’elle peut si elle veut s’en sortir. Contrairement au reste des personnages de sa filmographie, Tarantino ne filme pas Jackie Brown comme une caricature. Elle n’est ni une icône de perfection des canons de la mode, ni jeune, ni pure dans ses intentions ou dans ses moyens.
Il s’agit, purement et simplement, du personnage le plus humain de la filmographie de Tarantino. Une humanité qui transparaît dans l’un des plus beaux plans du film, et probablement de la filmographie du réalisateur, lorsque Jackie, au moment suprême de lancer l’arnaque, se regarde dans le miroir de la cabine d’essayage. Et Tarantino de filmer ce personnage ambigu, complexe, hérité à la fois du roman d’Elmore Leonard et de sa capacité d’analyse de ses propres obsessions, avec une sensibilité et une finesse qui lui fera défaut dans ses films postérieurs. Jackie ni besoin d’un sabre, ni d’une voiture pour se sentir l’égal d’un homme, une figure féminine et féministe, éclipsée cependant par les plus lisibles et grandiloquentes figures de femmes à venir.
Kill Bill-2003-2004 à Boulevard de la mort-2007. Vers une hégémonie féminine totale ? « Je me souviens que, à la sortie de Reservoir Dogs, nous nous sommes dit que si nous avions remplacé nos “dogs” par des filles, le film aurait déclenché une énorme polémique. J’aurai adoré ça. Kill Bill, c’est un peu mon Reservoir Bitches ! »
Quentin TARANTINO – 2004.

Dans ce rôle physique et éprouvant, Uma Thurman incarne une féminité toute-puissante, alimentée par un désir de vengeance, que seul l’abattage méthodique de ses ennemis saura apaiser. L’ouverture de Kill Bill Volume 1 reprise dans le second volet annonce avec un pouvoir de synthèse rare les enjeux du film. Après quelques cartons rétro indiquant le début du programme, l’écran est laissé noir. Le souffle haletant d’une femme occupe tout l’espace. Les mots suivants apparaissent alors sur la toile aveugle « Revenge is a dish best served cold ». Le carton laisse place à un gros plan en noir et blanc. Il s’agit du visage d’une femme couverte de sang et de sueur, portant un voile de mariée. Court insert sur les pieds d’un homme. Le gros plan souligne alors la peur mêlée à la douleur sur le visage de la femme. La voix de l’homme emplit l’étau visuel du plan serré. Sa main fait intrusion dans le champ pour venir caresser le visage maculé de sang de la mariée à l’aide d’un mouchoir. Sur le carré de tissu, un nom…Bill. Le spectateur identifie l’homme à abattre (Kill Bill=Tuer Bill). Cette présence masculine envoûtante demeure elliptique, comme elle le sera tout au long de ce premier volet, où Bill n’est que fragments de masculin avec une voix profonde, des mains fortes. Tentant de reprendre son souffle, la femme parvient à prononcer une seule phrase « Bill, it’s your baby ». Sur la dernière syllabe, l’homme lui décoche une balle dans la tempe gauche.
L’écran devient noir à nouveau et le générique défile sur la voix féminine de la chanson « Bang bang ». Dans cet incipit aussi court qu’efficace, la femme n’est définie que dans son rapport à l’homme, elle est « l’épouse de » et « la mère de l’enfant de ». Clouée au sol, privée de sa mobilité, elle est présentée comme le jouet d’une force masculine suprême. Mais la présence du nom « Bill » dans le cadre de l’image constitue un indice programmatique de la vengeance future de cette femme agonisante, présentée comme une proie sans défense, égérie de toutes les femmes victimes de violences. On octroie communément à la femme une duplicité étrangère au comportement masculin. Personnage majeur de l’univers tarantinien, la Mariée ne dément pas cette dimension versatile. Désignée par des noms multiples, quand son identité n’est pas masquée par un bip sonore, elle n’est jamais ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même, la Mariée (le jour de ses noces sanglantes), Arlene (fiancée de Tommy Plympton), Jane Doe (inconnue dans le coma), Black Mamba (membre du détachement international des vipères assassines), Beatrix Kiddo (sa véritable identité). Loin d’être le recyclage d’un lieu commun machiste sur la psychologie féminine, la multiplicité de Beatrix Kiddo témoignerait davantage de l’adaptabilité d’un personnage tenace et vif, capable de se relever du combat le plus athlétique et sanglant pour attaquer le suivant avec une fraîcheur et une énergie désarmantes. Le diptyque Kill Bill marque un tournant dans l’emprise des femmes sur la diégèse tarantinienne. Le cinéaste écrit pour la première fois un récit filmique guidé par la trajectoire d’un seul personnage et choisit une figure féminine comme seul vecteur du regard du spectateur. Beatrix Kiddo est l’unique moteur de cette narration éclatée, dont elle influence l’organisation par sa parole directrice. Sa voix lance les flashs-backs permettant de découvrir des bribes de son passé ou de celui de ses cibles. À El Paso, au Texas, Beatrix Kiddo, sous le nom d’Arlene, comptait épouser un certain Tommy pour offrir une vie calme et sûre à l’enfant qu’elle portait. Mais, sur l’ordre de Bill, le gang des Vipères Assassines (Vernita Green, O-Ren Ishii, Budd et Elle Driver) massacre toutes les personnes présentes à la répétition du mariage. Beatrix échappe miraculeusement à la mort, mais passe quatre ans dans le coma. À son réveil, l’ex-femme enceinte découvre avec douleur son ventre vide, avant d’apprendre qu’elle a été régulièrement violée par un infirmier qui arrondit ses fins de mois en prostituant les patientes léthargiques. C’est de la bouche de cet ultime bourreau qu’elle apprend sa stérilité. De cette féminité mutilée, humiliée et souillée, surgit un être vengeur dont l’énergie surhumaine dégage une virilité certaine, servie par l’androgynie d’une Uma Thurman d’1m83. La force du personnage féminin est proportionnelle aux épreuves auxquels il est confronté. Incapable de faire usage de ses jambes après quatre années d’immobilité, Beatrix parvient tout de même à tuer l’infirmier-proxénète et son client avec une sauvagerie jubilatoire pour les spectateurs des deux sexes. La femme vengeresse va ensuite se charger de signes ostentatoires de virilité tout au long de sa quête des responsables du massacre d’El Paso. Elle se déplace au volant du « Pussy Wagon », le truck volé à l’infirmier, puis sur une moto vrombissante, et enfin avec une voiture décapotable digne d’un film noir genre misogyne par excellence. Pour se confronter à O-Ren Ishii (Lucy Liu), elle apparaît dans une combinaison de cuir jaune et noir, réplique de celle de Bruce Lee dans son dernier film inachevé, The Game of Death. La femme laissée pour morte endosse la tenue d’un défunt pour sonner le glas de sa renaissance. Le parcours de Beatrix est en effet celui d’une renaissance permanente, phénomène ironique pour celle qui n’a pu donner naissance. Elle renaît en s’éveillant de son coma, en parvenant à faire bouger ses jambes amorphes après treize heures d’effort et de concentration, en réussissant à s’extraire du cercueil où Budd l’a enterré vivante, en renouant enfin avec la maternité.

O-Ren Ishii…La représentation tarantinienne de la femme d’action du film de sabre asiatique, maniant le sabre avec dextérité et pratiquant les arts martiaux avec un sens certain de la voltige. Le personnage s’inspire aussi des héroïnes du cinéma japonais ultra violent de réalisateurs comme Kenji Fukasaku ou Takashi Miike. O-Ren Ishii apparaît d’abord enfant, dans une longue séquence de manga animé racontant l’origine de sa vocation de tueuse professionnelle. Après avoir assisté au meurtre sanglant de ses deux parents à l’âge de neuf ans, O-Ren Ishii venge cette perte traumatique en transperçant mortellement le corps de l’assassin deux ans plus tard. Dans cette scène d’exécution, la symbolique sexuelle est explicite : la pénétration du corps par l’arme blanche est doublée d’une expression de plénitude proche de la jouissance sur le visage de la jeune tueuse chevauchant sa victime. De ce drame originel, naît une tueuse froide et méthodique, régnant à 25 ans sur l’organisation (très masculine) du crime tokyoïte. Incarnation fantasmatique de la peur masculine de castration, la femme guerrière revendique le contrôle de son propre corps et prend le pouvoir sur le corps masculin par l’usage d’une violence extatique.
Sous les traits séduisants de Lucy Liu, O-Ren Ishii apparaît comme une poupée délicate dans son costume traditionnel d’un blanc immaculé. L’effet contrapuntiste entre l’apparence du personnage et sa capacité à exercer une violence froide et autoritaire joue sur la présupposée fragilité du sexe « faible ». Face à la longiligne Américaine, la guerrière traditionnelle trépasse dans une grande dignité, fidèle à l’honneur des samouraïs : « Pour t’avoir ridiculisée tout à l’heure, je te présente mes excuses », murmure-t-elle dans son ultime souffle.

Vernita Green…Une maison verte avec un frontispice couvert de jouets d’enfants. Mais les secrets derrière cette porte…L’afro-américaine Jeannie Bell est l’épouse du Dr Bell et la mère d’une petite Nikki, âgée de quatre ans. Mais, sous la tenue sportswear de la femme au foyer, se cache l’ex-vipère assassine, Vernita Green. Face à la survivante du massacre d’El Paso, l’intérieur coquet de sa maison bourgeoise est mis à sac en moins d’une minute. Le décor est optimisé à la faveur du combat, les objets de décoration deviennent des armes, les meubles sont brisés, les corps sont propulsés dans l’espace sous la violence de mouvements musclés.
Première confrontation féminine, fantasme absolu du mâle hétérosexuel, est interrompue par l’arrivée d’un car scolaire devant la maison. La suprématie de l’identité maternelle de la femme prend le dessus sur l’urgence du duel. Les armes sont masquées à l’entrée de Nikki, dont la vue ramène Beatrix à l’origine de son désir de vengeance. Une fois l’enfant dans sa chambre, en parfaite maîtresse de maison, Jeannie/Vernita propose un café à celle qu’elle souhaitait éventrer quelques seconds plus tôt. Si la confrontation physique est remise à plus tard pour une plus grande discrétion, le duel se poursuit sur le plan verbal dans une discussion froide, parsemée de « fucking » et de « bitch ». Vernita, retirée des affaires, supplie pour sa vie au nom de son statut de mère, comme Beatrix l’a fait cinq ans plus tôt le jour où elle a découvert sa grossesse pendant une mission. Dans Kill Bill, la maternité semble non seulement constituer le terreau de l’identité féminine, mais elle tend aussi à représenter une forme d’institution suprême, une valeur inaliénable. Jeannie/Vernita incarne le destin raté de Beatrix, mais elle vit dans un intérieur propre et coloré, trop beau pour être vrai, au point que la caméra en plongée totale dévoile l’artificialité de pièces sans plafond. Dans ce décor de studio, la douce Jeannie s’apparente donc à une forme de chimère, que Beatrix ne tarde pas à balayer avec violence. Dans la cuisine, lieu saint de la ménagère, la mère au foyer domine d’abord son adversaire, mais n’échappe pas à la colère vengeresse de la mère mutilée.
Face à un personnage féminin aussi fort physiquement et mentalement, peut-on considérer Kill Bill comme un film féministe ? Quentin Tarantino le revendique, mais la réalité du discours porté par le film demande de tempérer l’usage de cette étiquette. La Mariée n’a que faire que sa cérémonie de mariage ait été empêchée ou que son futur époux ait trépassé. Elle réclame avant tout vengeance pour avoir été privée de son enfant et de toute nouvelle possibilité d’enfanter. Dans l’univers de Kill Bill, l’identité féminine est donc totalement tributaire de la maternité. Arrachée à son enfant, Beatrix ne peut plus être qu’une machine à tuer à la virilité érectile, le sabre toujours prêt à pénétrer compulsivement ses adversaires. La femme stérile n’est plus que l’instrument de sa propre désespérance. Beatrix Kiddo ne parvient à parler réellement, donc à retrouver une épaisseur réelle en tant que personnage, qu’à partir du moment où elle se retrouve avec sa fille en tête-à-tête et apprend les gestes maternels du quotidien. L’enfantement de la parole conduit alors à la dilatation temporelle de l’ultime chapitre du volume 2, dont la lenteur fait contrepoint avec les scènes de combat précédentes. Beatrix est enfin capable de discuter avec Bill, de justifier ses choix passés, de formuler ses craintes et ses douleurs. Elle lui explique comment la découverte de sa grossesse avait bouleversé la perception de sa propre existence et la valeur accordée à son intégrité physique. Bien plus que l’homme, elle serait esclave de ses bouleversements hormonaux, qui la conduiraient à remettre en question son système de valeurs et sa propre identité.

Beatrix Kiddo…Pur personnage de film d’action, incarnation d’une féminité libérée de toute entrave masculine. Si elle détonne dans le paysage cinématographique occidental, elle est inspirée de la femme guerrière du cinéma d’action asiatique, où elle constitue une figure archétypale. Dans Kill Bill, la femme est virilisée par la violence sanglante des combats, mais elle est aussi sublimée par leur qualité chorégraphique qui lui offre une maîtrise totale et virtuose de l’espace. Cette domination spatiale est particulièrement visible dans la longue scène précédant la confrontation directe entre Beatrix et O-Ren Ishii. Dans un night-club possédant des salons privés à l’étage, Beatrix affronte d’abord le gang des Crazy 88 sur la piste de danse du niveau inférieur, utilisant le mobilier pour rebondir et virevolter d’un adversaire à l’autre dans des cascades mêlant l’influence du film de kung-fu, du film de sabre et des envolées à la John Woo. Elle passe à l’étage d’une salle à l’autre, comme pour mieux piéger ses adversaires vers une mort certaine. Elle finit victorieuse, debout sur la rambarde de la mezzanine, filmée en contre-plongée au-dessus d’un parterre de corps agonisants.
Malgré la violence des coups reçus au fil des scènes, Beatrix se lance dans chaque combat comme s’il s’agissait du premier, avec une force renouvelée. À la fin du volume 2, Bill la compare d’ailleurs à Superman, dans le seul monologue tarantinesque du diptyque, refusant l’idée qu’elle puisse vouloir se contenter d’une existence à la Clark Kent (en devenant Arlene Plympton) alors que sa nature est d’être une super héroïne (la tueuse virtuose et infatigable Black Mamba). Mais cette « surfemme » n’existe que par la dépense physique, ses propos sont lapidaires et rares, ce qui est contraire au style volubile des personnages tarantiniens. Privée du don de la parole, Beatrix perd de son humanité. L’exécution de la violence a beau constituer une dépense physique, elle n’est qu’une suite de mouvements éphémères s’effaçant dans le temps de leur exécution sur l’écran de cinéma et tendant à l’abstraction. Condamnée à agir, Beatrix ne peut plus être. Sans réelle profondeur psychologique, elle demeure une forme spectrale : une morte vivante dont la soif de vengeance alimente une énergie purement mécanique et répétitive. Les douleurs de combats cycliques ne sont donc plus des sensations concrètes d’où une capacité de récupération rapide, contrairement aux douleurs de la maternité dont Beatrix a été privée.

Elle Driver…Dernière femme à faire obstacle à Beatrix Kiddo avant de pouvoir se consacrer à Bill, la seconde blonde du casting dégage une sensualité exacerbée, aux antipodes du style de son adversaire androgyne. Le personnage d’Elle Driver (Daryl Hannah) s’inspire des femmes des films de vengeance du cinéma allemand et suédois des années 1960. Elle répond parfaitement au surnom de vipère assassine. Maniant le poison en connaisseuse, elle rappelle l’archétype de la femme fatale du film noir, aussi dangereuse que fascinante. Hyper sexualisée par son costume d’infirmière peu réglementaire dans le premier volume, elle apparaît plus masculine dans le second, portant un tailleur-pantalon noir et se tenant comme un cow-boy. L’érotisme de sa plastique est tempéré par une beauté mutilée. Son insubordination pendant sa formation lui a valu d’avoir un œil arraché par Maître Pai Mei. Encore une fois, le combat fougueux entre Elle Driver et Beatrix Kiddo dans Kill Bill 2 participe à la figuration de fantasmes masculins. Deux blondes s’écharpent avec fureur, mais dans le but implicite de se retrouver seule à pouvoir approcher Bill, les conversations téléphoniques d’Elle suggérant une intimité certaine avec son supérieur. L’autonomie et la puissance du personnage féminin sont donc toutes relatives. Elle Driver, personnage hypersexué au goût prononcé pour le sadisme, peut être envisagée comme l’expression d’une certaine misogynie.

Gogo Yubari…Garde du corps d’O-Ren Ishii…Chiaki Kuriyama reprend son costume d’écolière de Battle Royale Kinji Fukasaku-2001, un uniforme ultra-court au pouvoir érotique évident. Le comportement de Gogo participe à la symbolique phallique du sabre. Lorsqu’elle demande à un homme s’il veut coucher avec elle et qu’il lui répond par l’affirmative, Gogo le transperce avec délectation « C’est moi qui t’ai pénétré », dit-elle en riant. Ultra-féminité et ultra-masculinité sont condensés dans ce personnage à la violence compulsive, que son aspect juvénile rend d’autant plus effrayant. Mais l’agilité et le volontarisme de la jeune fille ne suffisent pas à arrêter Beatrix Kiddo dans sa quête de vengeance. Quant à Sophie Fatale, meilleur amie, avocate et lieutenant d’O-Ren Ishii, elle incarne une féminité androgyne, avec ses cheveux impeccablement tirés et son costume à col Mao qui la font ressembler à un personnage de Star Trek. La caractérisation du personnage tend à suggérer un lien plus qu’amical avec la guerrière sino-américaine. Personnages secondaires, Gogo Yubari et Sophie Fatale contribuent à la démonstration d’une féminité virile dans Kill Bill 1.

Le diptyque Kill Bill ne constitue pas vraiment une œuvre féministe, mais plutôt un film sur le féminin. On ne peut en effet négliger l’importance capitale du personnage de Bill (David Carradine) dans l’organisation hiérarchique des personnages. Dès les premières minutes du volume 1, le titre du film et l’apparition de nom de Bill sur un mouchoir tendent à canaliser l’attention du spectateur vers cet homme mystérieux. Figure spectrale omnipotente, Bill dirige à distance les actes d’Elle et conditionne la trajectoire du personnage de Beatrix.
Pour cette femme, tuer Bill signifie retrouver son humanité, être capable de pleurer, d’éprouver des sentiments. D’où le passage d’étapes préliminaires sanglantes, nécessaires à la maturation psychologique de la femme ressuscitée avant un face-à-face initiatique redouté. La mort finale de Bill, sans violence et sans effusion de sang, est la seule à faire naître une douleur chez la tueuse vengeresse. Cette figure paternelle par excellence, au visage anguleux sculpté par le temps, doit disparaître pour permettre à l’éternelle jeune fille (Kiddo = gamine) de devenir réellement femme. Le sacrifice expiatoire de l’amant, du père, du mentor rapproche Beatrix Kiddo des héroïnes antiques. L’accomplissement féminin ne peut s’opérer que dans le rapport à un ordre patriarcal traditionnel, voire archaïque incarné par Bill. Contrairement à ce que l’on a pu lire à la sortie des films, la femme castrée n’est pas castratrice. Si Beatrix Kiddo tranche dans le vif un groupe de yakusas pendant une scène chorégraphique où la représentation de la violence tend à l’abstraction, elle détruit des mâles anonymes, simples pantins entourant la charismatique O-Ren Ishii. Bill est donc le personnage masculin identifié tué par Beatrix. L’autre homme de sa liste, Budd, est tué par la manipulatrice Elle. C’est donc un harem de vipères assassines que Beatrix détruit pour atteindre Bill, le mâle dominant. Si les femmes guerrières de Kill Bill sont indépendantes sur le plan physique, par leur maîtrise totale de l’espace diégétique, elles sont mentalement conditionnées par leur rapport au mâle alpha. La démonstration tarantinienne de l’émancipation féminine demeure tronquée…La descendance des vipères assassines est évidemment féminine. Dans Kill Bill, déjà à l’état fœtal, le corps féminin est surpuissant, puisqu’il parvient à survivre à un massacre sanglant. B.B., fille de Beatrix et Bill, synthèse de ses deux parents par ses initiales, porte en elle la violence de ses ascendants. Avec leur consentement, elle choisit de regarder Shogun Assassin Robert Houston et Kenji Misumi, 1980, un film de sabre asiatique, avant de plonger dans les bras de Morphée. Ayant assisté à l’exécution de sa mère, Nikki se voit offrir le droit par Beatrix de venir venger cette perte quand elle sera adulte. Les deux fillettes incarnent l’idée d’une violence féminine cyclique et inéluctable.

Jungle Julia…Austin, Texas, de nuit. Jungle Julia (Sydney Tamiia Poitier), Arlene (Vanessa Ferlito) et Shanna (Jordan Ladd) font la tournée des bars. Chez Guero’s, elles rencontrent d’abord une connaissance, Marcy (Marcy Hariell), à laquelle Jungle Julia demande de montrer à Arlene ce qui l’attend avec les hommes d’Austin. Marcy prend alors l’accent de Sud pour imiter un redneck un peu lourd, premier signe d’une certaine misandrie chez les personnages féminins de Boulevard de la mort. Les trois copines laissent Marcy derrière elles pour se rendre dans le bar du déjanté Warren (Quentin Tarantino lui-même). Elles y ont donné rendez-vous à Lanna-Frank (Monica Staggs), qui tardera à arriver et obligera les filles à patienter en multipliant les tournées alcoolisées… sans défaillir. Incarnation d’un nouvel ordre genré, la première équipée de Boulevard de la mort déploie une féminité chargée des traits les moins enviables habituellement associables à la virilité. Jungle Julia, Arlene et Shanna s’affichent comme des femmes libérées, capables de rivaliser avec les hommes au jeu de la domination, usant d’un langage grossier teinté de pointes d’agressivité. Elles parlent ouvertement de sexualité, se tiennent avec une grande décontraction et n’offrent de leur corps et de leur temps que ce qu’elles désirent concéder. Leur fermeté de leur comportement conduit à la féminisation d’hommes placés dans une position de fascination servile à l’égard de ces créatures dominatrices et persuasives, conscientes du pouvoir que peut représenter un usage réfléchi de leur corps.
Ces femmes s’exposent d’ailleurs sans complexe dans leurs shorts ultra-courts et assument leurs imperfections physiques. Arlene « Butterfly » n’hésite pas à secouer son ventre rebondi et ses cuisses celluliteuses pendant une érotique lapdance pour Stuntman Mike, sous le regard atterré des clients du bar. Tout au long du film, la plastique du corps féminin est particulièrement mise en valeur par les choix de découpage. Le générique commence sur l’image des pieds d’une femme, partie du corps sans cesse érotisée dans le cinéma de Quentin Tarantino. Jungle Julia apparaît ensuite à l’écran : ce sont d’abord ses fesses moulées dans un shorty que le spectateur découvre, puis la cambrure de son dos. La jeune femme aux pieds nus s’allonge ensuite sur un divan, sous une affiche de Brigitte Bardot jeune dans une posture similaire. Filmage et mise en scène tendent toujours à érotiser les personnages, dans la perspective d’un scénario de slasher, genre clairement misogyne où l’émancipation féminine (et plus particulièrement leur liberté sexuelle) est punie par le sang. Selon les codes du genre, une blonde écervelée (ici Pam, interprétée par Rose McGowan) est éliminée en premier, servant de cobaye au tueur pour démontrer au spectateur fasciné la technicité de son style meurtrier. Les protagonistes féminins maîtrisent l’espace de la parole, arme suprême pour asseoir sa domination dans un univers tarantinesque. Jeune femme indépendante et entreprenante, Jungle Julia cherche à créer son propre label et fait le DJ, mais elle peut surtout se vanter d’être une célébrité locale. En tant qu’animatrice radio, elle envoûte son entourage par l’usage de sa seule voix. Elle met ainsi au défi les hommes d’Austin d’identifier dans les bars de la ville sa copine « Butterfy ». Ils doivent parvenir à convaincre Arlene de leur faire une lapdance, en lui offrant un verre et en prononçant quelques vers d’un poème choisi. Si la parole masculine peut alors être le déclencheur de l’action, son effectivité reste féminine, car Arlene peut leur refuser cette faveur. Arlene choisit de son propre chef de se lancer dans un numéro de danse érotique face à Stuntman Mike. C’est autant par charité que par amusement qu’elle se trémousse devant cet homme balafré au style rétro et à l’âge avancé. Pour le vieux cascadeur dont personne ne connaît la filmographie, cette attitude constitue un ultime affront, renforçant son désir de prendre le pouvoir sur ce groupe de femmes « trop » libérées, dont l’exécution par collision frontale s’apparentera à l’assouvissement une jouissance coïtale. Objet virilisé par le cinéma américain (que ce soir dans le film noir ou le cinéma d’action), la voiture apparaît comme l’instrument compensatoire d’un pouvoir phallique frustré par l’émancipation exacerbée des personnages féminins. À l’écran, le choc des deux véhicules est répété quatre fois, afin de dévoiler son effet violemment destructeur sur chacune des quatre passagères. Quand la femme s’octroie la même liberté qu’un homme, son émancipation est mortellement réprimée…
Lebanon, Tennessee, en pleine journée. Kim (Tracie Thomas), Abernathy (Rosario Dawson) et Lee (Mary Elisabeth Winstead) retrouvent leur amie néo-zélandaise Zoë (Zoë Bell), qui souhaitent aller essayer une Dodge Challenger 1970 moteur 440, repérée dans une petite annonce. Cette deuxième équipée apparaît comme le décalque réaliste de la première. Les effets de rayures, de coupes et de collages donnant l’impression d’une vieille copie de film de série Z dans la partie austinienne sont abandonnés au profit d’un noir et blanc élégant, puis d’une image nette aux couleurs acidulées. Les filles, faisant preuve d’une même volonté d’indépendance que les précédentes, s’expriment avec vigueur, mais leur vulgarité demeure plus tempérée. Alors que Lee, la jeune actrice crédule, et Abernathy, la maquilleuse aux élans maternels, sont chargées d’un côté midinette (prêtes à dépenser 27 dollars pour le dernier numéro de Vogue Italie), Kim et Zoë, cascadeuses de profession, apparaissent comme les leaders virils du groupe. La caractérisation précise des personnages leur offre une profondeur psychologique étrangère aux personnages austiniens. La force de ce deuxième groupe est suggérée par des indices simples et efficaces, jouant sur les connaissances tarantiniennes du spectateur. Les filles possèdent une voiture jaune et noire agrémentée d’un autocollant « Lil’Pussy Wagon », rappelant la tenue emblématique de Beatrix Kiddo dans Kill Bill 1 et le nom du premier véhicule utilisé par cette héroïne surpuissante à sa sortie du coma. Ces références ludiques suggèrent le caractère combatif et vengeur de cette équipée féminine. Les conversations des filles concernent essentiellement leur vie sexuelle, symptomatique de leur désir de contrôle sur le sexe opposé. La première conversation de cette seconde partie est similaire à celle de la première : Lee explique comment elle a tenu à distance un amant pour attiser le désir, de la même façon qu’Arlene l’avait fait. Quant à Abernathy, elle explique ne pas avoir couché avec le metteur en scène du film sur lequel elle travaille par souci de ne pas être réduite à une relation « hygiénique ». Mais elle le laisse cependant lui masser les pieds, rapprochement intime et érotique qui suscitait une vive polémique entre Vincent Vega (John Travolta) et Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) dans Pulp Fiction (1994). Le rapport fétichiste de Tarantino aux pieds des femmes est encore alimenté par l’attitude de Stuntman Mike, qui entre en contact avec ses futures proies en touchant et léchant les pieds d’Abernathy, allongée dans la voiture sur un parking. Mais, dans cette seconde partie de Boulevard de la mort, les femmes font plus que refuser la domination et la réification intimées par le regard masculin. Leur maîtrise totale des rapports culturels genrés leur permet d’assouvir leur volonté. Tablant sur la misère sexuelle du redneck raciste, propriétaire de la Dogde convoitée, Abernathy lui suggère le bénéfice qu’il peut tirer de la présence de la belle Lee, véritable fantasme ambulant dans son uniforme de pom-pom girl. Jasper (Jonathan Loughran, client de l’infirmier-proxénète dans Kill Bill 1) est immédiatement envoûté par la jeune actrice qu’il prend pour une star montante du cinéma pornographique. Le film abandonne définitivement Lee devant cette vieille ferme, pour s’achever sur le trio Zoë / Kim / Abernathy, fermant la boucle d’un récit filmique en diptyque commencé à trois (Jungle Julia / Arlene / Shanna).
Alors que Stuntman Mike effrayait Arlene avec son bolide noir affublé d’une tête de mort, il provoque immédiatement la moquerie chez Abernathy et Lee, qui voient dans ce véhicule vrombissant un moyen masculin de compenser un complexe phallique. De plus, en tant que cascadeuses professionnelles, Zoë et Kim apparaissent comme l’incarnation d’une force égale à celle de leur prédateur potentiel. La voiture convoitée par Zoë est semblable à celle de Vanishing Point (Point limite zéro, Richard C. Sarafian, 1971), film de course-poursuite auquel Stuntman Mike fait référence dans la première partie, lorsqu’il évoque sa propre carrière de cascadeur. Cette fois-ci, l’attaque du groupe féminin ne se résume pas à une simple collision, mais se développe pendant de longues minutes dans une course-poursuite acrobatique. Zoë est allongée sur le capot, retenue au véhicule par deux ceintures, quand Stuntman Mike vient heurter la Dodge. Malgré la violence des chocs répétés, Zoë se maintient en position et Kim, au volant, parvient à distancer leur poursuivant. Armée préventivement d’un revolver, Kim a intégré une nécessité féminine de se protéger des hommes, ce qui lui permet de blesser sévèrement le détraqué sexuel de la route. Comme les indices programmatiques de leur premier véhicule le suggéraient, le trio reprend le volant pour se venger de cette attaque. « Let’s kill the bastard », ordonne avec rage la douce Abernathy. Maîtrisant totalement l’espace, Kim parvient à surprendre Stuntman Mike pour le percuter avec fureur, alors que Zoë chevauche la portière passager, armée d’une barre de fer. Cette équipée (littéralement) sauvage se venge tout autant qu’elle venge pour le spectateur le premier groupe massacré par surprise dans une nuit profonde. Inflexibles face à l’homme qui hurle de douleur, Kim, Zoë et Abernathy, filmées en légère contre-plongée, dominent le prédateur terrassé qu’elle achèvent avec violence à coups de poings et de barre de fer. Un coup de talon final, accessoire féminin par excellence, achève d’asseoir l’hégémonie du trio sur le personnage masculin.

ÉPILOGUE 2009
Avec ce second trio, la femme atteint le paroxysme de sa maîtrise de l’univers diégétique tarantinien. Boulevard de la mort valut à QT d’être considéré comme un réalisateur féministe à sa sortie. Mais l’importance grandissante des femmes dans la filmographie du cinéaste cinéphage semble atteindre son point culminant dans cette scène finale d’exécution d’un serial-killer misogyne au fort pouvoir fédérateur. Dans Inglourious Basterds-2009, Soshanna Dreyfus (Mélanie Laurent) et Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) ont beau être des femmes combatives et déterminées, elles ne survivront pas à la fureur des officiers nazis. Elles demeurent des combattantes de l’ombre, œuvrant pourtant avec plus de témérité que les Basterds d’Aldo Raine (Brad Pitt) pour la défense de la liberté.
TERMINONS PAR UN AVIS CRITIQUE…

TARANTINO OU L’ART DU VIDE
CRITIQUE D’UNE CARRIÈRE ÉGOCENTRÉE
par Yan Gamard
Certain-e-s ont crié au génie, continuent à le faire et le feront certainement pour la sortie prochaine de son huitième film, Les Huit Salopards. Huit sur dix si l’on en croit les dires de Quentin Tarantino, qui a d’ores et déjà annoncé sa fin de carrière. Amplement plébiscité pour chacune de ses productions, le réalisateur mérite-t-il pour autant toutes les louanges faites autour de ses connaissances, de sa précision ou encore de son militantisme cinématographique ? Quentin Tarantino a remporté de nombreux succès, à la fois critiques et publics. Triomphe populaire, mais aussi reconnaissance d’une patte dite d’auteur, il divise autant qu’il rassemble. Venant du circuit indépendant et continuant à y être rattaché, il a enchaîné des productions toujours plus ambitieuses, restant cependant précis, exigeant et libre des carcans des majors. Dans ses films les contraires s’entrechoquent cultivent l’ambiguïté entourant le réalisateur. Voulant à la fois se faire plaisir et « travailler sur les sous-genres les codes à la lettre », il tient à communiquer ce même plaisir à tous. Il exulte autant à marcher dans les pas de ses prédécesseurs-ses qu’à amener un genre à son apogée. Certaines fois orfèvre du cinéma, d’autres entertainer, il est cependant loin de faire l’unanimité, notamment lorsqu’il est question de thématiques telles que le féminisme ou le racisme. Se tenir sur le fil du rasoir semble d’ailleurs être devenu une spécialité que Tarantino a su affiner avec le temps. Susciter le débat, c’est presque un objectif. Il affirme rendre hommage au septième art et a su délivrer des productions emplies de références et de renvois intertextuels. Salué comme cinéphile aguerri, il n’échappe pas au sein du même mouvement à des accusations répétées de plagiat sur ses productions, de la toute première à Kill Bill en 2003. Plus que cinéphile, il en est ainsi venu à être qualifié de fétichiste du cinéma. De ce dernier, mais aussi des femmes ou encore de la violence. Un fétichiste dont les hommages sont vus comme un peu trop fidèles, cinématographiquement parlant, plus approximatifs pour ce qui est du reste. Depuis Reservoir Dogs-1992, le style Tarantino a bien évolué. En proposant des revenge movies, une « trilogie de l’oppression » et son approche jouissive selon beaucoup de certaines libertés bafouées, il a pour mérite indéniable d’attirer l’attention sur ces thématiques. Voir et revoir, lire et relire ses bobines et scénarios met ainsi en lumière des sujets de plus en plus discutés. Cependant, des voix s’élèvent pointant le caractère oppressif que ses images paraissent vouloir dénoncer. Il les renforcerait de la pire manière qui soit, le cas échéant, sous couvert de les contester et donc brouillant les cartes sur les véritables messages des mouvements concernés.
Racisme, sexisme, violence, blaxploitation…Il manierait avec l’adresse d’un Johnny Depp sous éther ou, plus récemment, d’un Dicaprio sous quaalude, des problématiques lourdes de conséquences. Construire des personnages féminins défendant difficilement les féministes reste un des exemples les plus flagrants de l’insouciance de l’approche tarantinesque. Il en va de même des débats autour de Django Unchained-2012 et de sa description discutable et discutée de l’esclavagisme et du racisme. Jouissifs, les films du sulfureux Tarantino le demeurent pour autant, on ne peut lui enlever cela. On ressort de la salle galvanisé par le massacre en règle de toutes les personnes qui ont été du mauvais côté de l’histoire. C’est entre autres ce qu’a pu dire Lawrence Bender, producteur de l’uchronie Inglourious Basterds-2009 annonçant poétiquement que le réalisateur avait offert « un putain de rêve [aux] juifs-ves ». Le cinéaste sait mieux que personne faire monter la pression jusqu’à l’exutoire final. La frustration contenue tout du long est alors relâchée, les hormones bouillonnent à peu près autant que le cerveau d’un adolescent sous boisson énergisante contraint de jouer à Pop’n music, une lumière stroboscopique dans les yeux. Mais passé ce vernis, le divertissement représente-t-il une fin en soi ? Un passe-droit ? Tarantino propose des imaginaires traitant de sujets sensibles, provocants. Les êtres y sont clivant-e-s, et l’on peut parfois douter de leur humanité. Certaines critiques prennent alors pour cible la violence exagérée des productions elles-mêmes, menant leurs propres luttes à l’encontre de cette intensité débridée. Mais les plus solides réserves avancées ne sont pas au sujet des héroïnes fortes encore trop rares sur grand écran, des flots de sang ou de tel ou tel détail de plan, mais bien des maladresses ou contre-emplois de concepts faisant souvent s’effondrer beaucoup les velléités militantes des productions. S’ils devaient être une tapisserie, ce n’est en somme pas le fil utilisé dans la fabrique de ces films qui pose problème, mais bien le tissage simpliste qui bloque la création de motifs complexes. Complexité dont des problématiques telles que le sexisme ou le racisme ne peuvent se passer. Alors, ambition justifiée de la part du cinéaste ou gourmandise de la part du réalisateur ? Déranger suffit-il à simplement pallier toutes les imprécisions et absences ? Entrant plus amplement dans la mécanique des revenge movies avec les fameux Kill Bill, les films estampillés Tarantino ont opéré un tournant des engagements politiques tant dans sa représentation que dans ses fétichismes. Ils constituent un point d’entrée parfait dans cet univers de l’à peu près. C’est dans ce film duel ayant marqué les esprits, qu’une femme forte (Uma Thurman) cherche à venger le meurtre de son mari et de son enfant à naître en tranchant tout ce qu’elle rencontre à coups de katana, le tout dans un costume emprunté à feu Bruce Lee. Indéniablement physiquement puissante, Béatrix Kiddo l’est, tout autant que les femmes assassines du Deadly Viper Assassination Squad dont elle faisait partie. Elle les affronte une à une, qu’elles soient devenues mère de famille, loup solitaire ou PDG psychotique d’une florissante triade. Elle affronte également un homme, un cercueil, et enfin le fameux Bill, son ex, mais aussi père de son enfant et chef dictatorial de cette équipe de feu. Il n’y a donc pas de doute pour une large partie du public recevant ces quatre et quelques heures de films, ils sont féministes et se jouent du patriarcat, allant jusqu’à lui régler son compte en guise de grand final. Mais en s’intéressant aux productions une fois le rush d’adrénaline passé, force est de constater qu’elles promeuvent un message, au mieux, très vague, au pire, perverti du féminisme.
Certes, Uma Thurman est souvent filmée en contre-plongée, mise en avant, ne craint rien et endosse violence et attributs usuellement réservés au masculin. Bien sûr les hommes se font découper menu à grand renfort d’hémoglobine et sont ponctuellement anonymisés derrière des masques, perdant jusqu’à leur identité. Bill, figure masculine majeure du film, joue au fantôme laissant ainsi le champ libre aux femmes du casting. Lors d’un second passage, rien n’est aussi plein et évident. Majoritairement éprise de la vengeance qui lui sert de carburant, l’héroïne détruite devient action et non plus discours. Femme à la psychologie unidimensionnelle pendant la majorité de l’œuvre, elle revient à la parole plus volubile une fois son enfant retrouvée, se tournant complètement vers elle et brisant les enchaînements de combats. Antérieurement, elle n’éprouve aucun sentiment hormis la colère, semble-t-il, et reste insensible au fait de tuer sa première adversaire (Vernita Green) sous les yeux de la fille de celle-ci. Elle est ensuite ramenée toujours davantage, à mesure que la pellicule se déroule, vers ce qui apparaît être son horizon d’attente, une maternité à la fois source et aboutissement de sa quête. La conclusion des films est une sorte de contrebalance de la violence par la douceur maternelle, que l’on peut facilement interpréter comme un « retour à la normale », un négatif de ce qui a émaillé toute l’œuvre. D’une machine à tuer, elle redevient mère. En parallèle, Bill, grand marionnettiste, est certes physiquement absent, mais reste le MacGuffin omniprésent, la grande force qui plane et ordonne à ses subordonnées de tuer son ex-femme. Toutes s’affrontent dans son ombre, et ce pour l’atteindre d’une manière ou d’une autre. On peut d’ailleurs y reconnaître un écho du schéma de la série Drôles de Dames-1976 qui fut autant saluée pour ses personnages féminins forts que critiquée pour son sexisme. Représentations d’un patriarcat à la mode Big Brother, la mort finale de Bill prédite dans le titre passe presque inaperçue au regard de la mise en avant de sa fibre paternelle ou de son rôle durant les centaines de minutes précédentes. Enfin, et davantage révélateur, Béatrix est mise en position de force physique, de violence incarnée, mais n’a que peu d’épaisseur en tant que personnage. Elle devient un pantomime de l’agressivité ordinairement masculine. Vidée de toute substance supplémentaire, ne sachant répondre que par le sang à tout traumatisme, elle est l’illustration d’une figure que Tarantino a employé régulièrement…La guerrière sexy. À cet archétype, il adjoint une figure qui sera encore plus identifiable dans Boulevard de la mort-2007 la phallic girl. Ces deux notions, étudiées à la fois par Angela McRobbie et Maxime Cervulle, dévoilent le vrai visage de Béatrix Kiddo, réceptacle de comportements clichés, traditionnellement masculins. S’insérant au cœur d’une féminité plus classique, la phallic girl dépolitise et décontextualise, par son approche simpliste et sa transposition pure et dure de clichés, d’un genre sexué à l’autre. Le personnage de Béatrix est donc creux et souffre cruellement d’un manque d’épaisseur en tant que figure supposément féministe. Le film a ainsi toutes les apparences d’un combat qu’il ne mène que ponctuellement, voire qu’il nie par l’usage de clichés, sans historicité aucune.
On peut compléter cette liste non exhaustive d’aspects problématiques avec l’inclusion de l’archétype de la femme fatale issue du film noir en la personne d’Elle Driver (Daryl Hannah), hautement dépendante de l’appréciation de Bill. Archétype basé sur une image d’hyperféminité dangereuse, empoisonnée, véritable problème à résoudre et à faire entrer dans le moule traditionnel (ou à éliminer). Sans oublier un énième usage, ici ponctuel mais pas moins navrant, du rape and revenge (« viol et vengeance », en français). Ce sous-genre, employé ad nauseam depuis les années 1970, utilise comme élément déclencheur un viol, cause d’une vengeance ou d’une intrigue pour y ajouter le « piment » d’une violence sexualisée et ne prend pas en compte les réalités d’un tel trauma, ses conséquences et les véritables réactions que peuvent avoir des victimes à un tel événement. Fiction écrite par des hommes et pour des hommes, il ne s’agit que d’une facilité d’écriture, d’un trope déjà tout prêt et conservant l’homme comme protagoniste, les femmes réagissant dans un second temps à cette prise de pouvoir indue. En « grattant le vernis », on découvre donc vite que peu de choses résident en dessous. Les aspects conservateurs de la famille nucléaire sont, eux, à peine dérangés et les personnages pourraient être des éléments narratifs interchangeables à l’infini. C’est dans Boulevard de la mort-2007, production abordant les mêmes problématiques que Kill Bill et voulue encore plus ouvertement féministe, que ce qui restait de doutes quant à l’approche du cinéaste s’envole. Le film s’organise en un diptyque plus court que son prédécesseur et met en scène deux groupes de femmes. L’un est « purement féminin » en matière de clichés usuels avec vêtements courts épousant les formes, sujets de conversation tournant autour de la mode, la beauté et les hommes, danses lascives, rien ne manque. Le second est beaucoup plus « femmes fortes » et investit de caractéristiques d’ordinaire prêtées au masculin. Il présente à l’écran des portraits davantage rattachés (pour deux d’entre elles) aux clichés de lesbiennes dites butch. Selon un principe de miroir inversé d’avec le premier, incluant des caractéristiques d’une certaine émancipation/intégration féministe, le second laisse ainsi Maxime Cervulle dans une profonde perplexité « devant le manque d’imagination […] de représenter des femmes puissantes comme des hommes comme les autres »4. Et d’ajouter que cela vient en lieu et place d’une extension de « la sphère conceptuelle du pouvoir pour le conjuguer au féminin » qui n’advient pas. Dans ce schéma, le masculin reste en définitive supérieur au féminin et le premier trio fait les frais de cette politique. Émaillant ses dialogues de ce qui, dans sa tête, semble intéresse ou non les femmes féminines, Tarantino en ostracise la moitié sans état d’âme, puisqu’elles ne peuvent décemment pas aimer les « films de bagnoles ». En revanche, les deux femmes davantage masculines, elles, adorent. Elles aiment d’ailleurs les grosses cylindrées et le cinéma, mais aussi les armes, les jurons et la sexualité débridée toute en agressivité. Scène davantage marquante encore pour un film se voulant féministe : lorsqu’une des filles commence à être influencée par ses deux partenaires de route plus stéréotypées butch, et souhaite leur prouver qu’elle aussi est trop « cool ». Elle n’hésite pas, pour emprunter une voiture, à proposer la bonne blague de sous-entendre que la quatrième fille, endormie, est ouverte à toutes possibilités si le propriétaire de ladite voiture est tenté. Abandonner une des leurs à un potentiel viol parce que c’est apparemment « hilarant », rien de mieux pour montrer l’état d’esprit en place. Qui plus est, lors du tournage, une des actrices en désaccord avec cette scène a proposé une astuce de scénario bien plus cohérente d’un point de vue féministe (arnaquer l’homme toutes ensemble), solution refusée par un Tarantino a priori récalcitrant et peu ouvert aux propositions.
Encore une fois, derrière la revanche et la violence brute, il ne reste que peu de substance. Plus que des femmes fortes à part entière, les personnages deviennent des hommes forts camouflés sous des traits féminins. Ou plus exactement, l’idée que se fait un réalisateur se fiant à ses préjugés de ce qu’est une femme forte, complexe et moderne. Ce dernier est même surpris des protestations face à un film qu’il considère comme un réel « empowerment for women ». Par ailleurs, et si ces groupes sont confrontés au même tueur en série macho en puissance ayant pour extension phallique sa voiture, il se verra mis à bas par le second uniquement. Mais outre la manière de filmer le premier trio tout en hypersexualisation, les comportements du second groupe ainsi que les plans, reproduisent à l’identique, eux, ce que pratiquait le méchant de l’histoire. Ces femmes se changent ainsi en ce qu’elles combattent, usent de la voiture, avec quelques répliques bien senties et complètent le tableau par une violence inédite. Une question peut alors se poser, comme cela a souvent été le cas au sein des mouvements luttant pour l’égalité vers quel féminisme ? Une mimique du masculin et de principes éthiques douteux teintés d’agressivité latente ? Ou une idée différente d’une humanité plus en accord avec des principes de non-oppression ? La violence jouissive du passage à tabac final fait peu de cas de ce type d’interrogations. Il en va de même, comme le rappelle la chercheuse Célia Sauvage, pour Inglourious Basterds-2009 dans lequel la violence perd de son contexte pour quasiment se transformer en « une satisfaction sexuelle profonde de vouloir tuer des nazis », selon les termes d’Eli Roth, réalisateur de films de torture porn. Dans un mouvement proche de celui de Boulevard de la mort, c’est à travers un miroir déformant que les nazi-e-s, qui admiraient l’instant d’avant la violence à l’écran, se voient massacré-e-s par les juifs-ves dans le cinéma de Shoshana (Mélanie Laurent). Emboîtement et mise en abîme qui peuvent aussi être considérés comme magistraux si l’on y inclut les spectateurs-rices face à leur écran. Pourtant, cela reste tout de même problématique idéologiquement parlant quant à la violence et à ses implications. Cette mécanique est déclinable à l’infini et Tarantino est devenu virtuose dans l’art de mettre en place des références cinématographiques autant que politiques tout en les décontextualisant. Il en vient à leur enlever systématiquement toute pertinence morale, sociale, politique ou temporelle au bénéfice du « fun » qu’il affirme rechercher à tout prix, interview après interview. Après tout, c’est vrai, à quoi bon se préoccuper de l’histoire, de la pertinence ou de la cohérence de ce que l’on utilise lorsque l’on parle d’esclavagisme, par exemple ? Il vaut mieux que cela « n’apparaisse qu’en toile de fond », selon ses propres termes. Il oublie certainement au passage les nombreux appels à penser sa pratique cinématographique et son éthique depuis le débat autour du travelling de Kapò (1959), notamment.
Dans Django Unchained-2012, la question du féminin est cette fois vite réglée par l’expression la plus basique du trope de la demoiselle en détresse. Par ce mécanisme même, il va à rebours de ses films précédents et illustre une nouvelle fois son manque de compréhension globale et profonde du féminisme. Le reste du film tient dans le parcours initiatique d’un afro-américain émancipé qui, en définitive, n’a plus d’afro-américain que la couleur de sa peau tellement chaque action devient discutable. De la monstration des corps à la violence de Django, ou encore de son évolution psychologique à son leadership contestable, le « film sur l’esclavage que l’Amérique n’a jamais voulu faire » ressemble davantage au divertissement dont il n’aurait jamais dû hériter. Force est de reconnaître qu’un film ne peut tout prendre en considération, tout inclure, qu’il reste une fiction parfois légère et sans prétention. Mais les ambitions affirmées par Tarantino, ainsi que la matière même de ses films, sont une combinaison le contraignant immanquablement à honorer une certaine checklist. Faute de quoi, son action crée davantage de confusion que de progrès. Annulant par ailleurs toute discussion critique au regard de l’ambivalence de sa position entre art et commercial, Tarantino use et abuse de l’argument massue de son usage décomplexé de tout et n’importe quoi, et ce au service d’une mécanique pensée pour plaire. Il effectue ainsi constamment, et à plus ou moins grande échelle, le même mouvement : omniprésent, il exprime ses goûts, pensées et affects personnels par le biais de tout ce qu’il juge bon d’utiliser. Et ce, sans aucun souci des origines et ramifications de chaque élément dans lequel il se taille un costume à grands coups de machette. Les femmes n’ont plus d’individualité ou d’histoire, pas plus que les personnes noires, les emprunts cinématographiques ne sont plus que de pales copies, la violence est vidée de tout appui autre que le plaisir cathartique des spectateurs. Tout et tou-te-s sont ramené-e-s aux circonvolutions du propre cerveau de Tarantino, et au plaisir qu’il prend et voudrait donner au travers d’exutoires n’ayant pour point d’intersection que sa propre personne. Par ailleurs, et au-delà d’une image publique travaillée, l’homme n’est pas connu pour porter les luttes que ses films prétendent faire avancer. Comme à l’occasion de cette photographie issue d’une série accordée au W Magazine pour assurer la promotion de Django Unchained et chacun-e sera laissé-e seul-e juge.
Cas d’école d’une industrie de la culture pensant avoir compris et digéré des féminismes « datés » à coup de cultural studies, Tarantino fait partie d’une mouvance bien plus compliquée à placer sous le spectre des oppressions. Et ce puisqu’elle entremêle éléments progressistes et traditionnels. Il n’en demeure pas moins que son ironie et sa désinvolture ne bénéficient pas, en définitive, à ses ambitions politiques demeurant à l’état de fantasmes confus. Ayant souligné lors d’interviews et démontré au travers de ses films sa fascination autant que sa peur des femmes, le réalisateur en fait autant des objets de contemplation que des hybrides stéréotypées. S’il divise autant, c’est peut-être précisément du fait de son caractère figé aussi effrayé qu’hypnotisé d’observateur externe pensant saisir la manière de tout inclure dans une seule forme, en donnant la priorité à l’excitation et au divertissement. Fétichiste des apparences, il les manipule à la manière d’un peintre du dimanche, inapte à saisir les subtilités d’une touche impressionniste. Maxime Cervulle a cependant développé une théorie selon laquelle « les hommes hétérosexuels s’abandonnent à une soumission sexuelle, ou s’investissent affectivement dans des représentations de femmes puissantes et armées, comme des temps de loisirs où ils tentent de desserrer un instant l’emprise que le genre et la domination ont aussi sur eux »6. Loisir possible du fait des privilèges mêmes de ces hommes, mais alternative intéressante à un Tarantino qui se leurre probablement lui-même lorsqu’il pense remettre en cause le statu quo.








