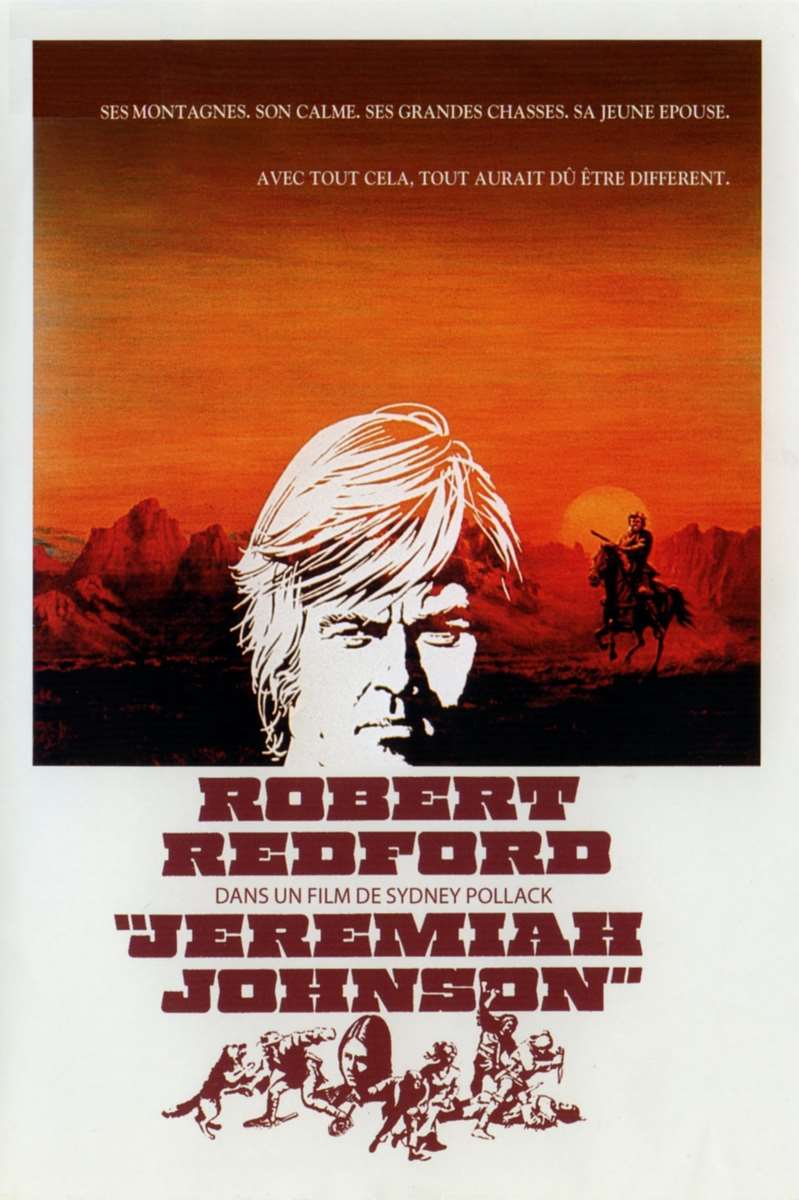Moins polémique et plus respectueux envers la tradition, Sydney Pollack érige lui, à travers l’épopée de son héros solitaire, Jeremiah Johnson, les formes d’un western hivernal, entre « soleil et orage », révisionnisme romantique et escalade barbare. Délivrance, Les Chiens de paille, Le Convoi sauvage…Trois années de1971 à 1973 le Nouvel Hollywood vient d’offrir quelques grandes toiles fêlées au cinéma américain. Les réunir ainsi n’est certainement pas anodin puisqu’il s’agit du surgissement à l’écran de ce que le « Vieil Hollywood » avait jusqu’alors refoulé…Un pic de fièvre primitiviste. À l’apogée du bain de sang vietnamien, ces films questionnent tous l’ennemi intérieur et trouvent dans l’espace d’où surgissent les puissances d’une sauvagerie sans nom.

IL ERRE OÙ LE VENT VA par Romain Genissel
Étrange chef-d’œuvre de Sydney Pollack et l’un des derniers monuments du western. Entre réalisme documentaire et son initiation physique et lyrisme onirique avec mouvement de grue, grandiose partition de cordes, Jeremiah Johnson est l’un des seuls films de la décennie à autant préserver les codes classiques du genre qu’à discrètement s’en émarger. Si la rencontre avec le fameux Griffe d’Ours dégage un côté picaresque qu’un John Ford ne dénigrerait pas, la figure errante et quelque peu tourmentée de Jeremiah Johnson n’a rien avec un John Wayne sans peur et sans reproche. De même, si le système des personnages qui gravite autour de Jeremiah reste largement identifiable, la figure de l’indien serait en apparence plus problématique. En effet, outre qu’on les entend parler en français, la place réservée aux indiens semble autant en continuité avec un certain antagonisme classique que prendre acte du révisionnisme moderne de Little Big Man. En plus de la romance avec l’indienne, la peinture des rites et des costumes inspirée par des recherches de fonds ne laissent planer aucun doute quant à l’intention de Pollack de ne plus alimenter les clichés d’alors. Ainsi, et à la différence du pasteur fanatique et de l’armée qui profanent le cimetière, les guerriers indiens qui pourchassent Jeremiah dans la seconde partie dégagent une autonomie au travers du noble courage et du respect sacré dont ils sont nimbés. Il ne faut donc pas voir dans les scènes de corps-à-corps entre Jeremiah et les vaillants «peaux-rouges», un motif réactionnaire mais bien ce qui habite et surgit du fond hostile de la Nature. Pareille à la puissante séquence de combat avec les loups, l’imagerie indienne repose sur cet authentique trait du récit américain où la Nature abrite en son sein une pure menace. Ce trait qui fera écrire à Melville dans un chapitre fameux de Moby Dick que la belle surface de l’océan n’est que l’illusion d’un fond sauvage où les requins s’entredévorent…
Écrit à plusieurs mains dont celles du fidèle Robert Redford, Jeremiah Johnson fonctionne et enivre encore aujourd’hui avant tout grâce à son échafaud soigné. Il aura fallu six mois de montage à Sidney Pollack pour faire du parcours de Jeremiah Johnson un circuit en miroir sous forme de boucle. Le meurtre de la famille et l’incendie de la maison de Johnson marque ainsi une césure où de l’errance initial qui le conduira à l’établissement dans les bois, Jeremiah va devenir le héros une guerre sans fin qui fera de lui une légende de l’Ouest. Tous les personnages rencontrés en chemin et que Jeremiah recroisera plus tard actualisent à chaque reprise la stature mythique de l’aventurier Johnson. Enfin, l’instinct du trappeur est ici redoublé et profondément idéalisé par la monumentalité de l’environnement qu’il a conquis, où il a appris se fondre. Car au fond, il s’agit bien encore et toujours de cela dans Jeremiah Johnson et le western en général. D’une profonde inclinaison envers la Nature. Ici celle des Rocky Mountains superbement embellie par l’usage du Technicolor et de la Panavision. Du passage des saisons au bestiaire qui le traverse, le regard du cinéaste les accueille pour dresser d’immenses toiles en référence directe à l’inspiration romantique des peintres américains. Le battement harmonieux qui en découle, la religiosité de ces œuvres sublimes de la Nature confèrent au film une immense grâce. Grâce rendue par le manteau neigeux qui l’enveloppe et sans doute symbolisée par cette parfaite surimpression où la montagne, le feu et le visage de Jeremiah Johnson ne font désormais plus qu’un.



UN HYMNE A LA NATURE
Inspiré de l’histoire vraie d’un trappeur, ce western renouvelait le genre en 1972 par son humanisme et son approche de l’homme face à la nature, dans une décennie qui reste la plus pauvre pour le western. Le héros incarné par Robert Redford est un citadin qui décide d’en finir avec l’univers trouble des villes et de partir vivre en solitaire au cœur des Montagnes Rocheuses, où il va comprendre la dure loi de la nature, rencontrer des Indiens et vivre une véritable odyssée. Premier essai de western contemplatif, le film commence par une étude sur la survie en milieu hostile, glisse vers un climat lyrique, puis vers une méditation sur le paradis perdu. Hymne au sens aigu de la nature, filmé au cœur de paysages grandioses magnifiquement mis en images, Jeremiah Johnson n’est pas un western comme les autres, on y trouve ni romantisme, ni exaltation de l’héroïsme, ni aventure trépidante, ni chevauchées, mais un immense élan de liberté et de dignité humaine, pour lequel Sidney Pollack et Robert Redford ont passé de longs mois à la préparation. Redford en sortira tellement marqué qu’il aura l’idée d’installer en 1981 son Sundance Institute dans ces contrées isolées. Parabole sur la civilisation et le retour à la vie sauvage, le film raconte les relations qui s’établissent entre un homme déterminé et le décor naturel qui l’entoure, le temps, le froid, le cours des saisons, les bruits ambiants, les animaux, les bons et les méchants indiens, le trappeur pittoresque Griffe d’Ours qui prennent alors une nouvelle dimension. Tout est finement analysé, sans excès ni manichéisme. Le réalisateur fait bien ressortir que la nature est majestueuse et qu’elle inspire à l’homme un désir fou de liberté, mais qu’elle regorge aussi de pièges et d’une violence qui ne la rendent pas plus attirante que la société urbaine. Oeuvre forte et âpre, qui bénéficie d’une combinaison de talents complices entre Redford et son réalisateur fétiche, ce parcours initiatique a donc de nombreux atouts, mais également quelques défauts, notamment une lenteur et quelques moments de vide qui par endroits m’ont un peu ennuyé, le ton n’est pas aussi lyrique que chez Jack London dont l’intrigue et le décor rappellent ses romans, mais tout ceci est assez relatif, c’est une fable écologique qui reste quand même fascinante par certains côtés, et qu’il serait dommage de ne pas voir d’un œil sensible.


L’histoire vraie de John Johnson (aussi connu sous les jolis noms de Johnson le mangeur-de-foie ou le tueur de Corbeaux), un trappeur américain qui choisit de vivre une grande partie de sa vie dans des montagnes enneigées peu chaleureuses, partagées avec plusieurs tribus d’Indiens, est une légende en soi. La page Wikipédia qui lui est consacrée (lien) donne une idée assez intéressante du personnage, et montre que la version qu’en tire Sydney Pollack dans Jeremiah Johnson, à quelques détails près à commencer par son prénom, est sans doute très peu éloignée de la réalité. En revoyant cette épopée, j’avais oublié à quel point Jeremiah Johnson est beau. Non pas forcément le personnage, interprété par un Robert Redford au sommet de son charme, cheveux blonds aux reflets dorés parfaits, regard magnifique, classe incroyable quelle que soit la longueur de sa barbe, quelle que soit la quantité de peaux qu’il arbore sur le dos ou sur la tête. Non pas uniquement les paysages, grandioses, capturés dans tout le lyrisme onirique des chaînes montagneuses de l’Utah, avec leurs forêts, leurs rivières, leurs immensités immaculées, leurs versants enneigés sur lesquels le soleil vient se lever et se coucher. Mais aussi, et peut-être surtout, les motivations du personnage, ou plutôt l’absence de motivations explicites qui seraient affichées continuellement tout au long du film.
On comprend bien les raisons qui ont initié ce voyage à la rencontre de la nature et de la solitude…La fuite loin de la guerre avec le Mexique, la fuite du monde civilisé, sans doute pour des raisons peu tangibles à l’origine, et avec une forme d’idéalisme un peu naïf qui sera rudement éprouvé lors de ses premiers contacts avec la vie dans les bois et dans le froid. La confrontation avec cet environnement hostile qu’il ne connaît pas bien, malgré les conseils et les enseignements des personnages bienveillants qui croiseront sa route et le guideront dans sa quête initiatiquee manière relativement réaliste, se fera dans un premier temps dans la douleur et dans l’échec….Difficultés pour se nourrir, faire du feu avec du silex, chasser les animaux pour leur fourrure et leur viande, dépecer un bison, pêcher à mains nues dans les rivières glacées, dormir sur les cendres encore chaudes du feu, construire un abri à l’aide de troncs d’arbres et de torchis. De rencontres en découvertes, de blessures en échecs, Jeremiah Johnson passera très lentement de l’apprenti trappeur idéaliste à la légende unanimement respectée. Le mythe de la personne, autant que celui de l’Amérique, se construit sous nos yeux. La dimension initiatique de ce western qui n’en est presque pas un, la lutte sans fin avec les éléments, lui confère sans doute sa dimension atemporelle et donc éternelle. Une composante essentielle du film, et de la lutte contre la nature, est concentrée dans la figure multiple de l’Indien. Aucune condescendance, aucun manichéisme, les clichés sont gardés à bonne distance, et s’il est difficile de parler de réalisme, Sydney Pollack parvient à trouver une excellente distance aux codes traditionnels. Les Indiens font partie intégrante des lieux, de la nature, ils peuvent être amicaux ou hostiles, ils peuvent être aussi brutaux que des loups et aussi chaleureux qu’un compagnon de voyage. Une menace omniprésente, renforçant la dimension romantique du trappeur solitaire face à de nombreux défis, mais qui est elle aussi tirée de la vie de Johnson le mangeur-de-foie.
Il se dégage de tous ces éléments un désir absolu de liberté, dénué du folklore habituel qui sacraliserait son héros. Il n’y a pas vraiment de morale dans Jeremiah Johnson, très peu d’émotions communiquées de manière directe et très peu de musique. Il n’y a pas de véritable condamnation de la vie à la ville. Il n’y a qu’une sorte de poème bucolique mais grave, une ode à la solitude légèrement contrainte, à la frontière de la passion suicidaire. Et un magnifique signe de respect, à distance, comme ultime geste du film.

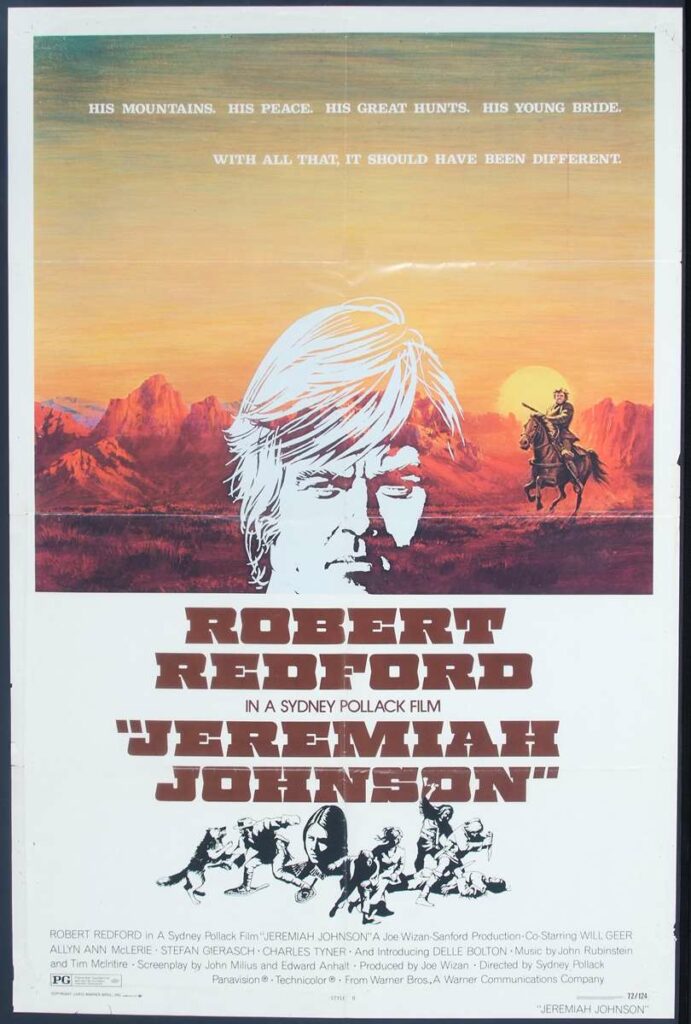

SYDNEY POLLACK 1934-2008
par Serge Kaganski
Sa bonne bouille de Juif russe de l’Indiana manquera. Il faisait partie de la génération et de la famille ciné des Sydney Lumet, Jerry Schatzberg, Alan J. Pakula,…Celle du cinéma américain des années 1970, fondé sur un équilibre entre spectacle et préoccupations politico-sociétales, sur des récits solides et des personnages bien écrits sur des récits solides et des personnages bien écrits. Un cinéma honnête, plaisant, bien fabriqué, un peu en deçà des cimes ambitionnées et atteintes par les mavericks Coppola, Spielberg, Lucas, Scorsese…Sydney Pollack faisait partie de ces excellents fabricants de films qui, sans atteindre le génie, n’en constituent pas moins la poutre centrale de l’histoire du cinéma américain. Cette filmo du milieu pollackien a oscillé de l’excellent au moins bon Havana, Sabrina et s’est essentiellement partagée entre deux grands genres…Le thriller à teneur politique et le grand mélo romantique. Pollack a constamment analysé son pays sous différentes coutures, évoquant la Grande Dépression On achève bien les chevaux-1970, l’utopie des grands espaces avec le superbe western hivernal Jeremiah Johnson-1971, la paranoïa suscitée par les zones d’ombre du tentaculaire pouvoir américain Les Trois Jours du Condor-1975, les dérives du capitalisme La Firme-1993. Sur le versant romantique, il aura tiré quelques larmes aux spectateurs les plus midinettes avec Nos plus belles années-1974, le méconnu Bobby Deerfield-1977 ou le méga-carton d’Out of Africa-1985, film couvert d’oscars. Et Tootsie-1983, l’un de ses plus gros succès.



Sydney Pollack a débuté comme acteur, dans ses propres films ou chez Altman et Zemeckis, on retiendra ses prestations dans Maris et Femmes-1992 de Woody Allen et sa mémorable scène d’engueulade avec Judy Davis et Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick-1999, où son physique rassurant fait merveille dans la peau de Victor Ziegler, grand ordonnateur mystérieux des sulfureuses distractions des puissants. Homme cinéma décidément complet, il était aussi producteur Retour à Cold Mountain, Michael Clayton, et de ses propres films. Filmographie d’un honnête homme qui n’a jamais perdu sa boussole éthique, esthétique ou politique dans les paillettes hollywoodiennes.