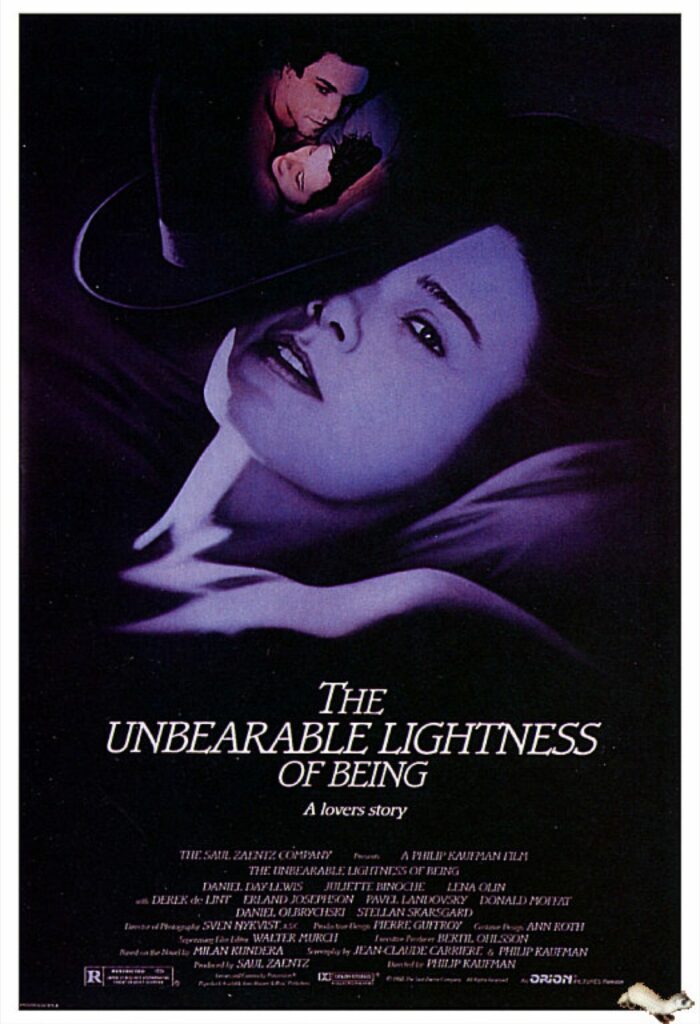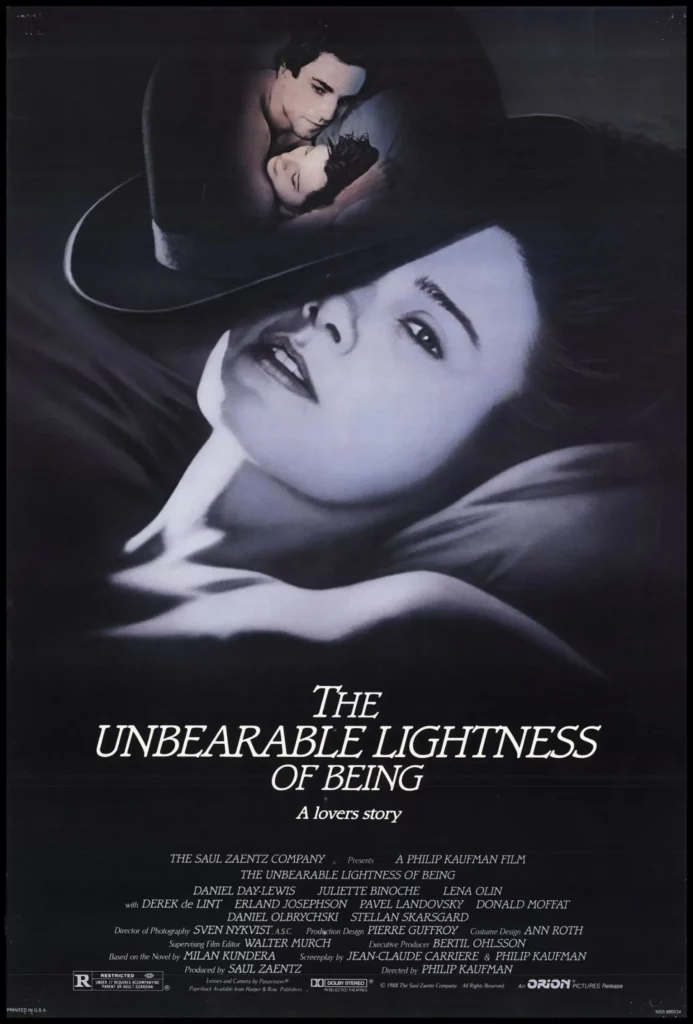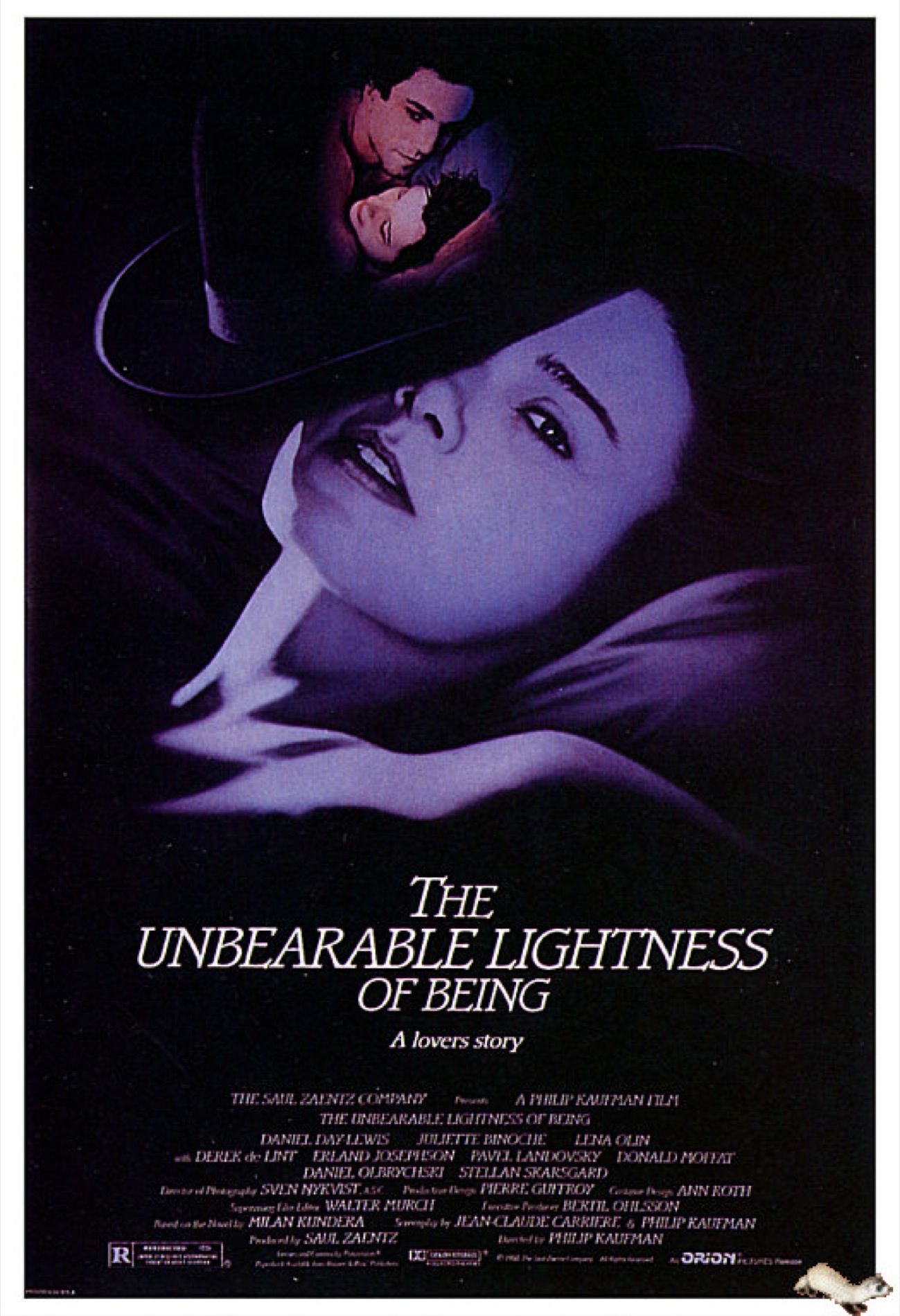Je suis arrivé en Europe pour écrire un roman, en école de droit, qui ne me plaisait pas et influencé par beaucoup de choses, comme Henry Miller, et je trouvais l’Amérique ennuyeuse. La « Nouvelle Vague » débutait en France, en Italie il y avait Pasolini. C’est alors que John Cassavetes fit Shadows et j’ai commencé à me dire « Wow, il y a là quelqu’un aux États-Unis qui fait des films intéressants ». Puis j’ai vu The Connection, réalisé par Shirley Clarke, et j’ai su que quelque chose d’excitant était en train de se produire aux États-Unis. C’était en 1962, j’ai décidé de rentrer et de faire des films.
A 36 ans, en 1972 premier film. 1983 – Réalise l’Etoffe des Héros un très grand film sur les 15 premières années de l’aventure spatiale américaine. A 50 ans, pour Saul Zaentz le producteur d’Amadeus, Le Patient anglais il adapte le roman du tchèque Milan Kundera, L’Insoutenable légèreté de l’être, paru deux ans plus tôt. Roman autant qu’essai, alternant narration classique et digressions philosophiques ? Aidé de Jean-Claude Carrière au scénario, Kaufman suit le conseil laconique de Kundera « Éliminez ! ». L’intrigue devient chronologique, gagne en linéarité et se recentre sur les trois personnages principaux…Tomas, chirurgien séducteur au regard de braise, rencontre Tereza, une serveuse pure et volontaire, alors qu’il a déjà une maîtresse voluptueuse, Sabina. Survient les chars soviétiques dans Prague, en 1968. Exil en Suisse et retour à Prague…Tomas devra choisir. Kaufman fait appel au chef-opérateur Sven Nykvist pour sa photo, somptueuse et élégante, associée aux notes de Leos Janácek qui compose un long ballet amoureux et sensuel. Kaufman orchestre la rencontre entre trois jeunes acteurs, à l’orée de leurs carrières…Daniel Day Lewis, révélé par Stephen Frears et James Ivory, Juliette Binoche juste sortie du Mauvais Sang de Leos Carax et la suédoise Lena Olin qui tournera dans de nombreux films américains. 1988 – Présentation du film après deux ans de travail. Cinq autres films suivront mais sans retrouver la magie, la force et le charme de ces deux films.



PRINTEMPS DE PRAGUE par Gérard Rocher
1968…Nous sommes en plein printemps de Prague. Tomas est un brillant chirurgien dans un hôpital de la capitale et dragueur incurable, fantasmant à la vue d’un jupon. Il ne s’attache jamais à ses conquêtes mais un jour il rencontre la charmante Tereza. Il tombe amoureux fou et l’épouse. Pourtant le jeune homme n’est pas « guéri » et continue sa vie dissolue notamment avec Sabina. La société tchèque s’émancipe, la liberté apparaît mais les chars russes font irruption. La vie de chacun est bouleversée…L’exode pour certains, la vie au pays dans la crainte et l’oppression pour d’autres…Adapté d’un roman de Milan Kundera qui obtint un beau succès de librairie, ce film se montre captivant en nous ouvrant la porte sur la gaieté, la frivolité et l’insolence représentée ici par le personnage de Tomas avide de conquêtes amoureuses, papillonnant à longueur de temps et heureux dans son travail. Les jolies femmes ne lui font pas oublier son épouse. Il butine en toute liberté, fréquente Sabina portrait type de l’évolution artistique et de l’émancipation féminine. De son côté, la gentille et douce Tereza est l’emblème de la tolérance et de la douceur face à cette situation pleine d’ambiguïté et de mensonges. Le réalisateur nous « ‘renverse » brutalement dans l’énorme drame que va vivre tout un peuple anéanti. Les personnages vont alors prendre des options différentes pour mener leur vie tout en gardant leurs propres convictions. Pour réussir son film, Philip Kaufman en plus d’avoir très bien structuré son film, s’est entouré d’un trio d’acteurs principaux aussi talentueux que persuasifs. Daniel Day-Lewis est séduisant à souhait dans son personnage « volage » alors que Juliette Binoche donne sa pleine mesure dans son rôle de Tereza, femme parfois heureuse, souvent bafouée puis impuissante comme les autres face au carnage. Lena Olin représente ici merveilleusement bien la femme libérée, artiste dans l’âme avide de fréquentations et de découvertes. Force est de constater que Philip Kaufman nous restitue avec panache ces événements qui à l’époque nous ont bouleversés, révoltés et qui aujourd’hui restent gravés dans les mémoires de ceux qui ont connu cette période. Ce film est réaliste et distribue une piqûre de rappel efficace, émouvante et passionnante.


LE POIDS DE LA LIBERTÉ…
S’accaparer un pays au cinéma, c’est toujours plus que simplement lui faire jouer un rôle qui n’est pas le sien. C’est l’extraire de son cadre et le reproposer sous une forme qui se réclame de l’art. Mais cet art ne peut pas être partout, et surtout pas ici…Si le film s’adressait de facto au monde, il s’adressait aux Tchèques qui allaient voir le Printemps de Prague cinématographié pour la première fois, mais aussi aux lecteurs du roman de Milan Kundera qui s’attendaient à une vision aussi sourdement varié de la Tchécoslovaquie dans les années 1960. Des contraintes qui ont modelé le film bien davantage que le réalisateur lui-même, et qui auraient pu signer sa perte. Le contexte de l’œuvre pourrait d’ailleurs aller bien plus loin, Miloš Forman a lui-même été empêché de faire le film compte tenu de la situation politique en République Tchèque, et les Russes ont découvert grâce au film, lors de la dislocation de l’URSS, ce qu’avait réellement été le Printemps de Prague. Cependant, pour circonvenir à cette pression Kaufman avait deux as en mains…Jean-Claude Carrière pour l’assurance d’une adaptation experte et littéraire, et Daniel Day-Lewis pour sa performance si précise que son jeu ressemble à un tableau. Devant une attente qui était aussi bien historique romanesque et cinématographique, Kaufman était avant tout responsable d’un choix, miser sur cette paire d’as et espérer glaner la poule aux Globes d’Or (raté), ou bien aller plus loin, au bluff. Le choix du bluff se retrouvera dans certains recoins parmi les plus mal dépoussiérés, il ne suffisait pas d’étaler des mots tchèques partout en texte pour faire croire qu’on était à Prague pour de vrai (surtout qu’on voit clairement que le même accessoiriste a créé tous les panonceaux), et il y a des endroits plus discrets à Lyon que Fourvière pour simuler un Prague inaccessible. Enfin, Day-Lewis aura beau avoir appris le tchèque pour le tournage, son faux accent vacille beaucoup. “Heureusement”, le casting cosmopolite comptera beaucoup sur les accents naturels de Juliette Binoche, Lena Olin et Stellan Skarsgård notamment.
Kaufman se sort très bien du dilemme entre contraintes et création en extrayant son ouvrage non pas d’un cadre mais de plusieurs, les cadres social, émotionnel, historique, littéraire et philosophique. À cette fin, un seul homme Day-Lewis. C’est à travers le personnage de médecin de Day-Lewis, sorte de Dr. Kellogg aussi scientifique qu’illuminé et littéraire, qu’on va découvrir la République Tchèque, un pays à la fois banal et inconnu pour un regard extérieur, endroit parfait donc pour qu’une caméra serve à donner un coup de balai en filmant une simple chambre ou un bête banc. C’est donc dans la peau d’un “Autre” que l’acteur se met d’abord. Il ne joue pas son personnage, mais plutôt le perturbateur, comme s’il était vraiment l’Irlandais qui n’a rien à faire à Prague, que tout en lui était vice, et que c’était la première fois qu’il voyait ce banc bête et cette chambre simple. Il fait de Binoche et Olin ses jouets, et c’est d’ailleurs à se demander s’il fait vraiment semblant vive l’acteur total. Quand elles se reflètent dans les nombreux miroirs qui parsèment l’histoire, ce n’est même plus leur propre image qu’elle renvoient, mais la sienne à lui. Mais en jouant le parasite, il participe justement à l’emparement du pays et comme il est sans-gêne, on a l’impression qu’il se sent chez lui, si bien qu’il finit par s’accaparer le cadre et par être chez lui pour de vrai. Comme on le sent peu à sa place, cela devient même presque normal que le trouble entier vienne de lui, alors même que le choix de prendre le personnage principal comme instigateur des rebondissements aurait dû froisser par son évidence. Il faudra attendre d’avoir vu tout le film pour comprendre que certaines dérives dans un absurde pictural, ainsi que l’exploitation sans concession de cet immense “trouble” d’abord homogène, sont tirées directement du livre…Du cocasse, voire des gags qui jurent avec les tonalités du reste. Néanmoins, un autre trouble, légitime quant à lui, grandit en parallèle, qui sont ces gens qui semblent vivre des choses immenses dans une petite ville, un petit pays, avec une petite vie ?…


…Le film tire de sa longueur un antidote aux dérapages accompagnant le long enflement de cette question. Cet antidote, c’est la non-linéarité qui va et vient selon le bon vouloir du scénariste et les dépassements des tracas terre-à-terre par un esprit entièrement métaphorisé dans le goût philosophique de Kundera, comme si la réflexion toute simple était rendue incapable de toucher au matériel. Voilà le genre de motifs, parfois poussés trop loin, au moyen desquels l’œuvre arrive à nous faire admettre, non parce qu’elle sait toujours quoi en faire, mais parce qu’elle sait quoi en faire à plein endroits que le Prague pastel, un peu sombre et humide, où l’amour est vécu à moitié dans le déni d’une vie ennuyeuse et où la menace du régime soviétique plane, va exploser et pas seulement au sens propre de l’invasion russe. L’hymne soviétique part en impro de jazz. Les images d’archives se mêlent au scénario, la fiction passe au noir et blanc, et pendant un instant déconcertant les personnages semblent faire partie des deux à la fois. Le trouble part en fumée et un autre film commence. Tout ce qui semblait vicié, un peu décalé, voire légèrement choquant, éclate avec le Printemps de Prague une belle occasion de parler de “bourgeonnement” de bonnes idées, d’ailleurs. Day-Lewis sort de sa chrysalide pour adopter son vrai rôle, plus distant, qui va permettre de mettre un as supplémentaire dans la main de Kaufman. Souvent, au cinéma, les liaisons sentimentales manquent d’arrière-plan et sont assez diffuses à moins qu’on se concentre sur elles mais dans L’Insoutenable légèreté de l’être, c’en sont deux qui résonnent avec toute la puissance de racines anciennes bien plus vieilles que deux petites heures, même si les relations en soi sont parfois médiocrement décrites. Malheureusement, si l’érotisme que cela incite invite à une photographie qui diversifie encore les méthodes, ça n’est venu à l’idée de personne d’apprendre à Binoche comment se servir d’un appareil photo ? La lumière ? Connais pas. La mise au point ? Ça se mange ? Bon, après, l’appareil photo qu’elle utilise n’existait pas encore en 1968, donc j’imagine que ça autorise à en faire ce qu’on veut. Le film construit ensuite ses propres motifs, typiquement septième-artistiques. Son motif principal, c’est la pause de grands vides qui permettent parfois simplement à l’interprétation personnelle du spectateur de se frayer un chemin à travers les épaisses fibres romanesques, pour enfin lui permettre de créer lui-même les émotions des personnages et de les polir à sa taille et il les descend ainsi d’un piédestal quasiment académique qui était déjà responsable d’avoir poussé le film trop loin à certains endroits…




Ainsi le film ferme la boucle en répondant à la dernière question…Qu’est-ce que la légèreté de l’être devant l’incompréhension de l’autre, l’oppression politique, l’interdiction d’un ton péremptoire par la remise en cause continue opérée par le littéraire, ou le simple fait que cette légèreté est le résultat d’une insensibilité égotiste ?
Justement, ce n’est rien qu’on ne peut appliquer dans son propre cadre, la légèreté politique naît de la légèreté sociale, qui vient de la légèreté sentimentale, qui vient d’une légèreté personnelle n’ayant de sens que dans le reflet de l’autre.
C’est l’écroulement du “socialisme à visage humain” et de TOUT les Totalitarisme qui permet aux personnes de montrer leur légèreté dans la liberté.