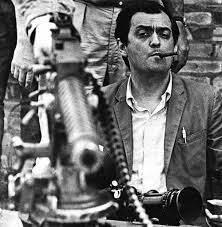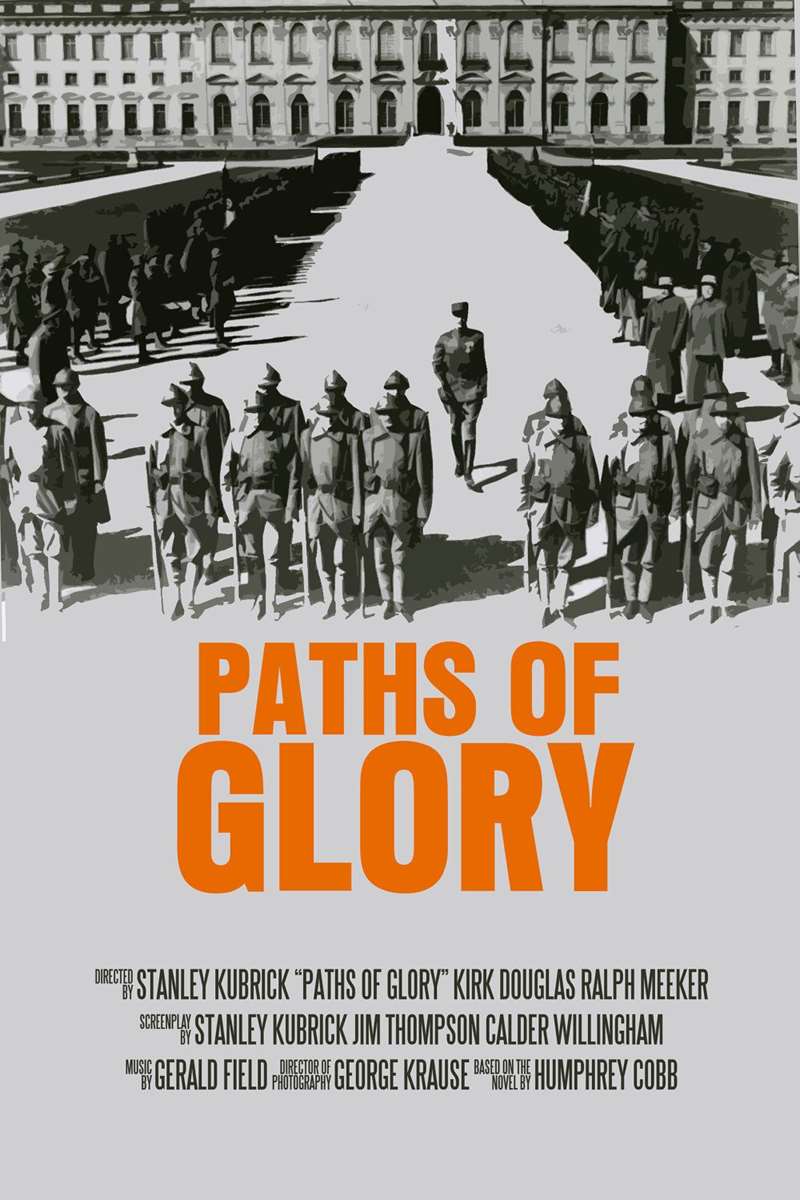Troisième film “officiel”. Stanley Kubrick affirme son style et la thématique du maître, déjà perceptibles dans L’Ultime razzia. Kubrick manifeste déjà un goût certain pour les compositions géométriques voir tous les face à face entre officiers et les longs travellings bien avant le Steadycam, les progressions dans les tranchées étroites sont impressionnantes. Il marque surtout le début de l’étude kubrickienne des mécanismes de déshumanisation, et l’armée fournit un excellent laboratoire, on pourrait bien sûr opposer l’état-major opérant depuis un château à la masse des fantassins croupissant dans la boue, mais Kubrick va plus loin, alors que les officiers sont clairement identifiés, les soldats restent anonymes, à deux exceptions près. Lorsque Mireau visite les tranchées, il demande leur nom à quelques soldats, qui sont dorénavant porteurs d’une identité, mais seul l’officier accorde ce droit à être nommé. Dans Full Metal Jacket, le sergent Hartman n’agira pas autrement en donnant des surnoms à ses têtes de turc. Enfin, les soldats sont individualisés lorsqu’ils doivent servir «d’exemple » et sont donc fusillés « Aucun homme n’a de nom, sauf dans la mort », ce qui annonce Fight Club, grand film kubrickien s’il en est.





Kubrick démontre que ce système ne fonctionne pas seulement à un niveau global, mais aussi individuel car chaque personnage, à une exception près, est déresponsabilisé. Aucun ne prend de décision de sa propre volonté, mais chacun se réfère à une responsabilité supérieure, que ce soit pour couvrir une erreur, Mireau ordonnant de tirer sur ses propres troupes, voire un meurtre indirect, le lieutenant sacrifiant le soldat témoin de son incompétence. Même l’opérateur radio agit en se référant au code pour se protéger d’éventuelles accusations. Kubrick ne montre donc pas un système d’oppression centralisé, mais une série de micro-structures où chacun participe sans jamais se sentir responsable. La seule exception est le colonel Dax, dont il est précisé qu’il n’est pas militaire de carrière, au contraire de Mireau qui en fait sa fierté. Dax agit selon ses principes, ce qui lui vaudra l’incompréhension du très cynique général Broulard, qui pense que sa lutte contre Mireau est motivée par l’ambition personnelle. Kubrick traitera de l’aliénation durant toute sa carrière, le premier jalon se trouve ici. Les Sentiers de la gloire n’a jamais été interdit de projection en France. La réalité est pire, le film avait déjà suscité de violentes réactions de l’armée et d’associations d’anciens combattants lors de son exploitation en Belgique. Soucieux de s’épargner une polémique en pleine guerre d’Algérie, le Quai d’Orsay demande à Washington de suggérer au distributeur d’oublier de proposer le film en France, les cinéphiles seront contraints de passer la frontière pour découvrir le film. Les Sentiers de la gloire ne sortira en France que durant l’été 1975. Un très grand film sur un sujet encore brûlant, comme le prouvent les violentes polémiques déclenchées par chaque tentative de réhabilitation des victimes de la justice militaire.

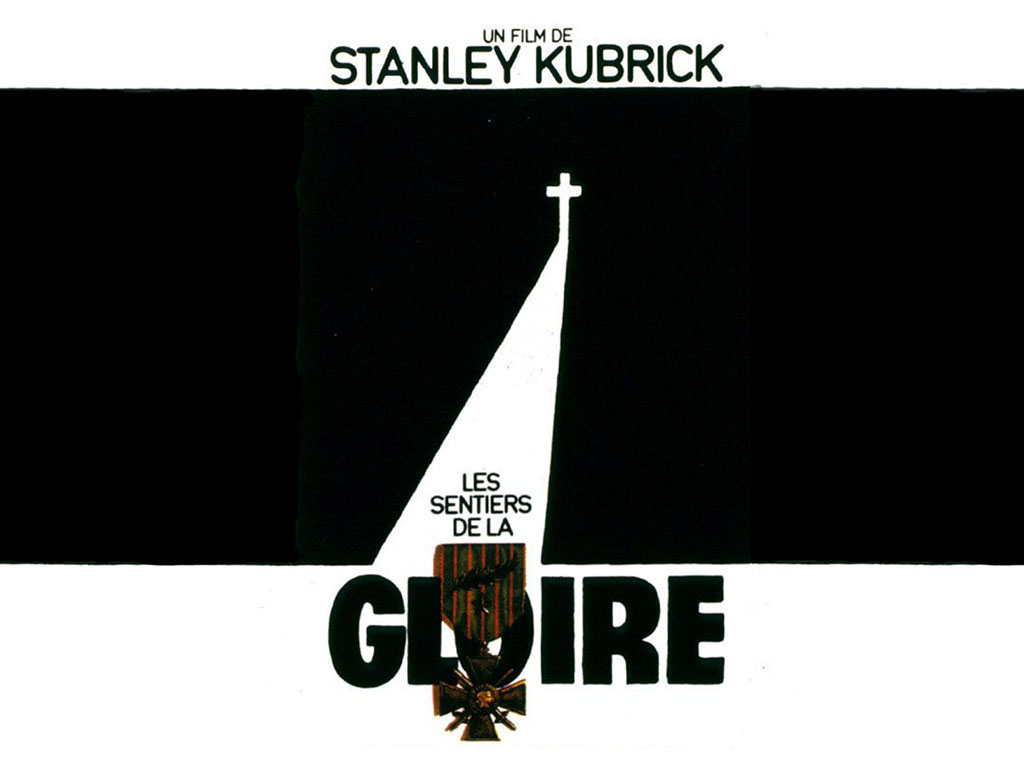

POUR L’EXEMPLE… par Benoît Smith
La fascination de Kubrick pour la capacité de l’individu ou de ses institutions à causer, par leurs errements, la ruine des leurs pouvait difficilement trouver meilleure cible que l’armée. Anti-militariste, le cinéaste ? Le mot réduit le propos. Si la « grande muette » en prend effectivement pour son grade dans ses films, c’est parce qu’elle est à ses yeux un exemple vivant de la ritualisation insensée et hypocrite des pulsions destructrices de l’humain. Les Sentiers de la gloire est d’autant éloquent sur cette vision du monde et non seulement de l’armée ou de la guerre qu’il semble tout entier tendu vers ce but, attelé à cette charge. Prédécesseur de Spartacus l’expérience qui déciderait Kubrick à s’éloigner définitivement des studios hollywoodiens il s’agit par certains côtés d’un film-butoir, d’une fin de premier chapitre pour la carrière de son auteur. C’était évidemment la dernière fois qu’il manifestait son indépendance au sein du système de studios américain, se permettant même ici, du haut de ses 29 ans, de traiter d’égal à égal avec Kirk Douglas…Spartacus prenant dès lors des allures de revanche du star-system sur le jeune insolent. Mais c’est aussi le dernier de ses films restant en deçà de la durée symbolique de quatre-vingt-dix minutes, la plupart des suivants dépassant allègrement les deux heures. Décidé dès ses débuts à la quasi-autarcie, mais devant néanmoins composer avec les contraintes d’une industrie, Kubrick travaillait alors sur des durées de série B, cherchant l’impact dans un rythme rapide, n’ayant pas encore entrepris une fois qu’il aurait pris le large de prolonger ses effets, de travailler sa matière cinématographique dans des dimensions multiples.





Deux humeurs, un regard…
L’histoire pourrait résumer un docu-fiction français, tant elle illustre fidèlement un des scandales de guerre les plus notoires à avoir atteint nos livres d’histoire. Nous sommes dans la France en guerre en 1916, entre les tranchées et le château où siège l’état-major. Des généraux ambitieux décident arbitrairement une percée à l’échec pourtant prévisible, et devant le résultat, font traduire en cour martiale pour l’exemple trois soldats triés sur le volet du régiment impliqué, pour une parodie de procès à l’issue jouée d’avancée. La présence des tranchées, l’omniprésence des uniformes et des fusils n’y peuvent rien, Les Sentiers de la gloire n’est pas un film de guerre. La guerre proprement dite y tient en deux scènes la ramenant à une dimension des plus antihéroïques et dérisoires, la percée fatale d’hommes fort peu combattants, rampant pour sauver leur peau et une sortie nocturne où un homme finit tué par une grenade de son propre camp. Le reste est une vaste tragicomédie, une ronde d’hypocrisies, de lâchetés bien humaines plus ou moins déguisées, d’autopersuasions hallucinées, le tout mécanisé jusqu’à l’absurde par les mots creux et les protocoles rigides hiérarchisant les décideurs aux mains propres et les exécutants bons à broyer. Pour filmer cette ronde, Kubrick adopte deux attitudes. Il y a celle de l’observateur distant à l’ironie cruelle, capturant en plans longs les agitations de la fausseté et de la futilité dans la fonction militaire, dans les salons luxueux ou au front. Et il y a celle du chasseur des surgissements de la contrariété, de l’émotion, de la pulsion, en bref de tout ce qui trahit l’inanité des protocoles, et qui est traduit en un découpage rapide venant souvent briser la fausse tenue des plans longs susmentionnés. Telles la tragédie et la comédie, ces deux « régimes d’images » sont comme deux humeurs qui se succèdent en un cycle, mais ne forment qu’un seul regard, jamais glacé mais impitoyable, sur ces gesticulations démentes d’autodestruction du genre humain, processus dans lequel le spectateur est encore un peu plus immergé, à quelques occasions, par le truchement d’un point de vue subjectif ou d’un travelling dans l’axe du mouvement, jusque dans un peloton d’exécution.





Amer soulagement…
L’officier idéaliste et un brin contestataire incarné par Kirk Douglas semble n’intervenir dans le récit qu’à son corps défendant. Non que Kubrick, qu’on sait peu enclin à l’optimisme, lui signifie un rejet appuyé, mais il ne lui laisse clairement pas la moindre chance. Compromis dès le départ pour avoir cédé à l’ordre de l’attaque insensée, isolé par la caméra au second plan de la salle de procès derrière les silhouettes des accusés et de leurs gardiens, la posture de dignité volontiers frondeuse du personnage, son éloquence et son habileté d’avocat-justicier paraissent bien déplacées et vaines face à une machine institutionnelle qui n’obéit qu’à sa propre logique, faite d’un croisement aberrant entre rites figés et réactions pulsionnelles. D’une manière générale, c’est la part la plus hollywoodienne du film, cette foi forcée en la subsistance de la justice et d’une bonté humaine gisant au fond du militaire, qui se trouve ici vidée de son sens. Même la scène finale apparemment réconciliatrice, une chanteuse allemande, campée par la future Mme Kubrick, adoucit de sa voix d’ange les soldats français laisse un goût amer par le spectacle de troufions en éructation et prompts au défoulement sexuel, soudain transformés en visages contemplatifs et larmoyants ramène soudain à la futilité de leur situation, de cette image guerrière qu’ils ont ordre d’incarner au front. Tout ça pour ça.



Oeuvre moderne, humaine et pacifiste par Jean-Michel Deroussent
11 octobre 1914. Campagne française, dans un lieu dit « La Fourmilière ». Entre deux glacis boueux, des corps sans vie jalonnent le sol et dessinent les contours de sentiers auxquels Kubrick donne très ironiquement le nom de « Sentiers de la gloire ». Le mot « Honte » siérait mieux aux portraits qui nous sont dressés. Les visages affables des poilus français tranche avec la décadence des élites. L’horreur de la guerre éclate, et son absurdité est d’avantage saisissante. Le pacifisme est un thème omniprésent chez Stanley Kubrick. Contrairement à Fear and Desire, premier film que le cinéaste reniera lui-même, où un petit groupe de soldats luttent contre un ennemi symbolique, le cinéaste opte résolument pour une approche plus réaliste dans Les Sentiers de la gloire. Grâce à une photographie très brute, nous sommes confrontés, en même temps que les soldats, à toute l’horreur de la guerre, la scène d’attaque de la colline étant à ce titre d’une incroyable intensité. Les visages sont tristes, émincés, crispés, l’arrière fond sinistre, l’ambiance froide. Stanley Kubrick dessine la peur comme un tableau de Georg Grosz ou d’Otto Dix. Pas étonnant dès lors que la sortie des Sentiers de la Gloire, en 1957, ait provoqué de vifs remous, en premier lieu en France où son propos jugé anti-patriotique fit scandale. Le film ne fut pas censuré par parties, mais tout bonnement interdit. Les détracteurs et les décideurs avaient en effet relevé, avec autant de vice et de mauvaise foi que d’intelligence, toute une série d’incohérences présentées comme rédhibitoires pour une sortie dans les salles françaises, une procédure judiciaire de type américain, un numéro de régiment qui n’existe pas, un code militaire anglicisé, bref de nombreux éléments destinés à légitimer le bannissement du film. Ainsi, Les Sentiers de la Gloire ne sortira en France qu’en 1975. Bien évidemment, la volonté de Kubrick n’est pas d’entrer dans une approche documentaliste. Le récit emprunte ainsi nécessairement certains éléments fictifs, et son manque de précision historique, sur certains détails, est facilement à repérer. Mais derrière cette reconstitution historique parfois imprécise, sachant que de nos jours, personne ne se soucierait de cet aspect, et que les arguments utilisés à l’époque pour justifier l’interdiction de sortie seraient irrecevables, le cinéaste exprime des idées ô combien puissantes. Ce sont des valeurs intemporelles et universelles comme la paix, la justice et l’équité, qui sont dès lors exaltées. Reprenant « l’affaire des caporaux de Souain », le récit est centré sur un fait dramatique. Surprenant certains de ses hommes à tenter de déserter, le général George Broulard ordonne de leur tirer dessus pour les stopper dans leur tentative de défection. Peu après cet incident, il intime un simulacre de jugement afin de sanctionner des soldats ayant refusé d’attaquer une position à l’évidence inaccessible. Plus que l’horreur de la guerre, c’est son absurdité qui est personnifiée à travers les traits du général George Broulard. Le masque du patriotisme et de la guerre glorieuse tombe, et c’est bien l’indignation qui s’abat sur cet homme dont le seul orgueil fait couler le sang de la honte.
Le procès symbolise le plaidoyer du metteur en scène contre les mécanismes aberrants de la justice militaire. La confrontation met aux prises un juge à la morale douteuse et aux argument fallacieux, qui n’est en fait qu’un officier choisi par les hauts décideurs pour son « patriotisme », et un colonel incarné par le charismatique Kirk Douglas, certes impétueux et impulsif, mais idéaliste et profondément humain. Tout l’art du cinéaste est d’imprimer un rythme dans les échanges de points de vue qui permette d’éviter l’écueil de la démagogie et du manichéisme. De l’intensité, mais finalement beaucoup de sobriété. Stanley Kubrick, âgé de 29 ans quand il réalise le film, reste essentiellement attentif à une photographie parfois ostentatoire, mais quoiqu’il en soit percutante. Alors qu’il aurait pu opter pour des procédés amenant la réflexion de manière sous-jacente, il privilégie une manière directe d’exposer ses idées. D’ailleurs, sur ce point, la vision critique du metteur en scène évoluera sensiblement dans Docteur Folamour mais surtout dans Full Metal Jacket, où la guerre trouvera une forme moins dynamique et évidente, plus froide, plus cynique et plus sourde. Les Sentiers de la Gloire reste avant tout un film en mouvement qui, s’il est traversé in extenso par un ton dramatique, dégage un souffle d’espoir et une énergie humaniste à travers le personnage interprété par Kirk Douglas. Aujourd’hui, il est aisé et même évident de dépasser la polémique autour d’un patriotisme nié, qui se déchaîna à l’époque. Mais finalement, en replaçant ce grand film dans son contexte, on peut penser qu’il participa à une réflexion éclairant une prise de conscience collective particulièrement salutaire au sortir de la Seconde Guerre Mondiale.